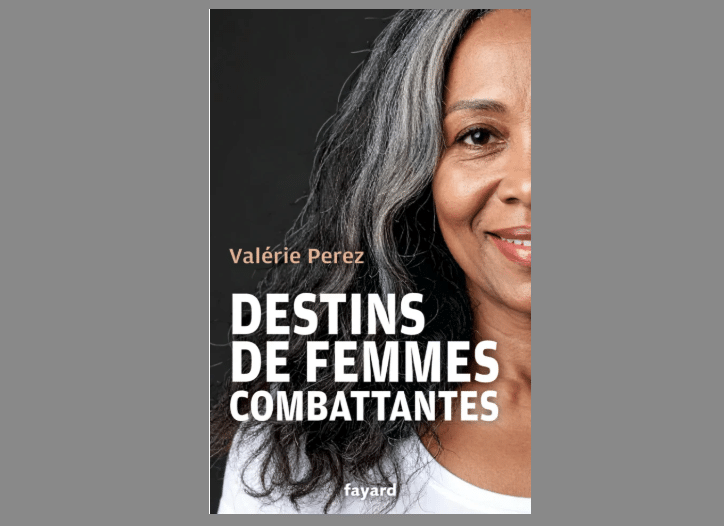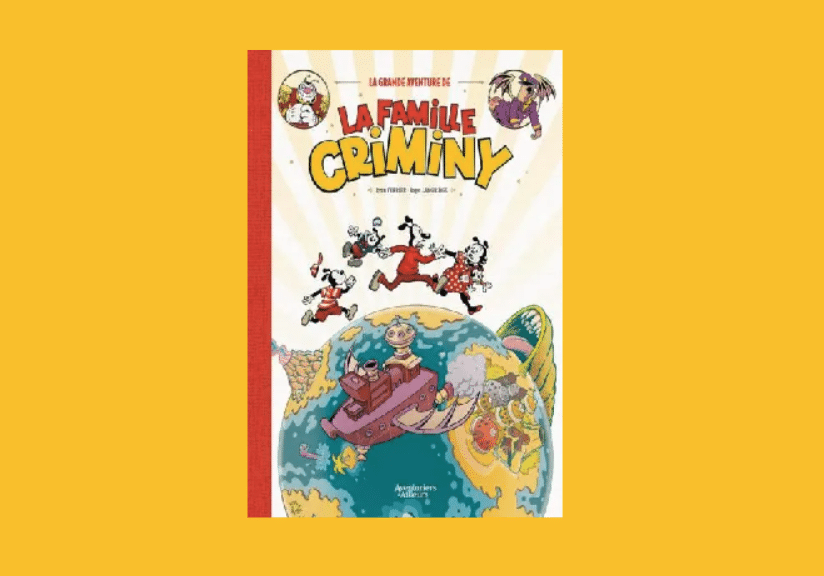Mon premier gros coup de cœur de cette quinzaine cannoise a été du côté de la compétition Un Certain Regard. Une sélection qui offre, année après année, des films souvent fabuleux. Godland nous fait voyager du Danemark en Islande pour raconter la terrible épreuve de foi d’un pasteur luthérien.
Fin du XIXe siècle. Un jeune pasteur danois arrivé en Islande a pour mission de faire construire une église et de photographier la population au milieu de paysages inhospitaliers. Tandis qu’il s’acquitte de son devoir, une improbable histoire d’amour se développe en même temps qu’un violent conflit…

Godland est à la fois visuellement saisissant et émotionnellement austère, mais ô combien touchant, opposant cet homme de foi de la fin du XIXe siècle à une force bien plus forte que lui et pénétrante jusqu’au plus profond de son âme.
Le cinéma scandinave aime explorer la figure pastorale (il est tout de suite bon de rappeler que le prêtre, comme le nomme la traduction est ici un pasteur luthérien, pouvant donc se marier, point important pour comprendre l’histoire). Un personnage souvent présenté dans la confrontation entre une foi profonde et des tourments intérieurs. C’est ici le cas pour Lucas (Elliott Crosset Hove), ce jeune pasteur luthérien envoyé par son Église du Danemark pour établir une paroisse en Islande, sans être du tout préparé à ce qui l’attend. C’est un idéaliste sincère et dévoué, désireux de découvrir le pays et ses habitants sur le chemin de sa destination, mais l’Islande est moins accueillante qu’il ne l’avait prévu – mais pas pire que ce qu’on lui avait dit – et le difficile voyage le brise à petits feux.

Barrière de langue qui sépare, attraction et répulsion, fraîcheur d’une adolescente et amour naissant, rugosité d’un homme blessé qui cherchera le pardon, grâce ou châtiment, résistance au mal ou abdication… Tout cela, et plus encore, constitue un matériau extrêmement riche, rendu d’autant plus captivant par l’environnement et la photographie de Maria von Hausswolff, certaines audaces de réalisation, et ce choix d’un cadrage carré aux coins arrondis qui apporte un cachet tout particulier en resserrant visuellement les choses.
Il va aussi de soi que ce genre de récit et d’approche visuelle ne va pas à toute vitesse, mais attend plutôt de son public qu’il se penche et s’engage dans les rythmes surprenants et parfois éprouvants du projet.
Un voyage épique qui devient une véritable expérience immersive proposée au spectateur, avant de bifurquer vers un dénouement en forme de lutte intérieure (et physique) intense… mais il faudra attendre le 21 décembre pour le découvrir sur les écrans français.