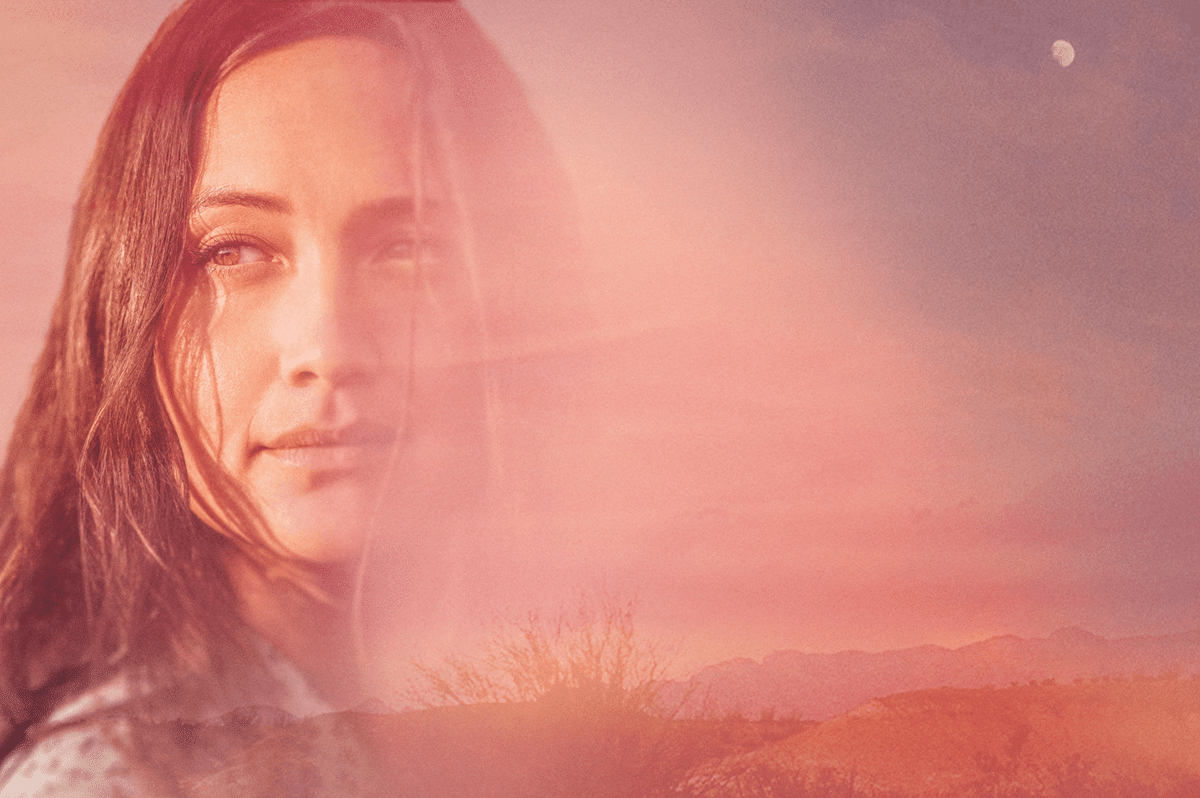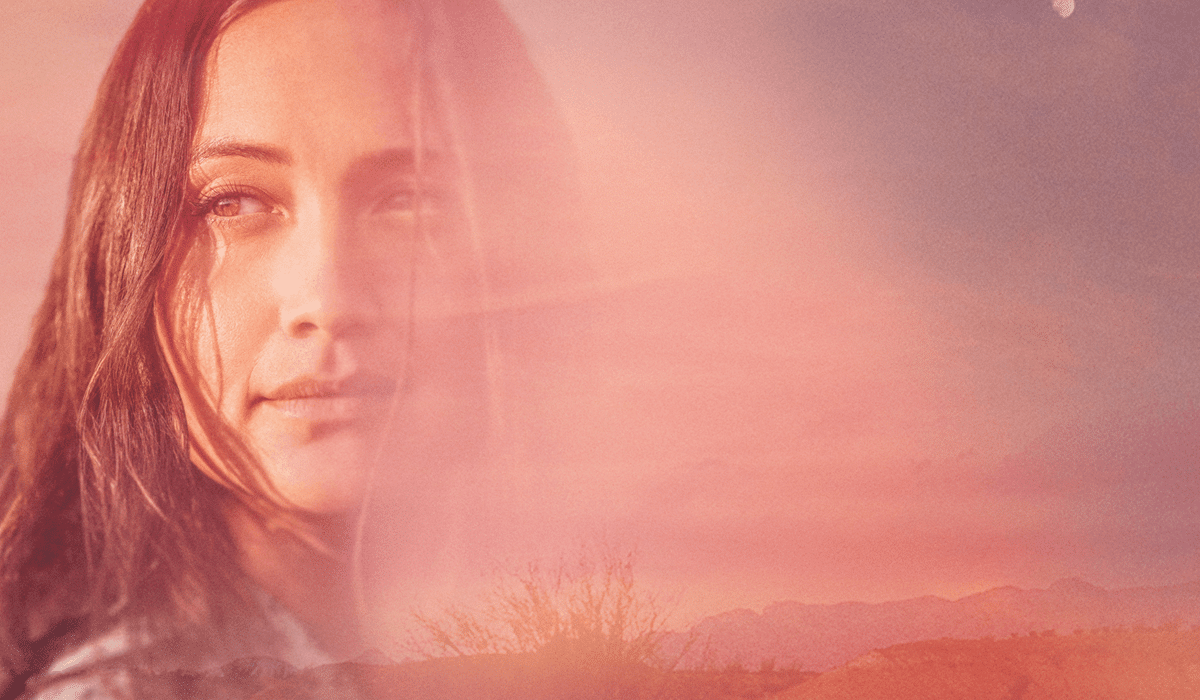Aux antipodes d’Avatar ou du biopic sur Whitney Houston, le scénariste-réalisateur islandais Hlynur Pálmason présente une fable spirituelle très touchante sur un certain éthos protestant en racontant l’histoire d’un missionnaire luthérien danois qui met sa foi à l’épreuve en explorant une région sauvage isolée d’Islande dans l’espoir d’y construire une église.
Fin du XIXe siècle. Un jeune pasteur danois arrivé en Islande a pour mission de faire construire une église et de photographier la population au milieu de paysages inhospitaliers. Tandis qu’il s’acquitte de son devoir, une improbable histoire d’amour se développe en même temps qu’un violent conflit…
C’est un régal tant pour les yeux que pour le cœur et la réflexion qui l’accompagne, que ce Godland, dont le titre original a la particularité d’être double, se disant à la fois en danois et en islandais (Vanskabte Land / Volada Land).
Un voyage en Islande, à la fin du XIXe siècle, alors que l’île est encore une colonie danoise. Une expédition menée par un jeune prêtre y arrive avec pour mission de construire une église et d’apporter la parole de Dieu à une petite communauté isolée. C’est le prétexte narratif initial pour Hlynur Pálmason de cartographier – avec autant de rigueur ethnographique que cinématographique – des paysages grandioses sur lesquels se déroulent, l’un après l’autre, plusieurs conflits dramatiques : la méfiance des Islandais envers les envoyés danois de la métropole, la dialectique entre la recherche de la transcendance et la matérialité physique de l’environnement, l’angoisse existentielle face au « silence de Dieu » et, enfin, la réponse féroce du patriarcat lorsqu’il voit ses fondements menacés, même si la menace vient de la sphère religieuse.
Il est un fait notable que le cinéma et les séries scandinaves aiment explorer la figure pastorale (rappelons ici que le prêtre, comme le nomme la traduction, est ici un pasteur luthérien, pouvant donc se marier, point important pour comprendre l’histoire).
Un personnage souvent présenté dans la confrontation entre une foi profonde et des tourments intérieurs. On peut facilement penser à l’excellente série danoise Au nom du Père – Ride Upon the Storm d’Adam Price racontant le destin d’une famille de pasteurs de l’Église luthérienne du Danemark et le parcours croisé de deux frères, chacun cherchant sa voie, entre éveil à la foi et perdition. Dans Godland, dans un contexte plus ancien et accompagné de la dimension missionnaire, c’est encore le cas pour Lucas (Elliott Crosset Hove), ce jeune pasteur envoyé pour établir une paroisse en Islande, sans être du tout préparé à ce qui l’attend.
L’Islande, un personnage à part entière
Le cadre islandais offre des images saisissantes : les volcans sombres et le terrain accidenté, la beauté immaculée de la glace scintillante. Cela fait ressembler ce mélodrame à une expérience hors du monde, un endroit où l’on pourrait s’attendre à se sentir abandonné par Dieu. Le missionnaire égocentrique essaie précisément de voir s’il est apte à se réfugier dans son être intérieur, au cœur de sa foi personnelle, et ainsi être apte à servir Dieu dans un environnement aussi inhumain. C’est aussi un idéaliste sincère et dévoué, désireux de découvrir le pays et ses habitants sur le chemin de sa destination, mais l’Islande est moins accueillante qu’il ne l’avait prévu – mais finalement pas pire que ce qu’on lui avait dit – et le difficile voyage le brise à petits feux, au risque même de sa foi.
Aussi magnifique que soit le lieu, l’Islande est cependant d’un froid rédhibitoire par endroits, volcanique à d’autres – un environnement extrême qui a dû ressembler à un coin de l’enfer pour un tel intellectuel missionnaire. Au début, Lucas ne montre aucun préjugé de ce genre. Curieux, il emporte avec lui un appareil photo et des livres – trop de livres – et s’arrête souvent pour documenter son environnement, préparant lui-même ses plaques en verre. On nous dit d’ailleurs d’emblée que le film s’inspire de sept photographies historiques prises par un prêtre danois, le premier à documenter la côte sud-est du pays. Le reste est librement imaginé par Pálmason.
Barrière de langue, attraction et répulsion, fraîcheur d’une séduisante et pétillante adolescente et amour naissant, rugosité d’un homme blessé qui cherchera le pardon, grâce ou châtiment, résistance au mal ou abdication… Tout cela, et plus encore, constitue un matériau extrêmement riche, rendu d’autant plus captivant par l’environnement et la photographie de Maria von Hausswolff, certaines audaces de réalisation, et ce choix d’un cadrage carré aux coins arrondis qui apporte un cachet tout particulier en resserrant visuellement les choses. Il va aussi de soi que ce genre de récit et d’approche visuelle ne va pas à toute vitesse, mais attend plutôt de son public qu’il se penche et s’engage dans les rythmes surprenants et parfois éprouvants du projet.
Pálmason canalise, dans ces quelques 138 minutes, le Werner Herzog ou le Terrence Malick qui sommeillent en lui, en nous transmettant de manière frappante la puissance durable et impitoyable de la Terre Mère ainsi que la fragilité de l’humanité, tant sur le plan physique que psychologique et spirituel.
Dans ce périple, les voyageurs trouvent-ils leur destination espérée ? Eh bien, le réalisateur choisit de diviser son film en deux parties distinctes, l’une qui rencontre l’environnement et l’autre qui accueille une communauté, et toutes deux présentent des dangers inhérents lorsque l’on dépasse les limites… Un vrai trésor cinématographique qu’il serait si dommage de ne pas découvrir !