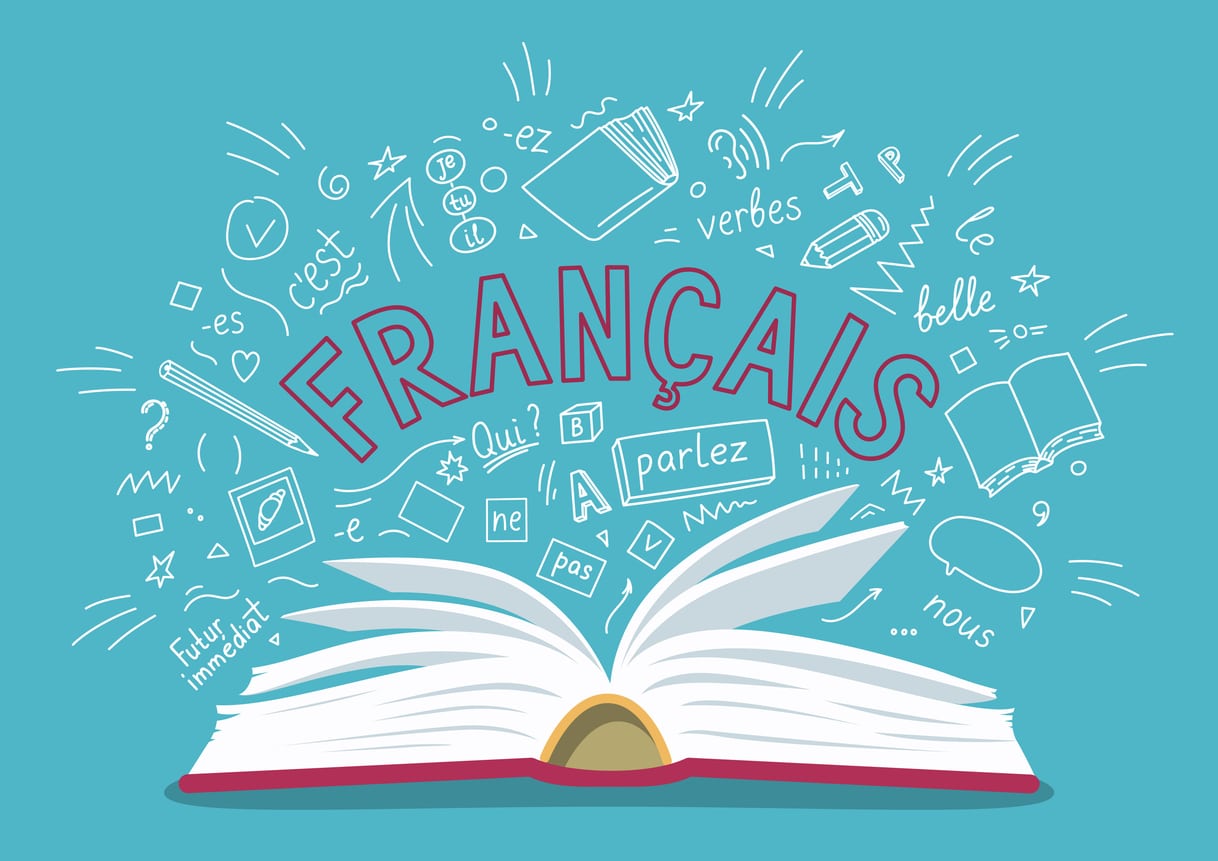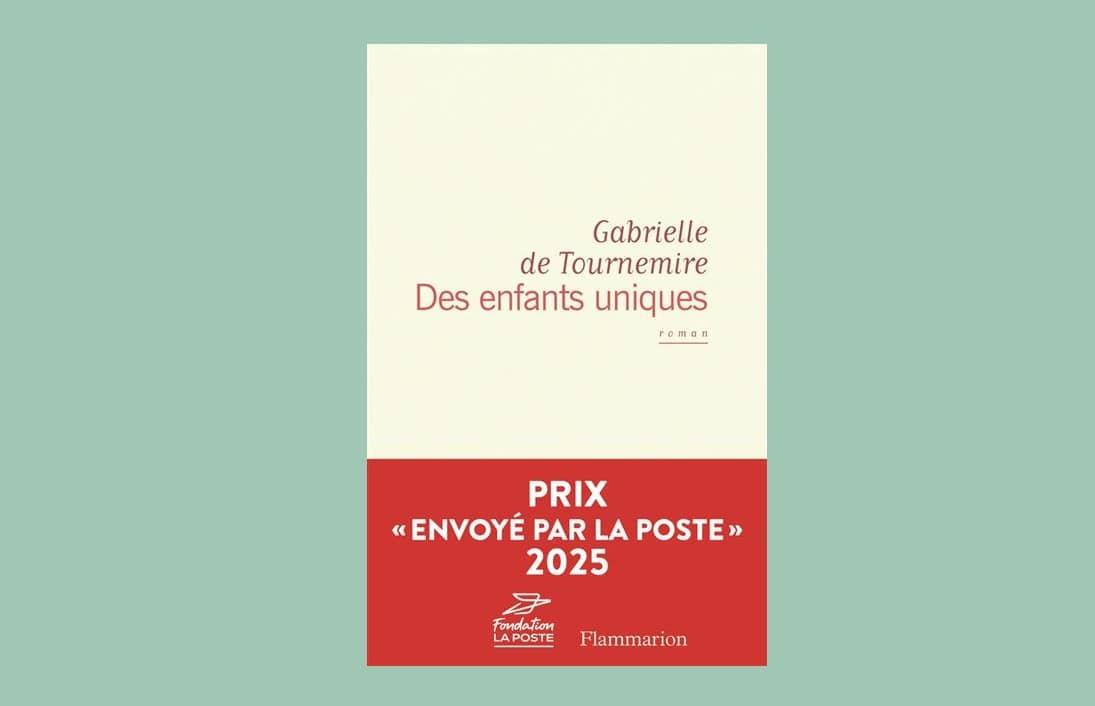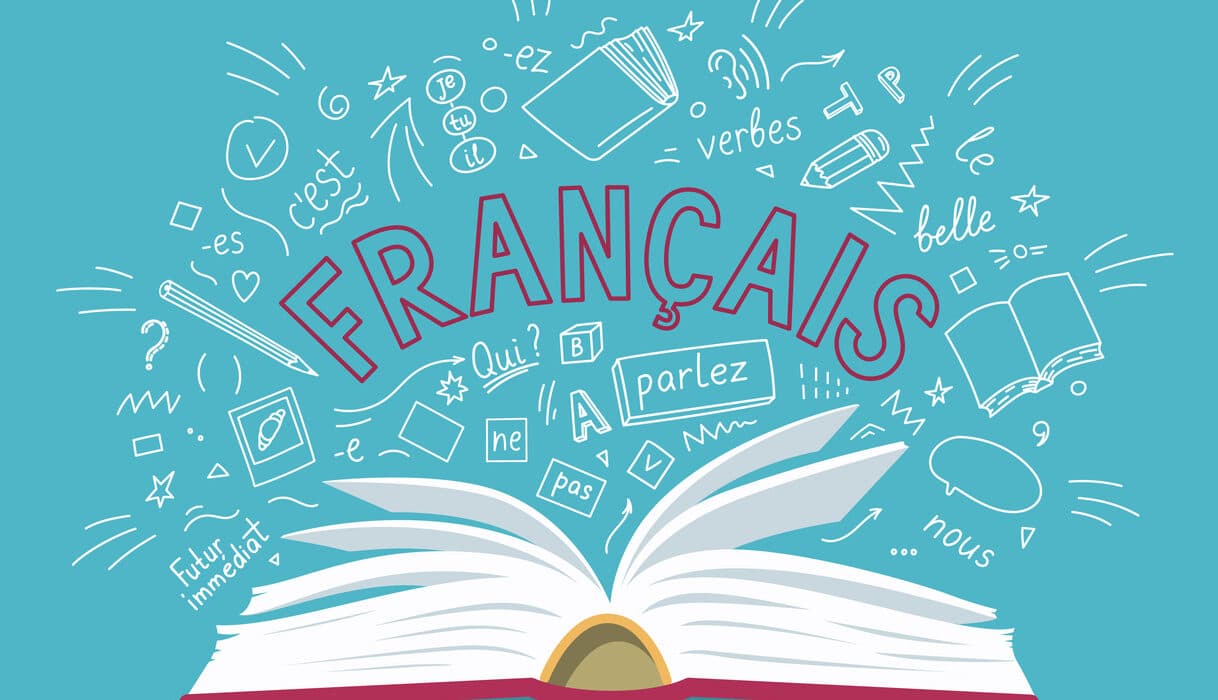Les 1700 ans du concile de Nicée donnent l’envie de revenir à cet événement majeur dans la construction du christianisme mais passablement abstrait et discret dans la foi protestante. De rapides recherches interrogent le sens d’une commémoration qui ne peut se contenter de l’ancienneté d’un chiffre rond.
Ce concile œcuménique fut présidé par l’empereur romain Constantin qui en 313, par un édit, autorisa le christianisme, encore soumis à des persécutions intermittentes. Mais l’empereur s’inquiétait des désordres nés de la floraison de courants théologiques dans la nouvelle religion, et particulièrement du succès de l’arianisme, une doctrine qui insistait plus sur l’humanité que sur la divinité du Christ.
L’assemblée convoquée dans l’actuelle Iznik (Turquie) réunit essentiellement des évêques du Proche-Orient et, parmi les quelque 200 identifiés, une infime minorité des représentants de l’Europe et de l’Afrique du Nord – cette dernière pourtant largement christianisée. Le concile dit œcuménique (« de la terre habitée ») ne le fut guère, car il écartait les terres favorables à ce qui allait être déclaré « hérésies ». Mais il en résulta des décisions unificatrices (par exemple la fixation de la date de Pâques) et un Credo, reconnu encore aujourd’hui par toutes les Églises chrétiennes.
Par une habileté scripturaire qui ne tenait qu’à une lettre, ce Credo surmonta les hésitations entre l’identité et la similarité du Fils et du Père et imposa une orthodoxie, rapidement intolérante et persécutrice envers ceux qui croyaient différemment. L’arianisme en cause déclina, mais réapparut indirectement dans la vision musulmane des liens entre Dieu et son Prophète. Et l’humanité d’un Jésus homme parmi les humains anime encore la foi de bien des croyants.
Nicée : une victoire, vraiment ?
Jean Loignon, professeur d’histoire-géographie, pour « L’œil de Réforme »