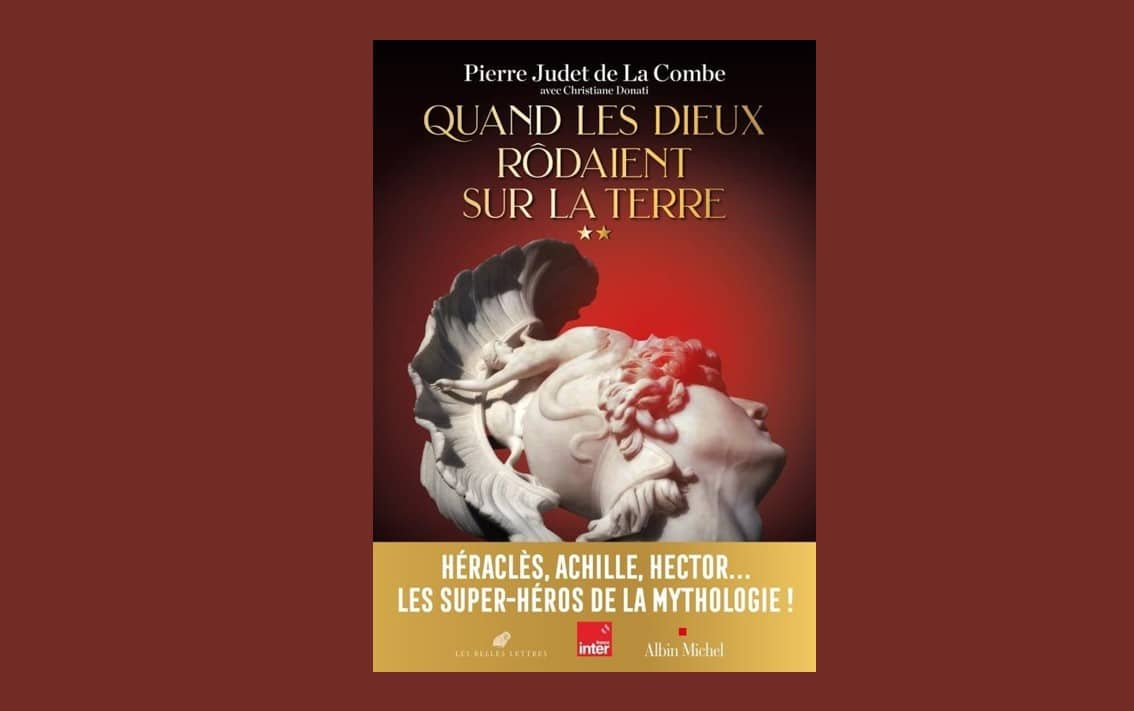Rien n’est jamais pareil. A la matraque et l’huile de ricin succède la télévision, la bonne humeur en fausse monnaie. Confondre Giorgia Meloni, jeune femme rieuse, avec Mussolini ? Vous n’y pensez pas deux minutes ! Et pourtant si, c’est bien ce qu’il faut faire : la confondre, on veut dire abattre son masque, afin que l’Italie, la Suède aussi, peut-être même la France, prennent conscience du péril.
Oh certes, il ne suffit pas de saines déclarations pour faire vaciller les opinions. Se donner bonne conscience est la facilité du moment. Mais puisque les réseaux dits sociaux partagent tous les jours une rumeur aux mille contours, il nous paraît plus que nécessaire de méditer sur le parcours d’un éditeur courageux : Léone Ginzburg.
Florence Mauro, cinéaste et femme de lettres qui connaît l’Italie de manière admirable, publie ces jours-ci « Leone Ginzburg, un intellectuel contre le fascisme » (Creaphis, 253 p. 12 €). Sous sa plume apparaît l’enfant d’Odessa devenu turinois, le combattant devenu journaliste, éditeur, amoureux de Natalia, résistant.
« Cet homme a joué un rôle de premier plan dans la culture italienne des années trente, explique Florence Mauro. Comme on le sait, il a fondé en compagnie de ses trois amis de lycée, Cesare Pavese et Julio Enaudi, les éditions Enaudi, qui demeurent une référence aujourd’hui. Mais ce n’était pas une opportunité professionnelle, pas même la réalisation d’un simple désir ; il s’agissait d’un geste politique. »

En suivant l’exemple de son maître Augusto Monti, qui se vantait d’instruire ses élèves en leur apprenant l’antifascisme et Dante, Leone Ginzburg a construit, mieux qu’une aventure intellectuelle : une réponse intelligente. « Il ne versait pas dans la vanité, ne prenait pas la pose du héros, note Florence Mauro. Dès 1931, Ginzburg a intégré le groupe « Justice et Liberté », l’un des mouvements d’opposition au Duce. Il a imprimé des tracts, édité des livres, passé des armes aussi. C’était un homme à hauteur d’homme, qui connaissait la peur, en parlait sans apprêt, ne jugeait pas ses amis lorsqu’ils flanchaient face aux menaces, à la répression politique. »
En traduisant lui-même « Guerre et Paix », puis nombre d’œuvres du grand répertoire russe, en faisant traduire par son ami Pavese « Moby Dick », il a ouvert bien des fenêtres, alors que Mussolini voulait cadenasser son pays. « Leone Ginzburg a même réédité les « Canti » de Leopardi en 1938, ajoute Florence Mauro. Ce n’était pas anodin parce que le grand poète du dix-neuvième siècle y exprimait, non seulement un sentiment de solitude, mais un rejet de l’exclusion. Cela ne pouvait que toucher des italiens placés sous l’oppression fasciste. »
On voit par là qu’il existe un lien fondamental entre la littérature et la liberté. L’Italie se meurt aujourd’hui sous les coups de boutoir d’une industrie du divertissement, qui trahit les idéaux de sa culture exigeante– en quel pays du monde trouver tant de beauté ? En France, la menace ne cesse de croître, alors même que certaines radicalités considèrent comme en urgence de déconstruire et déconstruire encore.
On sait pouvoir compter sur les protestants pour faire valoir l’essentiel : dans le moindre village des Cévennes, la lecture tient le premier rôle. Mais le chemin reste fragile. Ancrons notre âme dans un bain de culture. A l’heure où nous écrivons ces lignes, on apprend la mort de Paul Veyne. Ami de René Char, il avait publié l’un des grands livres d’histoire portant sur l’antiquité romaine : « Le pain et le cirque ». Tout un programme ?