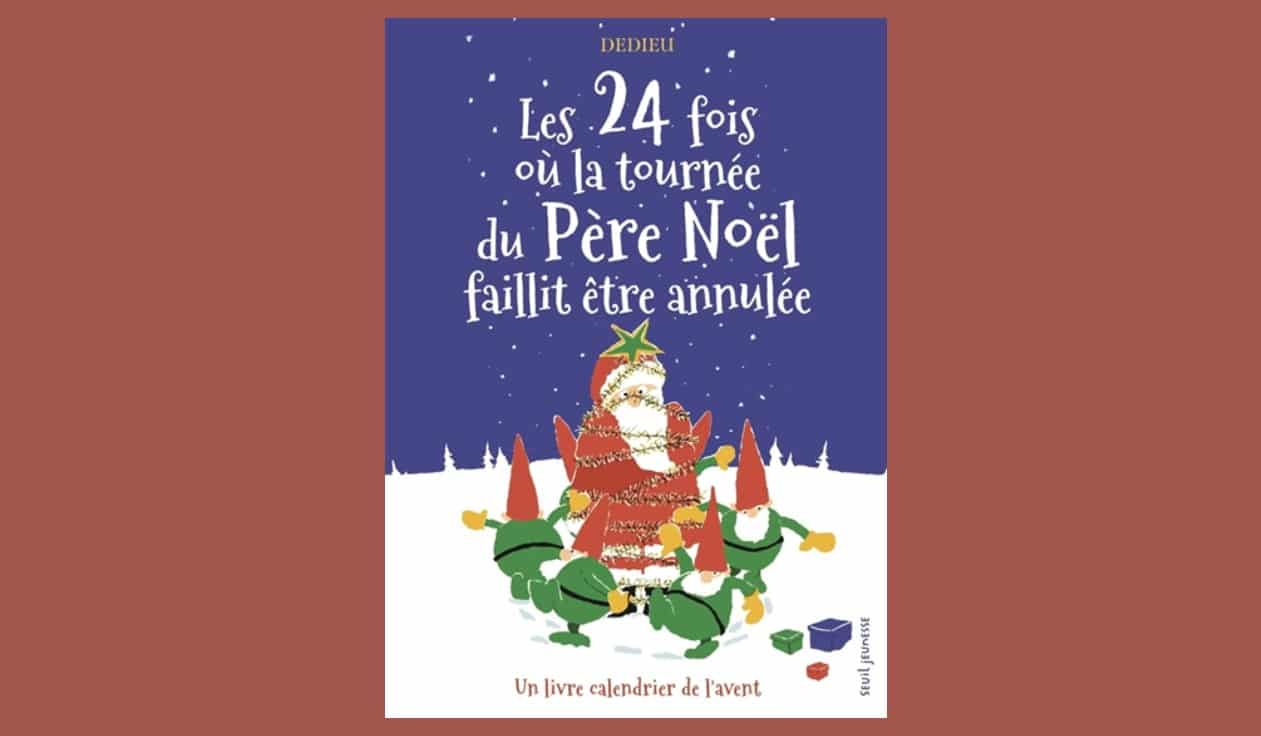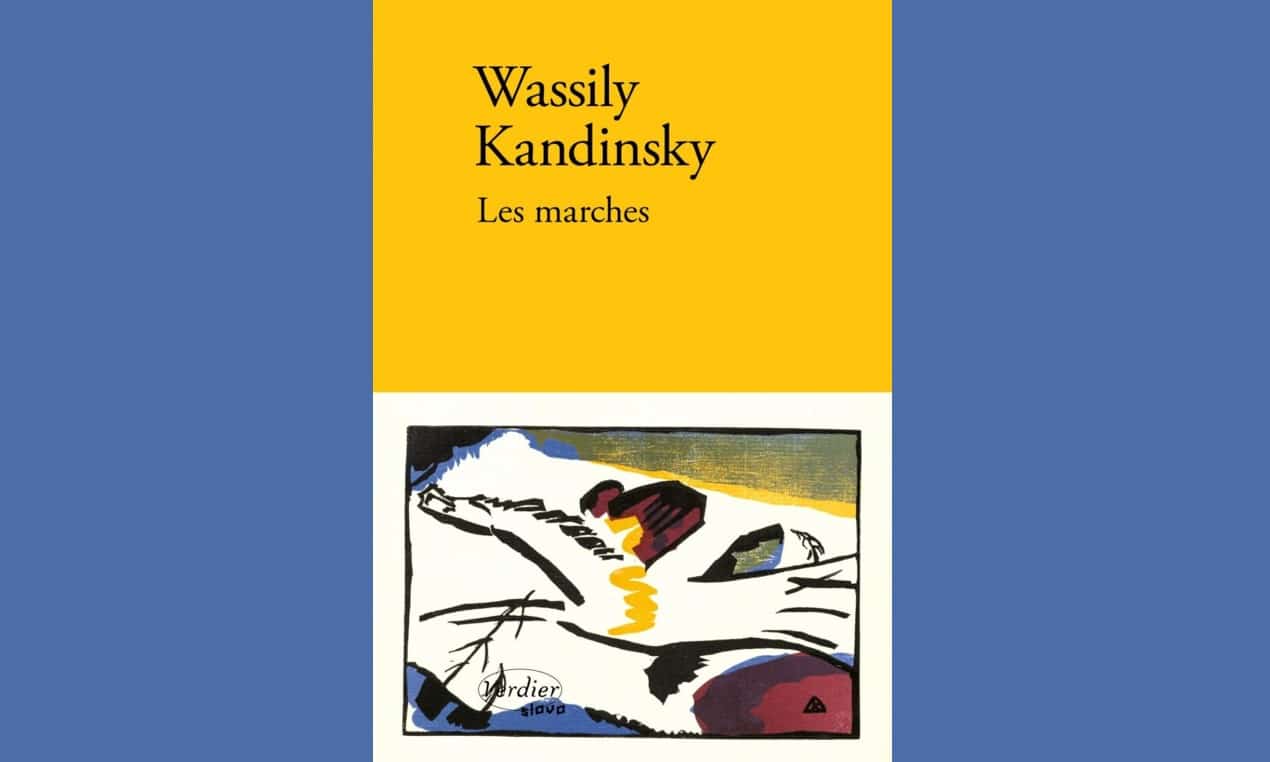Existe-t-il un genre cinématographique plus périlleux que celui du film biographique à visée populaire ? Surtout quand il s’agit d’incarner l’Abbé Pierre, longtemps élu personnalité préférée des Français ?
En 1989, dans Hiver 54, L’abbé Pierre (1,6 million de spectateurs français avec Lambert Wilson dans le rôle-titre), Denis Amar se focalisait sur l’épisode inoubliable du rude hiver 1954 : le célèbre appel sur les ondes de Radio Luxembourg, la vague inédite de solidarité que cela provoquait et la fondation d’Emmaüs. En 2023, dans L’Abbé Pierre – une vie de combats, Fréderic Tellier choisit, lui, de raconter la destinée exceptionnelle de Henri Grouès depuis son renvoi du couvent des Capucins à Crest en 1937 jusqu’à sa mort à Paris en 2007. Son film va même au-delà, suggérant (dans une mise en scène un peu kitsch et ridicule de voûte étoilée) que l’Abbé Pierre a accompli sa mission céleste de « laisser derrière lui un monde un peu meilleur » et qu’il figure désormais au panthéon des saintes figures de l’humanité.
Récit linéaire et hagiographique
Sous forme d’un long récit linéaire et hagiographique, entrecoupé d’images d’archives en noir et blanc, le film L’Abbé Pierre – une vie de combats survole soixante années de la vie du prêtre en égrenant de nombreux épisodes (dont certains méconnus mais traités trop vite ou de façon rutilante) : sa santé fragile à l’origine de sa vocation ratée de moine, sa mobilisation dans l’armée pendant la Seconde Guerre Mondiale, son rôle actif dans la Résistance, son action de député à l’Assemblée nationale où il porte haut et fort la voix des sans-voix avant de créer les premiers foyers d’action sociale et de devenir une figure médiatique internationale de la lutte pour les sans-logis, sa consommation d’amphétamines, son burn-out et sa résilience, son incroyable naufrage, et surtout sa relation platonique et fusionnelle avec […]