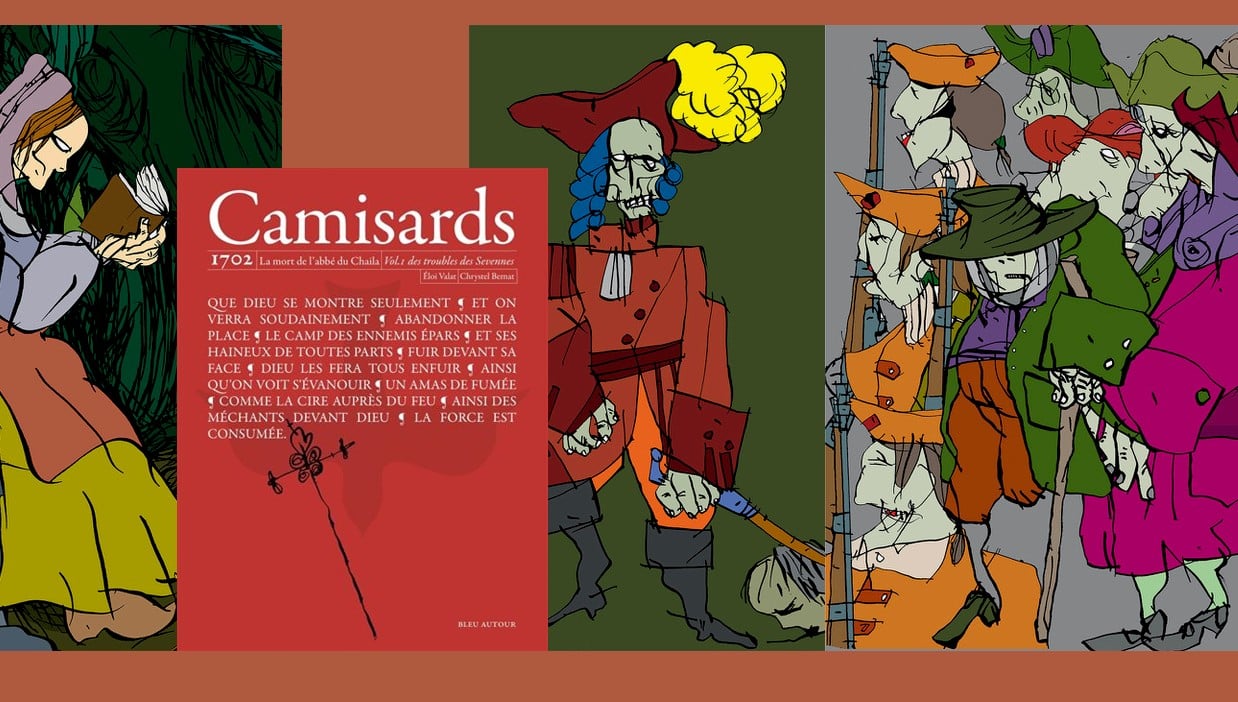Un film sur ce que l’histoire laisse derrière elle et ce qu’elle exige de ceux qui veulent rester debout.
1977. Dans un Brésil tourmenté par la dictature militaire, Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où il espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rodent et planent au-dessus de sa tête.
L’agent secret aurait pu n’être qu’un film d’espionnage à l’ancienne. Mais il est bien plus que cela. Kleber Mendonça Filho compose un récit tendu, presque spectral, où les fantômes de la mémoire collective hantent chaque plan. L’ennemi n’a pas de visage : il est dans les murs, les regards, les silences. Le suspense, sobrement construit, sert à révéler les mécanismes invisibles du pouvoir et les petites compromissions du quotidien.
Un cinéma de la mémoire et de la conscience
Divisé en trois chapitres aux titres évocateurs – Le cauchemar du petit garçon, L’institut d’identification et Transfusion de sang – le film épouse les contours d’un souvenir brisé. Le style est maîtrisé, référencé sans être maniériste, et surtout profondément incarné. Chaque séquence semble interroger : que garde-t-on de l’histoire ? Et que fait-on de ce qu’on garde ? Cette structure narrative, enrichie de références au cinéma des années 70, crée une atmosphère immersive et stylisée. Le film intègre des éléments de cinéma de genre, tels que le « body horror » et le film d’espionnage, tout en rendant hommage à des œuvres emblématiques comme Les Dents de la mer ou L’Exorciste.

Quand la mémoire prend la forme de l’épouvante
Au détour de son récit tendu, L’agent secret n’hésite pas à convoquer l’imaginaire collectif du cinéma populaire, notamment à travers une référence explicite aux Dents de la mer, qui s’affiche en 1977 sur les murs d’un cinéma de Recife. Un petit garçon, témoin silencieux des tensions ambiantes, en dessine les contours, comme si la peur elle-même avait changé de forme. Plus loin dans le film, une jambe humaine, retrouvée dans les entrailles d’un requin, devient une image saisissante : celle d’un pays rongé de l’intérieur, où les disparitions forcées hantent encore les mémoires. Loin d’être un simple clin d’œil cinéphile, cette évocation prend valeur de métaphore, transformant un fait divers en symbole du pouvoir destructeur d’un régime autoritaire. Une manière, pour Mendonça Filho, de montrer que le cinéma populaire peut, lui aussi, porter une charge politique, à condition de savoir où porter le regard.

Une œuvre juste et courageuse
Sans effet appuyé, sans discours surplombant, L’agent secret devient un film sur le courage discret. Celui de ne pas céder à la peur. Celui, aussi, de chercher la vérité là où elle dérange. C’est sans doute une forme d’invitation, qui peut se lire entre les lignes, à penser la liberté comme un chemin de responsabilité, et la mémoire comme une forme de fidélité. En temps de bruit et d’oubli, Mendonça Filho choisit le silence tendu, la tension sourde, la beauté blessée. Il signe une œuvre qui ne crie pas, mais qui reste. Wagner Moura donne en plus à son personnage une humanité fragile, troublée. Ce n’est pas un héros, mais un homme qui doute, qui regarde autour de lui, qui tente — à sa manière — de rester libre dans un monde qui verrouille tout.
La sortie en salles est prévue pour le 5 septembre 2025.