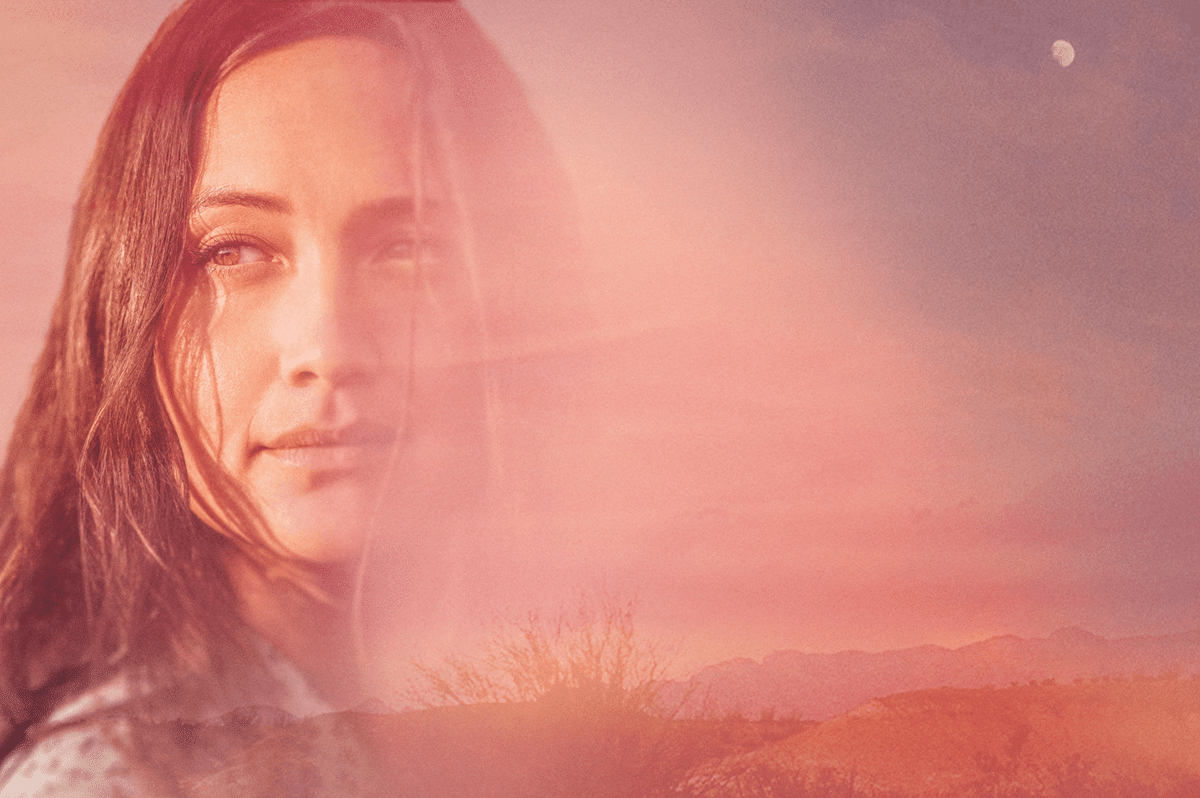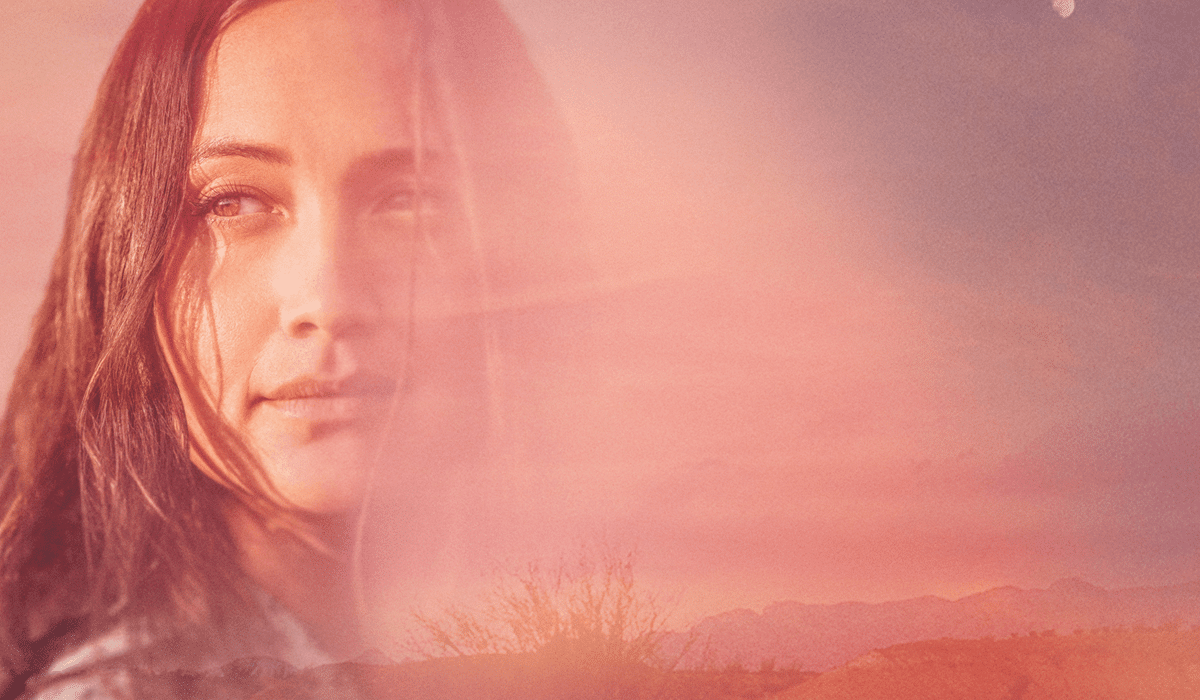Si la première récompense a suscité quelques critiques de journalistes accrédités, la seconde a d’avantage surpris. Ce fut, en tout premier lieu, l’environnement immédiat du Jury œcuménique, mais ensuite le public présent lors de la cérémonie de remise du prix, l’équipe du Festival dont Thierry Frémaux s’est fait l’écho et enfin l’intéressé lui même, Xavier Dolan exprimant son grand étonnement mais surtout son immense joie pleine d’émotions.
Il est vrai que « Juste la fin du monde » n’est pas dans le schéma habituel des prix œcuméniques, et l’espérance n’est pas un élément visible du long métrage… mais… un autre regard peut être porté sur cette histoire familiale douloureuse ouvrant alors à des perspectives très intéressantes. En tout cas, une chose est certaine, « Juste la fin du monde » est encore un excellent film de Xavier Dolan, qui s’est entouré pour l’occasion d’un cinq majeur remarquable au travers de Vincent Cassel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marion Cotillard et Gaspard Ulliel.
L’histoire : Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.
Adaptée de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce, écrite en 1990, cinq ans avant que l’auteur ne succombe aux effets du sida, cette histoire nous plonge au cœur d’une famille en folie, totalement dysfonctionnelle, où l’excès devient la norme. Une outrance qui passe d’abord par les mots, le volume sonore même ou, à l’inverse parfois, un silence brutal et, lui aussi, tout autant étourdissant. Il y a aussi les attitudes, les regards… Et on voit se dévoiler bien vite derrière tout ça les blessures, les cicatrices toujours à vif malgré le temps qui passe ou plutôt à cause du temps qui passe…
Les acteurs, souvent dans un sur-jeu évident et clairement voulu, font des prouesses. Ils captivent le regard, nous font entrer dans leur folie, nous font parfois sourire mais aussi nous font serrer les dents tant la violence verbale peut parfois être intense. Face à Martine (Nathalie Baye), la mère hystérique et peinturlurée, Antoine (Vincent Cassel), le frère amer, brutal, grossier et Suzanne (Lea Seydoux), la sœur paumée à tout niveau et camée par dessus tout, Catherine (Marion Cotillard), l’épouse d’Antoine demeure extrêmement émouvante. Pleine de tendresse et en rupture visible avec les excès de part et d’autre, elle s’englue dans une impossibilité à exprimer ce qui semble bouillonner au fond d’elle et accepte son rôle de souffre-douleur. Et puis il y a Louis (Gaspard Ulliel), l’enfant prodigue, l’homosexuel sophistiqué et brillant, au regard d’une douceur frappante, qui devient une sorte d’observateur aimé et malmené… mais hélas silencieux alors que pourtant il est venu dire… bloqué par ce qu’il confesse à un moment : « J’ai peur d’eux ! ».
Car finalement c’est le « non-dit » qui est l’ombre planante et constante. Que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, l’incommunicabilité l’emporte et détruit tout sur son passage. Xavier Dolan désigne ainsi là clairement l’ennemi qui ronge les relations et la famille en particulier. Toutes ces choses qu’il ne faut pas verbaliser mais qui empêchent d’aimer. Car finalement, on se demande où est l’amour ? Y en a-t-il d’ailleurs dans tout ce capharnaüm grotesque ? Peut-être, quand même, le voit-on apparaître dans les quelques éclairs de lumière subtils et éphémères qui se manifestent parfois, telle qu’une scène improbable faite de souvenirs des dimanches en famille et d’une chorégraphie sur le tube d’Ozone « Dragostea Din Tei », ou une étreinte mère-fils qui vient après cette affirmation de Martine à Louis « Je ne te comprends pas, mais je t’aime… et ça personne ne pourra me l’enlever » où apparaît alors un autre visage de la mère. Comprendre et plus encore, connaître… un mot qui revient comme un leitmotiv régulier tout au long de l’histoire dans la bouche des uns et des autres. Car finalement qui se connaît dans cette famille, et qu’est ce connaître l’autre ?
Et puis, il faut le préciser, Juste la fin du monde est un véritable huis clos, au sens propre et figuré. Bien-sûr il y a cette sublime scène de voiture où les deux frères s’échappent de la maison pour « prendre l’air » et pour pouvoir parler. Mais c’est pour mieux s’enfermer encore dans un autre espace clos et étouffant et dans une impossibilité de communiquer. D’ailleurs Antoine le crie à son frère tout en conduisant : « Les gens qui disent rien, on pense qu’ils aiment écouter. Moi j’aime pas parler. J’aime pas écouter… J’veux qu’on m’foutte la paix ! ». Cet enfermement qui va jusqu’au bout, jusqu’à la fin… jusqu’à la dernière scène où, dans une magnifique métaphore, l’oiseau cherche à s’échapper lui aussi… mais…
Et tout ça est réalisé par un Xavier Dolan qui confirme à chaque film sa dimension artistique énormissime. Il y a un talent fou qui s’exprime dans sa façon de filmer, suivre les acteurs aux plus près, jouant avec les mises au point, les angles de vue… et utiliser une lumière qui colle parfaitement à l’histoire de ce huis clos terrifiant. Et la musique enfin, du maître Gabriel Yared (dont je suis archi fan faut il le préciser ?) et de quelques morceaux aux accents de clip, vient, telle une pierre précieuse, habiller, voire déshabiller l’histoire. Il y a du rythme, des cassures, de la rapidité et en même temps une certaine lenteur désinvolte. Paradoxal me direz-vous ?… Oui évidemment. À l’image de Xavier Dolan sans doute et de son œuvre d’une beauté rare mais pas toujours suffisamment comprise.