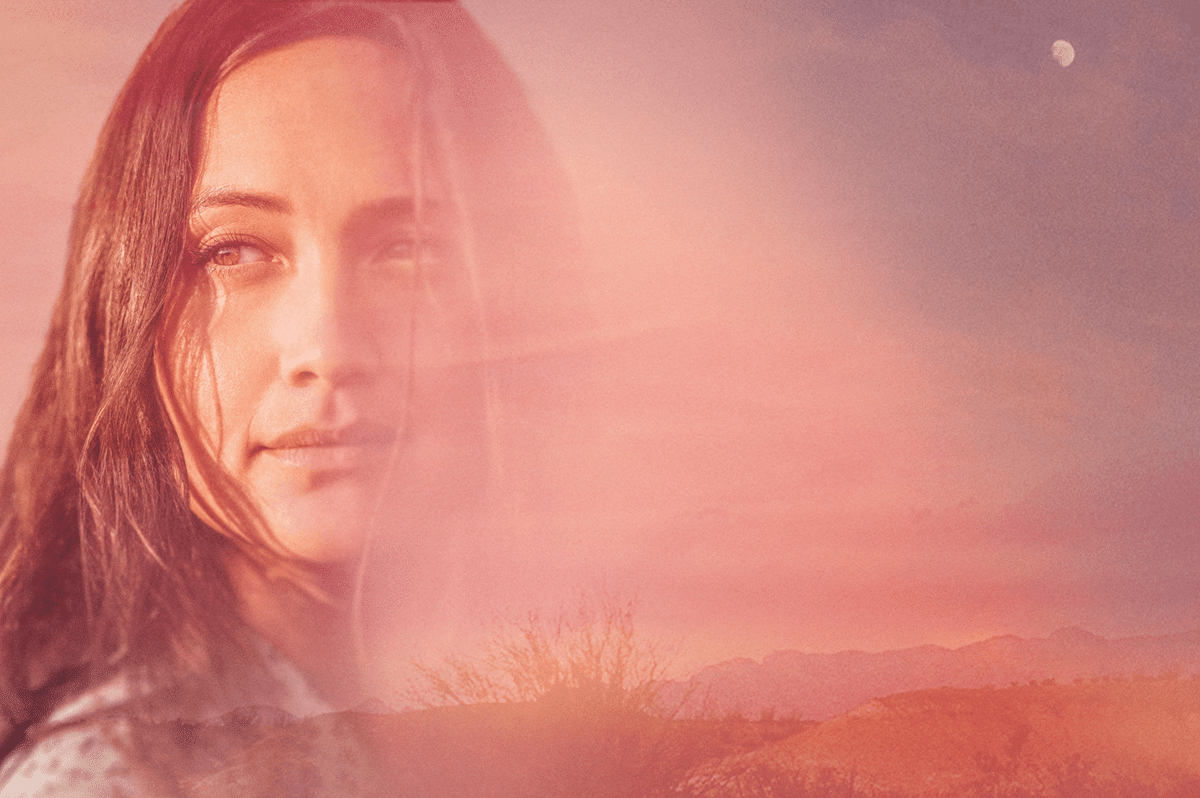Ce n’est pas toujours la fête, comme on l’entend, au Festival de Cannes. Si certains films vous font sourire ou évoquent la beauté de la vie, d’autres (et c’est le cas de pas mal de propositions dans un Festival comme celui-ci) vous plongent dans une certaine forme d’obscurité ou de dureté, parfois tout simplement par le sujet abordé ou la manière de le faire.
Mais cela peut aussi prendre des allures étonnantes, voire bouleversantes. Constat qui colle parfaitement à la citation de l’oscarisé réalisateur américain Jonathan Demme : « Le cinéma a trois fonctions vitales. Primo : divertir, et c’est une noble entreprise. Secundo : faire réfléchir grâce à une fiction qui ne privilégie pas seulement le divertissement. Tertio : être un miroir de l’existence. ». Une réflexion offerte qui relève sans doute de la grâce et un étonnant miroir de l’existence, voilà les ingrédients de deux films que j’ai pu voir hier, tous deux dans la Compétition officielle.
Les herbes sèches
Avec Les herbes sèches (Kuru Otlar Ustune) du cinéaste Turc Nuri Bilge Ceylan qui avait obtenu la Palme d’or pour Winter Sleep, c’est un long voyage en Anatolie et dans la désespérance… du moins, pour être plus précis, dans la « lassitude d’espérer », comme le dit très joliment l’une des héroïnes de l’histoire.
Samet (Deniz Celiloglu) est un jeune enseignant en poste en Anatolie orientale. Alors qu’il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d’événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu’au jour où il rencontre Nuray (Merve Dizdar), jeune professeure comme lui…
Dans ces quelques 3h15 de film, le sentiment fort qui se dégage est une forme de d’épuisement général. De ceux qui se sont battus obstinément pour les causes auxquelles ils croient, de ceux qui ont abandonné leur combat perdu d’avance, de ceux qui essaient simplement d’arriver au lendemain en un seul morceau, corps et âme… Ce n’est d’ailleurs pas le cas de Nuray (Merve Dizdar), une éducatrice, artiste et militante de gauche qui a perdu sa jambe dans une explosion, et qui est devenue enseignante d’anglais.

Parmi ces gens qui ressentent cette fatigue, il y a Samet (Deniz Celiloglu), un professeur d’art cynique qui retourne dans son petit village enneigé pour continuer son travail après les vacances scolaires ou, disons, pour y mettre un terme une fois pour toutes. Rêvant d’être transféré dans une école d’Istanbul, Samet est coincé à ce poste obligatoire depuis quatre ans, attendant avec impatience son départ qui se rapproche à grands pas. Son colocataire, Kenan (Musab Ekici), semble plus satisfait de son poste dans cet endroit reculé au climat rude et aux réalités politiques injustement dures pour les populations kurdes de la région.
Avec ses personnages et leurs interactions se construit, entre autres, une critique tacite des systèmes sociaux et gouvernementaux qui sapent l’énergie et les idéaux des fonctionnaires qui ont quelque chose à apporter à leurs semblables et aux enfants vulnérables. Il demeure un soupçon de sentiment que tout n’est pas totalement perdu, suggéré tout au long des magnifiques montages des clichés photographiques de Samet – des images composées avec soin des paysages environnants et de visages qu’il prétend détester mais qui sont d’une redoutable beauté – ponctuant les actes du film qui se déroulent tout en douceur.
Et finalement ce titre Les herbes sèches pourrait nous renvoyer au livre d’Ésaïe chapitre 40, dans la Bible : « L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » C’est peut-être là que finalement pourrait rejaillir une envie d’espérer.
The Zone of Interest
Cannes a peut-être déjà sa Palme d’Or 2023… ou du moins certainement une ligne à son Palmarès avec ce film choc The Zone of Interest de Jonathan Glazer qui aborde d’une toute nouvelle façon l’horreur de l’Holocauste ou des atrocités perpétrées par les nazis. Une vision du cinéaste qui nous place dans le Hors-Champs pour révéler le pire et nous ouvrir les yeux sur ces réalités avec une perspective osée et surprenante.
Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Trois premières minutes d’un écran noir, musique à l’appui, comme un sas de compression vers l’horreur et sa banalisation complète.
C’est un dispositif glaçant, franchement redoutable que propose le réalisateur britannique. C’est l’immersion douce et tranquille au sein d’une famille apparemment comme les autres, qui pique-nique et joue près d’un lac immaculé quelque part, d’après leurs vêtements, en Europe. Alors qu’ils rassemblent leurs affaires et rentrent chez eux, le scénario commence à se dérouler. Nous sommes dans les années 1940 et cette famille, chose incroyable, vit juste à côté d’un camp de concentration. Et leur maison appartient à nul autre que le tristement célèbre commandant d’Auschwitz lui-même, Rudolf Höss.

En s’inspirant partiellement du roman éponyme de Martin Amis paru en 2014, Glazer nous laisse évoluer dans cette vie quotidienne de Höss (Christian Friedel), de sa femme Hedwig (Sandra Hüller) et de leurs cinq enfants.
La maison familiale est un vrai petit paradis. Alors que les enfants jouent dans le jardin, le bruit ambiant des horreurs qui se déroulent de l’autre côté du mur est omniprésent. Les exécutions, les cris et les grondement presque ininterrompu des fours crématoires. Ce sont aussi les fumées noires qui s’échappent d’une cheminée que l’on voit au loin…
Nous pourrions facilement supposer que quelqu’un comme Höss, ou ses collaborateurs directs, un homme qui a été responsable de la mort de plus d’un million de Juifs, serait insensible naturellement à la souffrance de ses victimes. Mais ici, l’horreur va plus loin car elle s’élargit avec une forme de logique implacable.
C’est ainsi l’inhumanité flagrante et assurée de sa femme ou la façon dont ses amies fouillent dans les vêtements volés des prisonnières, mais aussi la facilité avec laquelle leurs propres enfants l’occultent. La seule personne qui semble montrer une once de remords est la mère d’Hedwig (Imogen Kogge) qui, lors de sa première visite, ne peut ignorer la lueur cuivrée de la fournaise de l’autre côté de la clôture qui paraît à travers la fenêtre de sa chambre.
Ce hors champ proposé et le travail sur le son nous glacent le sang. C’est une forme de sidération qui se développe alors chez le spectateur, avec un choix d’actualiser ses propos à la fin du film, afin de mieux nous permettre de réfléchir au fait que ce scénario n’est pas si éloigné de certains actes commis dans notre propre société aujourd’hui.
C’est un film qui offrira des possibilités uniques d’échanges. Un film plein de détails et de choix créatifs qui susciteront débats et passions. Franchement bravo !