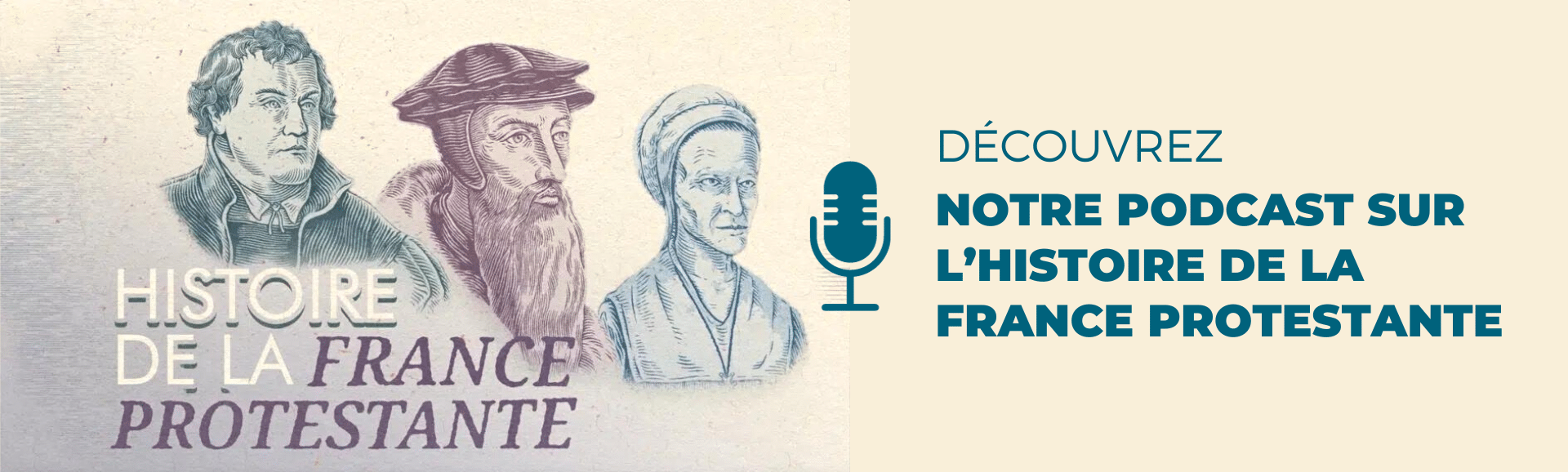On peut voir, en ce moment, à Paris, deux expositions de photographes qui se sont limités à scruter un petit espace, qui les touche de près, pour construire leur œuvre. Et la grandeur et la force de leur travaux respectifs est de nous parler du proche, du familial, du terroir, pour s’élever, chemin faisant, à l’universel. Ils font, ainsi, penser au titre de la fameuse conférence de Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ».
Whrigt Morris à la fondation Henri Cartier-Bresson (jusqu’au 29 septembre)
Donnons quelques détails. Tout d’abord Whrigt Morris (1910-1998), dont l’œuvre écrite est plus abondante que l’œuvre photographique. Quand il a photographié, il est retourné au Nebraska (ou dans ses parages), là où il a passé son enfance. Il nous fait voir des bâtiments abordés frontalement et dépourvus de présence humaine. Cette présence est renvoyée aux textes qui faisaient le pendant aux photos, dans des livres expérimentaux dont on peut consulter des extraits. Cette région du Midwest où son grand-père vivait encore quand il l’a photographié (pour une fois ! mais de dos) a tout de l’Amérique profonde. Morris a, pour sa part, largement sillonné l’Amérique et au-delà. Quand il revient sur la terre de ses racines, l’exode rural est passé par là. Le regard est tout à la fois nostalgique et distancé. On lit, dans ses photos, en creux, l’impossible dialogue entre deux Amériques qui s’affrontent, aujourd’hui encore, dans les urnes, dans le champ culturel. Nulle dénonciation dans son travail. Il restitue la vie d’une petite ville du Nebraska dans sa quotidienneté. Il en parle comme d’un univers familier. En même temps, on sent qu’il est ailleurs. C’est l’aventure d’une vie qu’il nous raconte : confesser notre dette à l’égard de nos racines et, néanmoins, avoir la liberté d’aller dans une autre direction. « Ce n’est pas toi qui porte la racine, c’est la racine qui te porte », comme l’a écrit l’apôtre Paul (Rm 11.18). Mais l’arbre ne se résume jamais à sa racine.
Sally Mann, au Jeu de Paume (jusqu’au 22 septembre)
Sally Mann, d’une autre génération (elle est née en 1951), a construit la grande majorité de ses projets dans sa Virginie natale. Elle a vécu, elle aussi, dans d’autres lieux. Mais, d’une manière encore plus délibérée que Whrigt Morris, elle choisit de nous montrer le monde à partir d’un point d’observation qui, vu de France, semble minuscule.
Elle tourne, d’abord, autour de la maison de vacances de sa famille. On s’aperçoit, dès ce moment, que ses photos n’ont pourtant rien de banal. Elle nous parle de notre enfance, de ce qu’il nous en reste et de ce que nous avons laissé de côté, à travers les scènes qu’elle immortalise. Puis elle va un pas plus loin. La Virginie a été le théâtre de nombreux combats pendant la guerre de Sécession. Sally Mann retourne sur le lieu de ces combats. Elle ne reconstitue rien. Elle utilise simplement un procédé photographique de l’époque qui donne des clichés parsemés de tâches et de rayure. Il ne reste que des prairies paisibles. Le temps qui s’est écoulé nous saute à la figure. Et ce « sud profond » qu’elle nous raconte garde un côté mystérieux et inquiétant. L’esclavage qui fut le motif de la guerre, et le racisme qui lui a succédé, affleurent. Elle décide d’aller à la rencontre d’hommes noirs et de faire retour sur les relations naïves et complexes qu’elle a noué avec sa nounou noire quand elle était jeune.
L’histoire a traversé et traverse encore ce quotidien. Elle est là, à portée d’objectif, pour qui accepte de regarder.
Tout près de toi est la parole
Ces partis pris me parlent. Tout ce qui fait les grandes questions qui agitent nos vies se trouve à notre porte. L’histoire n’est pas une réalité abstraite qui nous surplombe : elle traverse notre existence et nous en sommes partie prenante. Elle est le fruit du positionnement et du rôle joué par chacun à sa mesure. Les allers et retours que nous effectuons nous donnent du recul, nous permettent de voir les choses différemment, mais ils nous ramènent là où nous sommes et nous interrogent jusqu’au plus près de ce que nous vivons.
Or, la tentation de penser que la solution est ailleurs, et loin de nous, est tenace. Ou bien on considère que ce sont d’autres, dans des palais ou des centres d’affaire lointains qui peuvent faire « quelque chose », tandis que le citoyen de base est impuissant. Ou bien, devant les limites et les faillites que nous expérimentons, on va chercher dans des pays lointains, dans des cultures méconnues, des sagesses nouvelles, parce que celles que nous pratiquons sont en échec. Ou encore, on va chercher dans le dépaysement une solution à nos coups de déprime. Se rêver ailleurs est souvent une fuite. Le regard des autres, des autres cultures, est instructif et souvent salutaire. Mais le lieu de notre engagement, là où nos responsabilités sont les plus grandes, est ici et maintenant.
En fait, en sortant de ces expositions, le texte du Deutéronome m’est, presque naturellement, revenu en mémoire : « Ce commandement que je te donne aujourd’hui n’est pas trop difficile pour toi, il n’est pas hors d’atteinte. Il n’est pas au ciel ; on dirait alors : « Qui va, pour nous, monter au ciel nous le chercher, et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? » Il n’est pas non plus au-delà des mers ; on dirait alors : « Qui va, pour nous, passer outre-mer nous le chercher, et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ? » Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique » (Dt 30.11-14).
Aucun des deux photographes dont je parle ne se réclame de la foi chrétienne. Mais ils nous rendent sensibles au fait que les appels essentiels qui nous sont adressés se jouent immédiatement dans ce qui est (et ceux qui sont) les plus proches de nous. C’est là, déjà, que les choix essentiels s’opèrent.