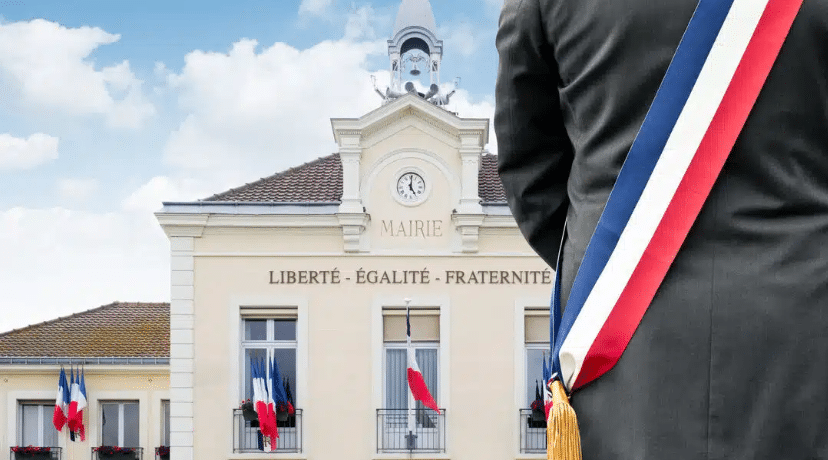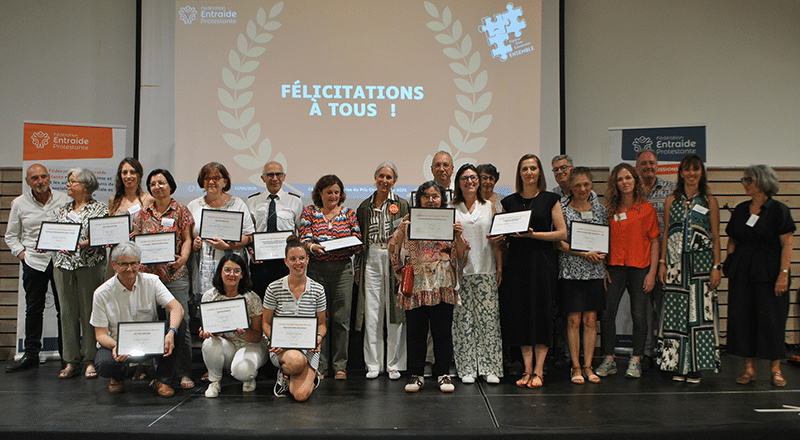Si son film est motivé par ce qui semble être une saine colère à l’égard du traitement des femmes dans son pays majoritairement musulman, Haroun choisit de s’intéresser plus spécifiquement à l’histoire de deux femmes et de traiter les sujets éthiques par le prisme de leurs expériences passées et actuelles. On pourrait ainsi dire que Lingui est une sorte d’écho lointain à Un homme qui crie qui explorait la relation entre un père et son fils sur fond de guerre civile. Cette fois-ci, la relation est celle d’une mère et de sa fille, avec pour toile de fond le climat religieux, culturel et juridique particulièrement oppressant pour les femmes dans son pays.


Dans ce jeu d’oppositions que le réalisateur met en place, vient aussi le pari de l’espérance, même si la situation de ces femmes demeure désespérée. Car elles évoluent toutes dans un environnement qui les limite et les contrôle ; lorsqu’Amina regarde un ciel nuageux comme si elle rêvait de s’échapper, la caméra la filme d’en bas, de sorte que nous ne pouvons que voir les murs qui l’entourent de tous côtés. Mais pourtant une espérance fleurît dans ce desert… elle coûte cher, on le comprendra, mais est tout de même bien présente de multiples fois dans le scénario. Elle passe notamment par d’autres personnes sur les chemins arides de cette mère et de sa fille… car, au cœur des ténèbres, subsistent toujours des parcelles éclairantes et résistantes. Une espérance qui surgit dans la possibilité d’une réconciliation, dans le refus de croire que le passé écrit inévitablement le futur.
Lingui, les liens sacrés se refuse à entrer dans une démarche polémique ; ils se contentent de suivre ses personnages et de laisser le public accompagner ce que ces femmes traversent, et c’est sans doute là que réside la puissance émouvante du film. Le scénario de Haroun est en fait extrêmement habile, construit toujours dans une certaine subtilité. Certains regretteront peut-être l’happy-end un peu facile. Mais, après tout ce qui a précédé, on ne peut pas vraiment en vouloir à ces femmes d’avoir au moins une brève vision de la liberté… tiens, c’est sans doute aussi là que l’espérance pointe à nouveau et ultimement le bout du nez.