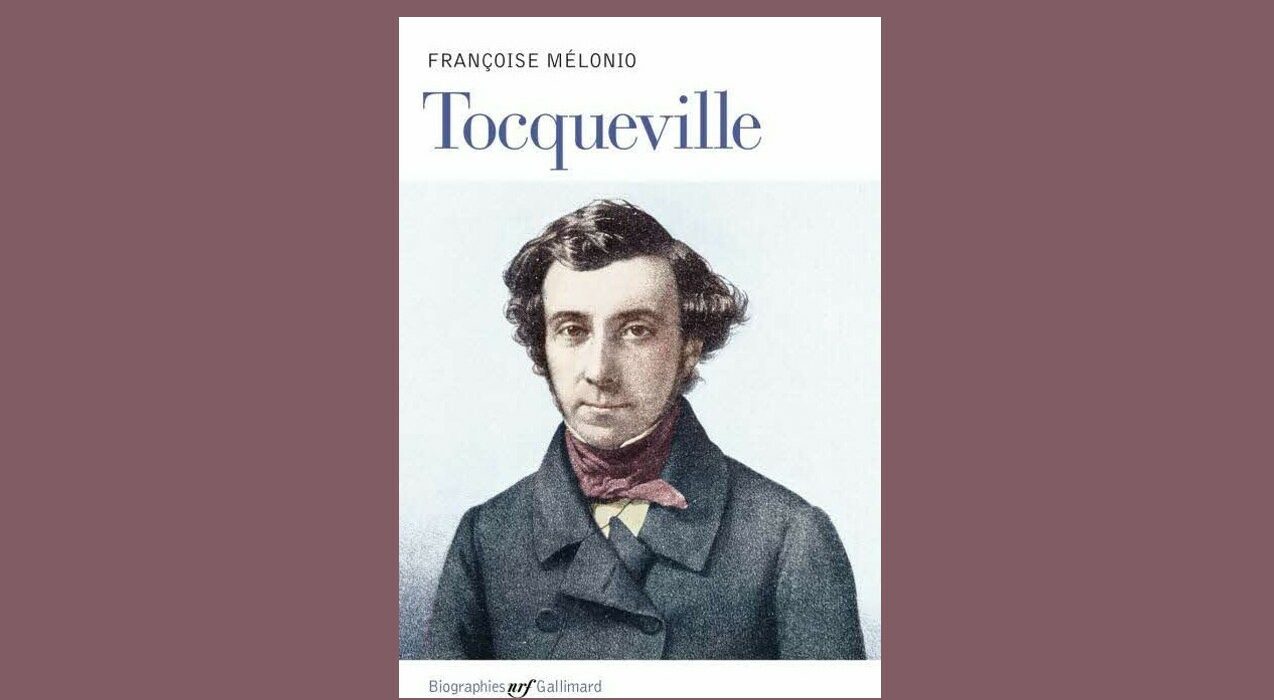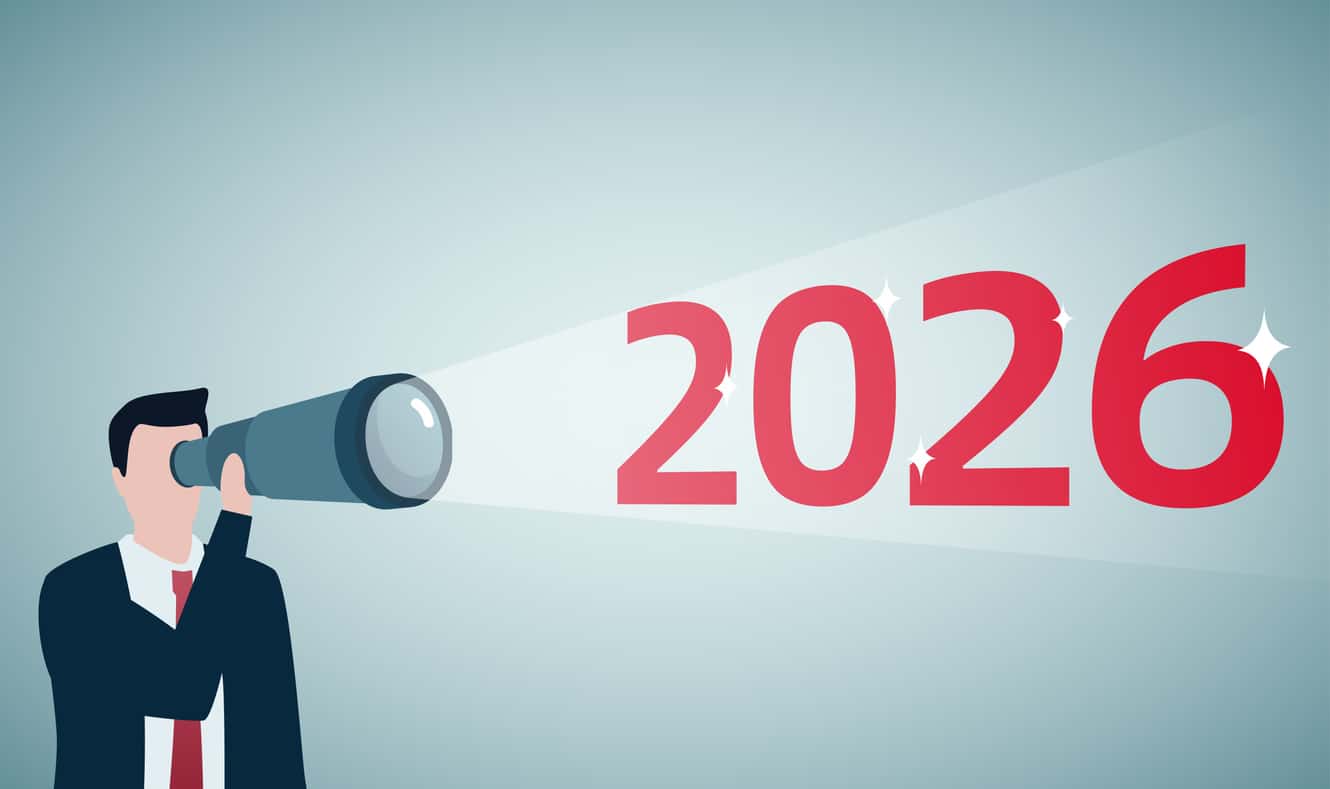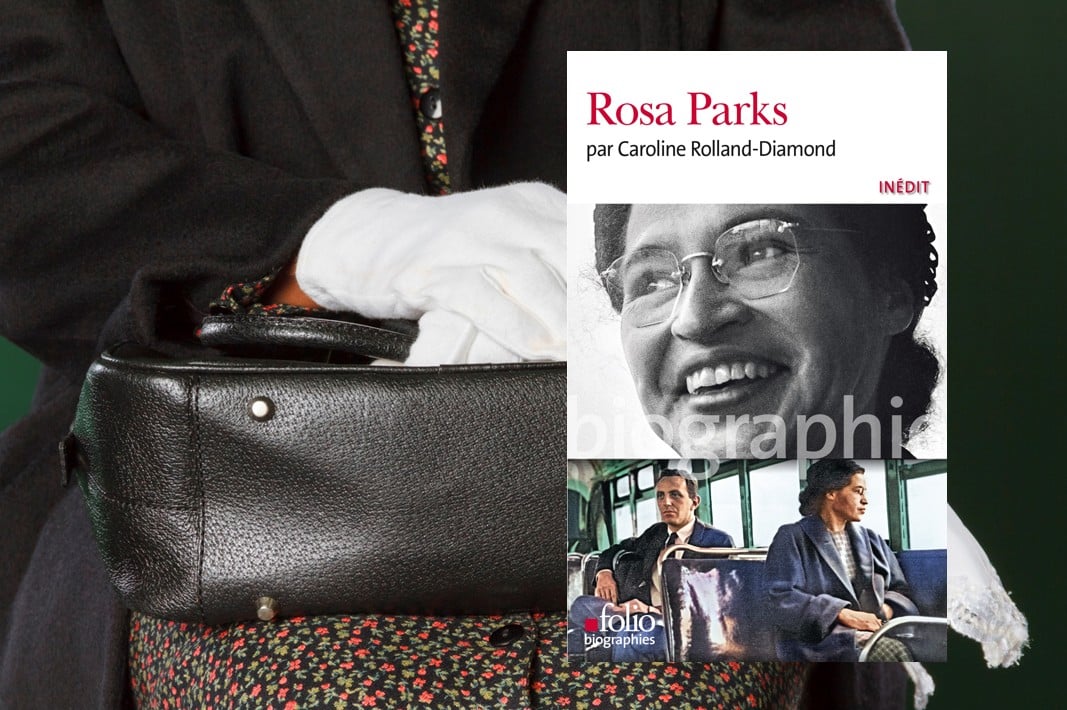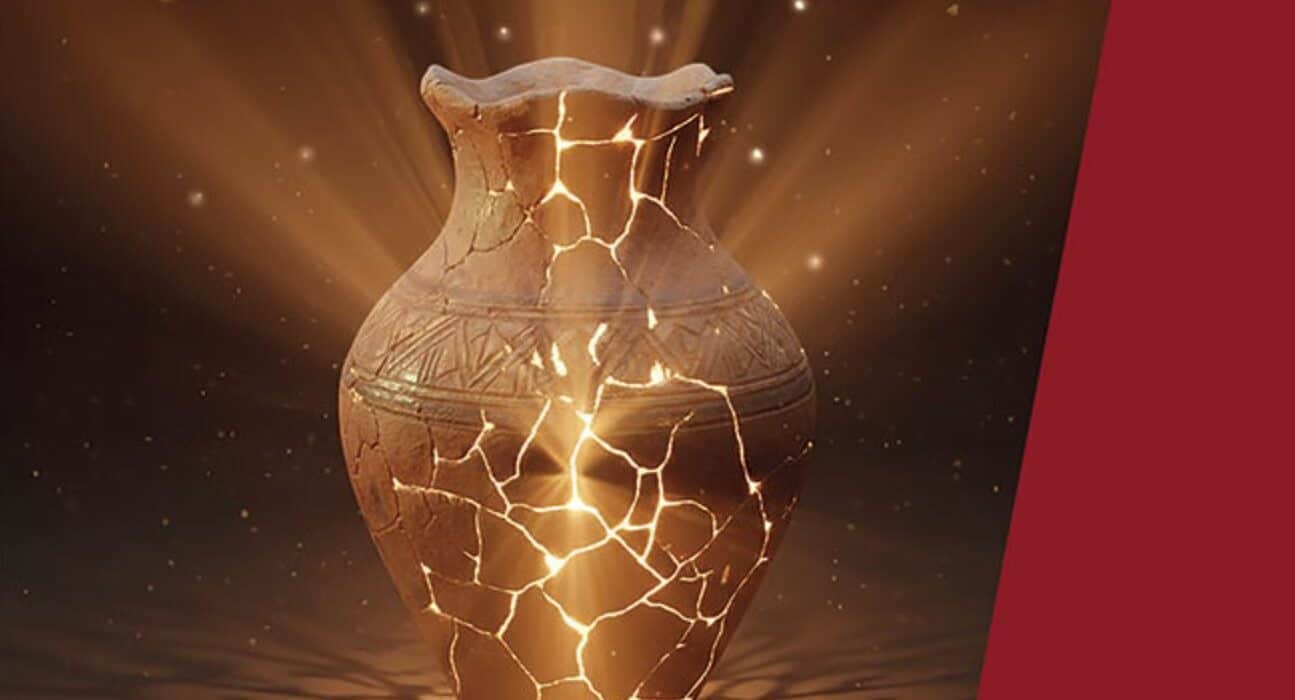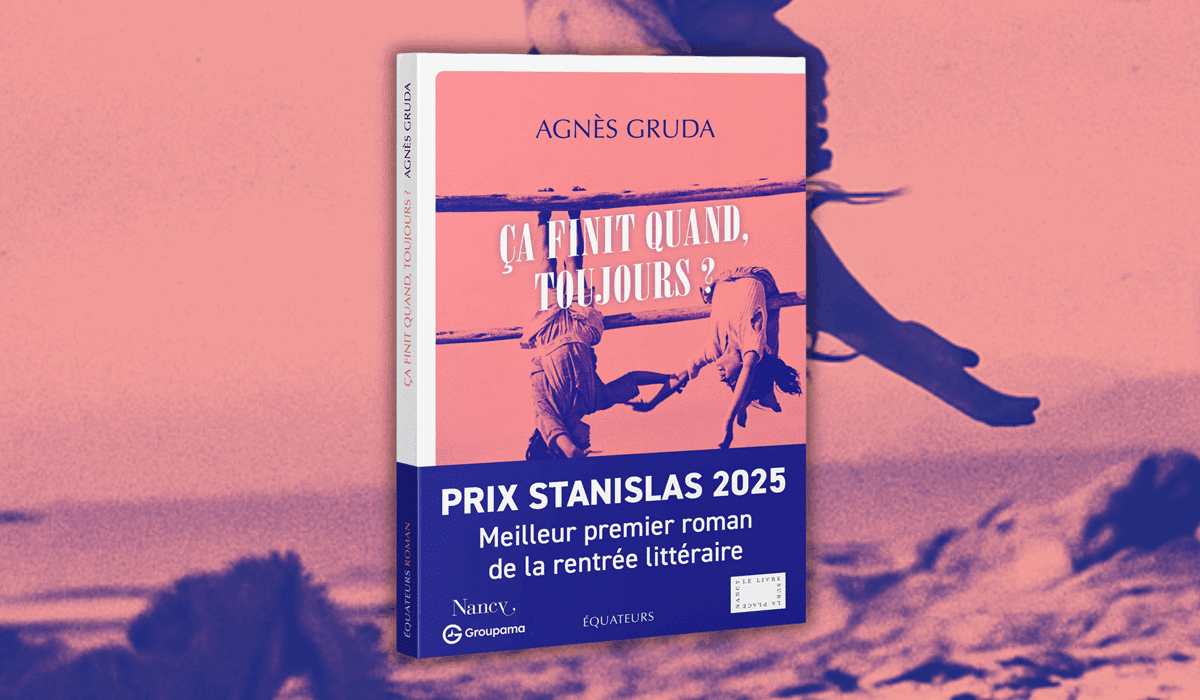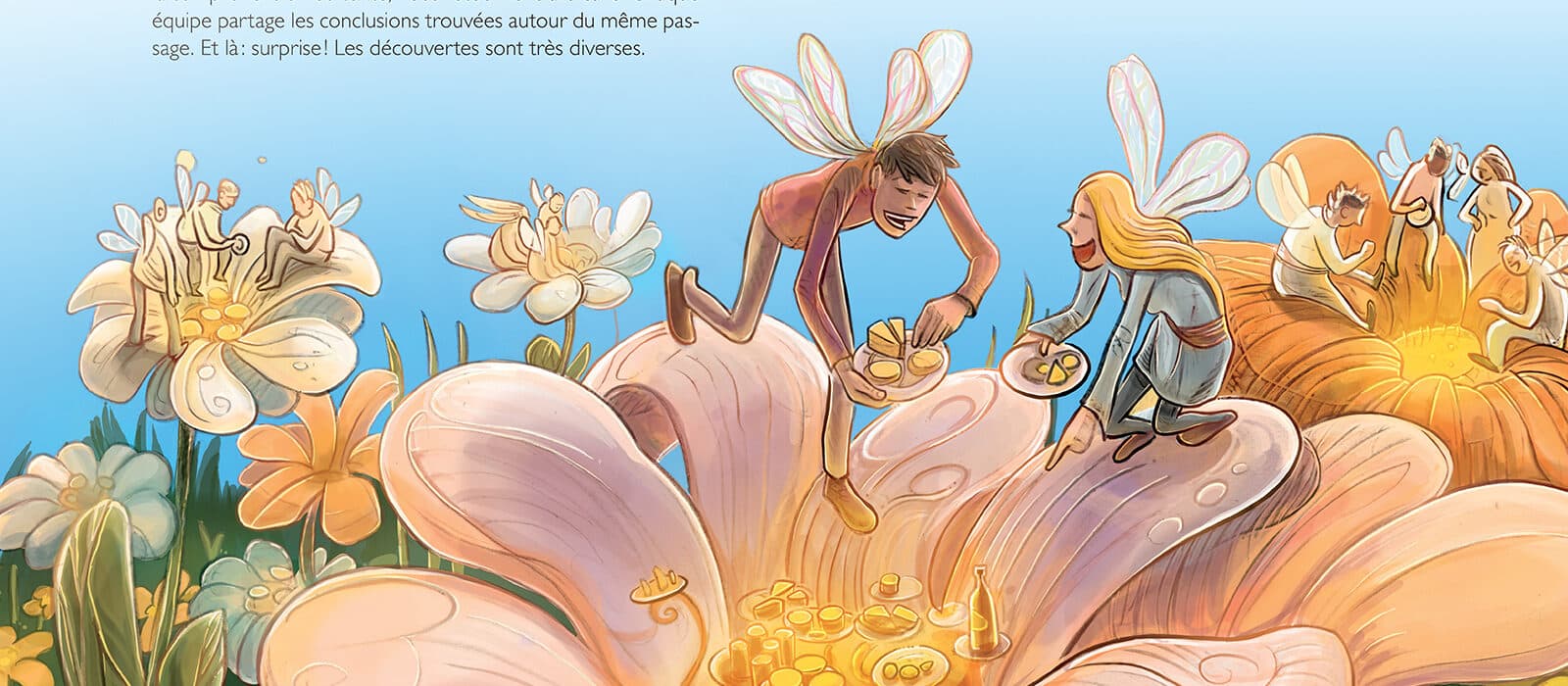C’est un nom magnifique, un drapeau qui claque au vent de l’avenir, un mouvement d’idées qui roule carrosse. Alexis de Tocqueville ! A ce nom s’ajoute un bouquet d’intuitions qui parlent d’un prophète politique, à tout le moins d’un spécialiste en prémonitions. Mais alors attention. N’allez pas vous égarer. Monsieur le comte a plus d’un tour dans son sac, et ses disciples eux-mêmes savent que leurs certitudes peuvent, un jour, aller se briser le nez sur une sentence de leur maître. Ainsi va Tocqueville, homme libre qui cherche, qui trouve, imagine, et cherche encore. Françoise Mélonio, professeure émérite à la Sorbonne, lui consacre une biographie passionnante, un régal de lecture. Un bon livre ne se résume pas en quelques lignes. Coup de chance, Françoise Mélonio explique à Regards protestants les particularités de cet intellectuel hors du commun. Du dix-neuvième siècle ? Quelle blague ! Alexis le grand n’est pas d’aujourd’hui mais déjà de demain.
Aux origines d’Alexis de Tocqueville : un héritage entre fidélité et émancipation
Tout a commencé le 29 juillet 1805 – ou pour mieux dire le 11 Thermidor an XIII – à Paris. Alexis Charles Henri Clérel naît de Hervé Clérel et de Louise Madeleine Le Peletier de Rosambo. L’aristocratie berce le bébé dont les parents manquèrent de peu la mort sous la Terreur. Mais la fidélité à l’Ancien régime quitte bien vite l’esprit de ce cadet de famille. « Il y a quelque chose d’étonnant dans sa bifurcation précoce, admet Françoise Mélonio. Son père était un préfet légitimiste vigoureux, son frère aîné, Edouard, a toute sa vie suivi la voie traditionnelle, favorable à Louis XVIII et Charles X, plus tard favorable au Second Empire. » Alexis serait-il un rebelle ? Pas du tout. « Je crois que sa famille a très tôt reconnu sa précocité intellectuelle, précise Françoise Mélonio. Non seulement son père ne s’est pas opposé à ce qu’il prête serment à la Monarchie de Juillet, mais il fut l’un des premiers lecteurs-correcteurs de « La démocratie en Amérique » et, quoiqu’il l’ait trouvé abusivement démocrate, bien qu’il l’ait souhaité plus modéré, ce monarchiste a autorisé son fils à explorer des pistes nouvelles. On peut penser que cette forme de tolérance ait été le plus beau legs du grand homme de la famille, Malesherbes, qui avait été le protecteur de l’Encyclopédie, qui avait protesté contre la levée des impôts par la monarchie, mais défendu Louis XVI devant la Convention – ce qui lui avait finalement coûté la vie. »
Nous n’allons pas raconter toute la vie, toute l’aventure de Tocqueville, grand voyageur à l’intelligence vivace. Tout le monde connaît, de réputation, deux de ses ouvrages majeurs : « De la démocratie en Amérique » (en deux volumes, parus en 1835 et 1840) et « L’Ancien Régime et la Révolution », dont la première partie seulement parut de son vivant. « Il travaillait suivant la technique d’un enquêteur, constate Françoise Mélonio. Mais il ne partait jamais l’esprit tout à fait vierge. Il rédigeait préalablement des questions qu’il appelait des idées mères, puis il adaptait son discours en fonction de ce qu’il observait sur place. On peut donc dire que cet homme d’intuition vérifiait ses théories sur le terrain, quitte à faire évoluer sa pensée quand il rentrait chez lui. Cela explique le style porté à la généralisation, ce que lui reprochaient ses adversaires. »
Un penseur engagé
Bien entendu, Tocqueville passe aujourd’hui pour le grand défenseur de la liberté. Cet engagement, plus audacieux que celui d’un Guizot – l’écrire ainsi nous fait souffrir, tant nous aimons, nous les protestants, protéger les nôtres, sans en faire une religion…– mais il rejetait toute violence collective – au souvenir, sans doute, des victimes familiales de la Terreur. Peut-on dire qu’il était réformateur avec passion ?
« A la différence de Marx, il considérait que les garanties institutionnelles peuvent être protectrices et que la participation politique permet de réduire les inégalités, souligne Françoise Mélonio. Il n’inscrivait pas sa pensée dans le cadre d’un conflit des classes, mais il estimait que le système représentatif doit permettre de prendre en compte les intérêts des autres classes, notamment des plus pauvres. »
Foi en les institutions
En lisant le livre de Françoise Mélonio, nous suivons le cours d’une réflexion plus riche et plus subtile que l’on croit souvent. Tenez… Choisissons la question de la place de l’Etat. Rien ne serait plus faux que de classer Tocqueville parmi les ancêtres de la dérèglementation tous azimuts. Il est favorable à la décentralisation administrative, mais trouve essentiel de préserver l’Etat centralisateur sur un plan politique. « Aristocrate, il a, très ancré en lui, le sentiment de bénéficier d’une position sociale particulière, analyse notre interlocutrice. Il vit parmi les élites sociales, nobles et bourgeoises, il fréquente les salons parisiens de son temps. Mais quand il est en Normandie, dont il est l’élu, c’est la France périphérique, très rurale, démunie, qui devient son champ d’action. Or, quand il se bat pour que le chemin de fer parvienne jusqu’à Cherbourg, il se rend compte que l’Etat, seul ou presque, peut rendre possible un tel projet. De la même façon, s’il est favorable au commerce, il est bien conscient que ses administrés, la plupart éleveurs, ont besoin d’être protégés. » Tocqueville n’est donc pas du tout hostile à l’Etat, n’en déplaise à Friedrich Hayek théoricien de l’ultralibéralisme qui lui a chipé l’expression « La route de la servitude », comme titre d’un de ses livres.
État, religion et pouvoir chez Tocqueville
Sur la question coloniale aussi, Tocqueville se montre plus que clairvoyant : il pressent que l’injustice favorise l’émergence d’un nationalisme arabe. Creuser la différence entre les églises chrétiennes n’est pas la priorité de ce grand visionnaire. Tout juste pense-t-il que les sociétés sans religion se trouvent condamnées à une forme de déclin et que l’évolution démocratique conduit naturellement à simplifier les rites. Le grand Alexis, catholique bon teint dans sa prime jeunesse, fréquente des protestants. D’abord aux Etats Unis, puis en Angleterre, en Irlande enfin. Pas sûr qu’il soit plus convaincu par eux que par d’autres. En Irlande, il observe le renversement des rapports dominants-dominés, quand il arrive sur l’ile conquise par les Britanniques. « Tocqueville remarque que les catholiques irlandais sont démocrates parce qu’ils sont du côté des dominés, souligne Françoise Mélonio. Mais il craint que le clergé ne soit pas libéral, alors que les protestants, libéraux par ancrage, se montrent aristocrates par volonté d’asseoir leur pouvoir. »
Une pensée vivante, entre héritage et modernité
A cet endroit du récit, peut-être vous interrogez-vous : la promesse d’origine, un Tocqueville qui serait notre contemporain, voire un bon guide pour imaginer notre avenir ne paraît-elle pas mal tenue ? Au fond, peut-être pensez-vous que cet aristocrate éclairé, plus fidèle à l’esprit des Lumières qu’à ce que l’on appelait la Légitimité, vaut le détour, certes, mais n’intéresse que celles et ceux qui veulent connaître l’histoire de la pensée.
Souffrez que nous abordions la chose autrement. Réhabilité par les adversaires du totalitarisme, d’un côté par Raymond Aron, aujourd’hui Pierre Manent, de l’autre par Claude Lefort, de nos jours Marcel Gauchet, ce penseur d’autrefois peut encore nous inspirer. Convaincu que l’accès à la propriété privée permet l’autonomie mais aussi la protection de chaque individu, Tocqueville ne méconnaît pas les impossibilités des plus pauvres d’atteindre un tel objectif. Pour cela, sans être socialiste, il se montre favorable à l’économie sociale par des réseaux de solidarité locale. A cela s’ajoute sa volonté de créer ce que Françoise Mélonio appelle un choc fiscal. Dans une lettre datée de 1847, il écrit qu’il convient de « remanier tout le système de manière à diminuer les charges des pauvres en augmentant un peu celle des riches, et à retrouver d’un côté ce qu’on sacrifie de l’autre, de sorte qu’on arrivât en même temps, à remettre de l’ordre dans les finances et à exonérer le travail. » Nous n’irons pas jusqu’à prétendre qu’il est plus à gauche que Sébastien Lecornu, mais à coup sûr Bernard Arnaud le traiterait de gauchiste.
Toute plaisanterie mise à part, Alexis de Tocqueville pensait plus loin que son propre intérêt. « Il était animé d’une volonté, d’un optimisme farouche, souligne Françoise Mélonio. Ne désespérant jamais de la politique, il a toujours souhaité contribuer à l’avènement d’un monde politique différent, et pour cela diffuser son œuvre au plus grand nombre, afin qu’elle génère à son tour d’autres idées. » Cette œuvre est toujours vivante parce qu’elle ouvre les fenêtres, invite à lutter contre les dogmes. Alexis de Tocqueville ? Un nom presque protestant
A lire : « Tocqueville » par Françoise Mélonio, Gallimard, 614 p. 27 €