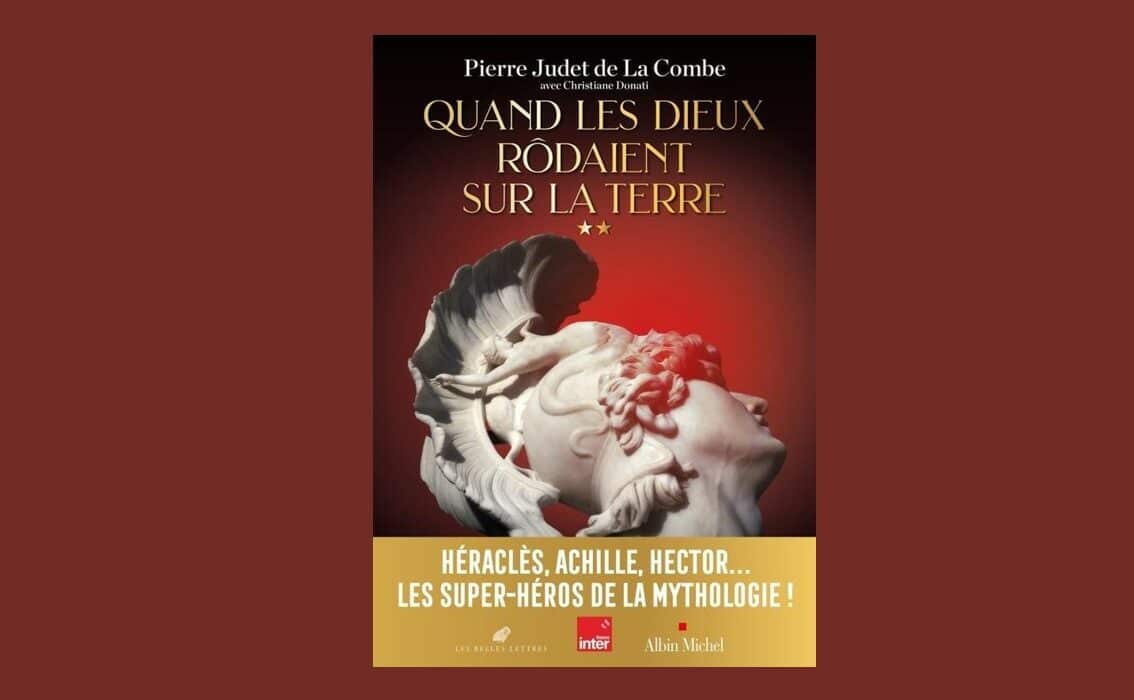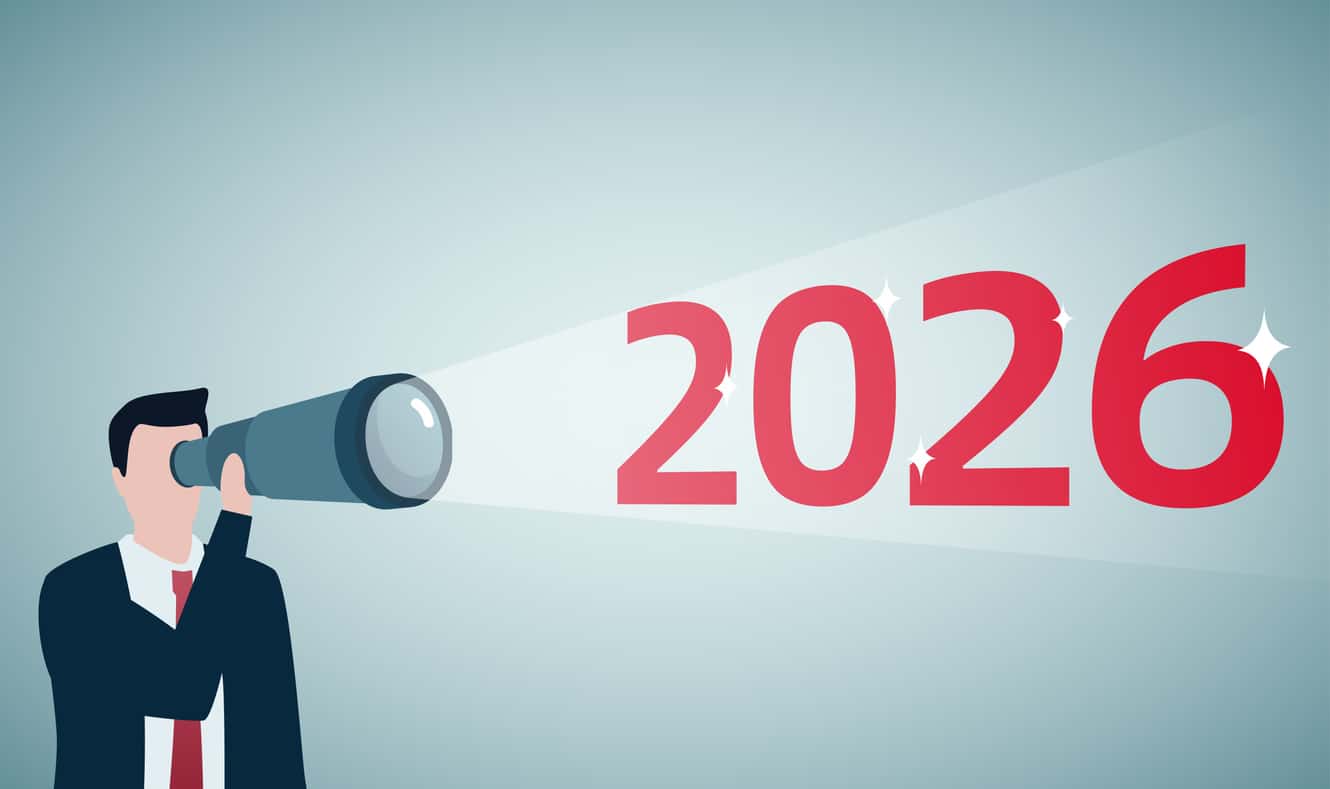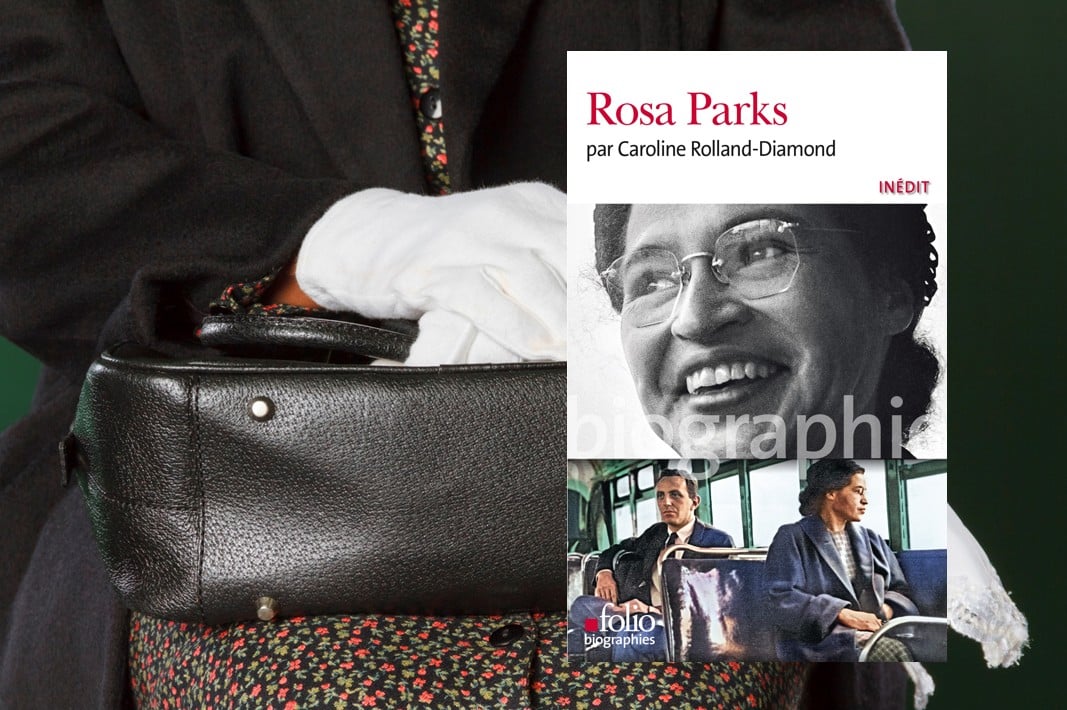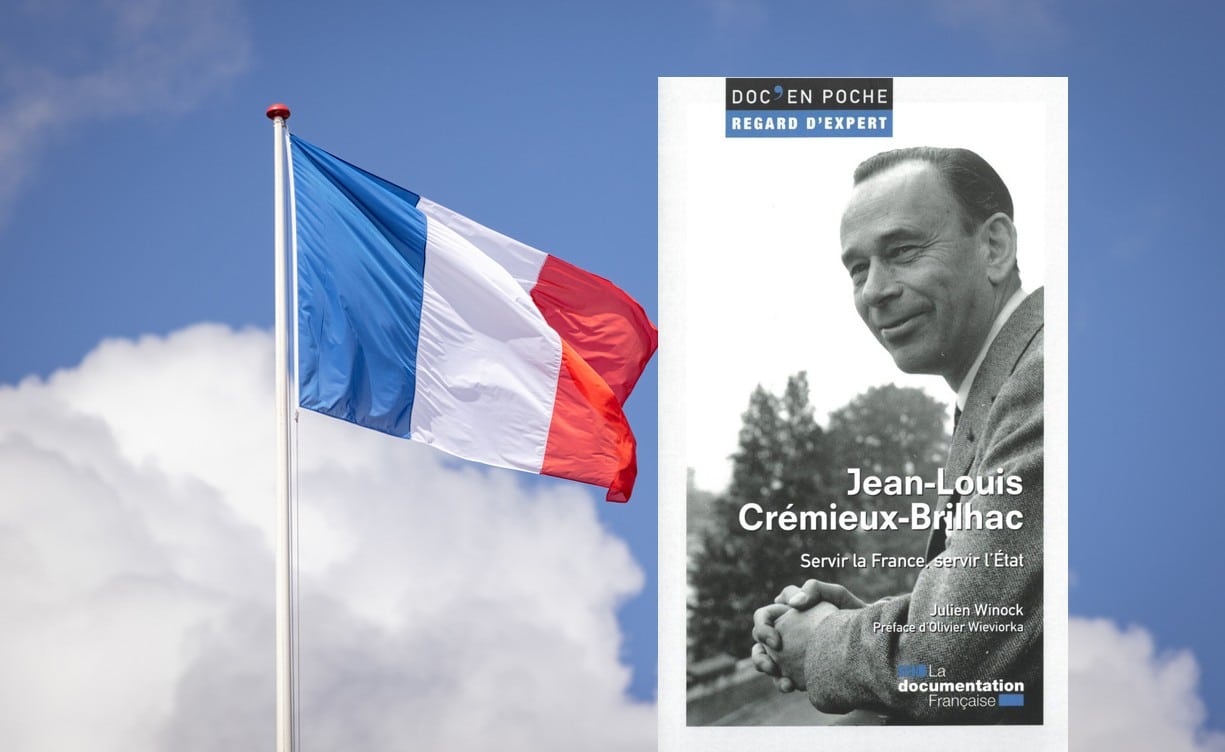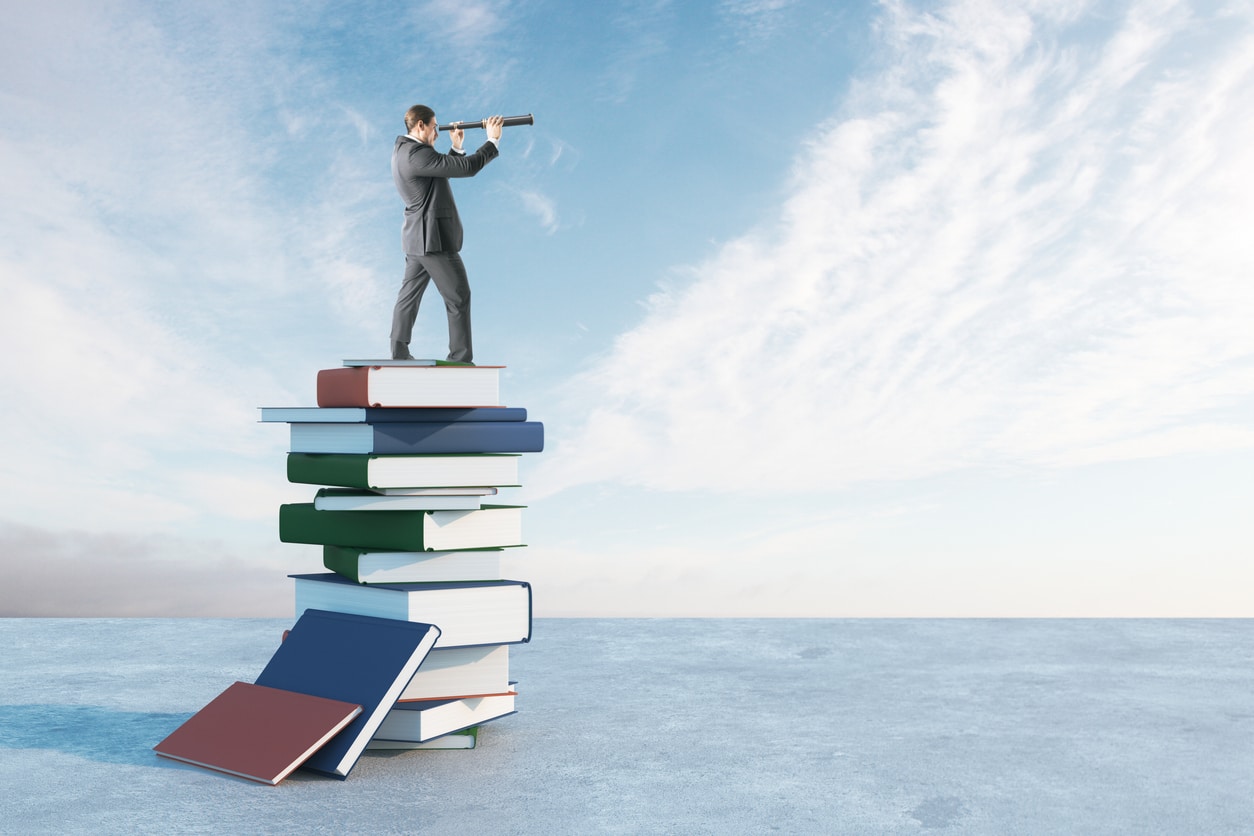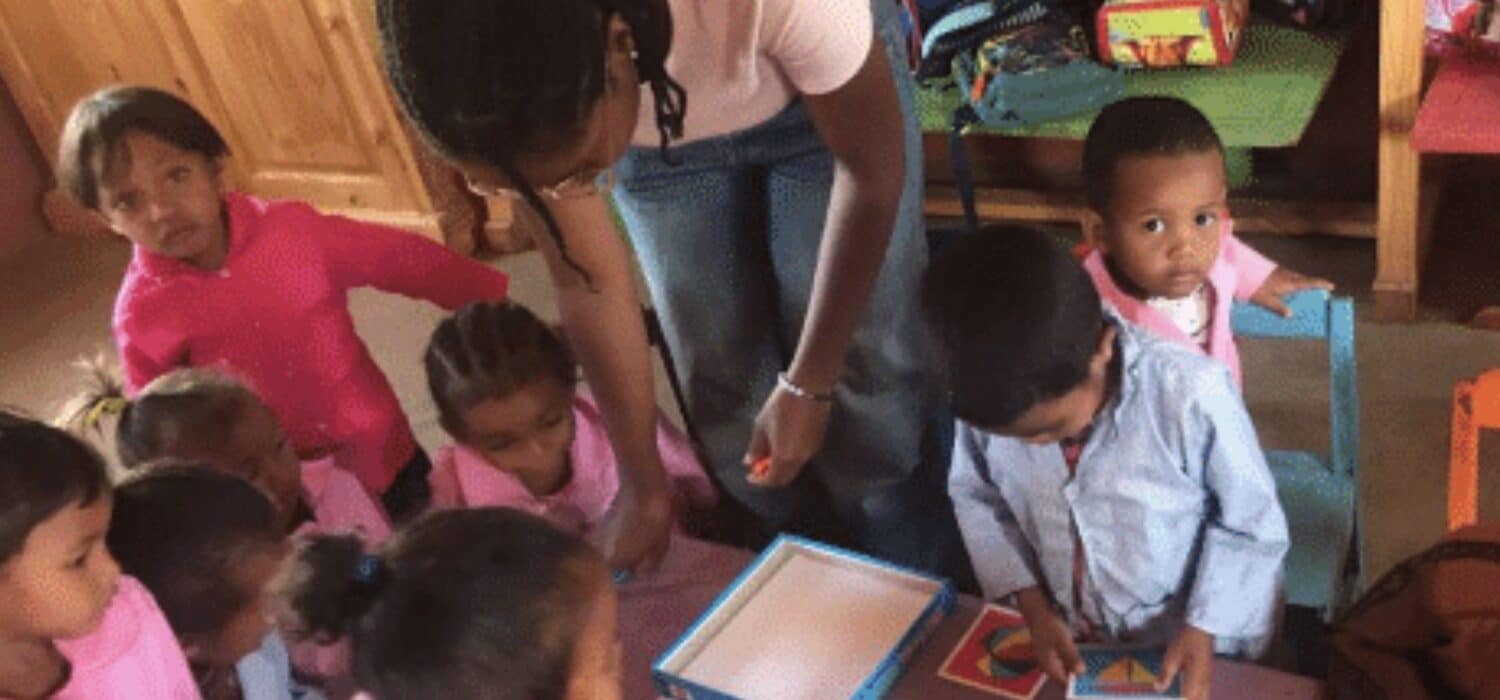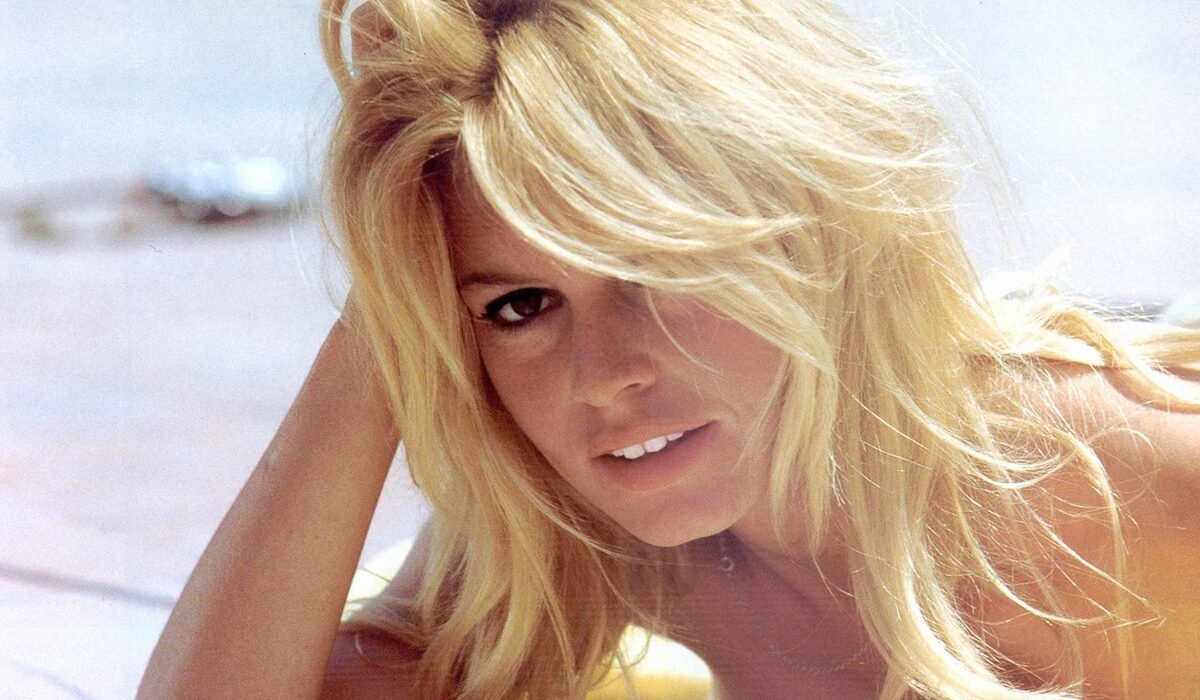Tricheurs et cruels, mais aussi plein de charme et de beauté, les dieux grecs étaient de drôles de zèbres. C’en est au point que, depuis la nuit des temps judéo-chrétiens, nous les traitons comme de grands enfants, fascinés par les histoires qu’ils traversent, dont ils sont souvent les héros – c’est le cas de la dire puisqu’ils sont les inventeurs d’un tel concept – oui, mais avec un brin de condescendance. Tout au contraire, les hellénistes les prennent au sérieux.
Une saga à la fois scientifique et divertissante
Pierre Judet de la Combe, formidable traducteur et conteur, ancien directeur de Recherches au CNRS et à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) publie le deuxième volume – il faut souhaiter que d’autres épisodes paraissent à l’avenir – d’une saga tout à la fois scientifique et divertissante : « Quand les dieux rôdait sur la terre ». A chaque chapitre, il nous raconte l’œuvre et la vie d’une divinité, d’un demi-dieu. Sur un ton vif et contemporain, le philologue et son épouse, Christiane Donati, psychologue et clinicienne, qui l’accompagne dans cette aventure éditoriale, nous éclairent au sujet d’un monde évanoui, plus que lointain, exotique, dont les récits constituent pourtant l’une des références fondamentales de notre imaginaire.
Quelques mots du titre du livre, qui a été trouvé par Christiane Donati. Les dieux n’occupent pas, ne dominent pas, ne s’installent pas, mais ils rôdent. Un terme qui nous interroge. « Ils vivent dans l’Olympe et sont donc absents, nous explique Pierre Judet de la Combe. Mais parce qu’ils cherchent leur intérêt, leur plaisir, parce qu’ils veulent être respectés, ils sont obligés d’intervenir dans la vie des Hommes. Alors ils agissent ; de manière tantôt visible, tantôt invisible. Voilà pourquoi nous pouvons considérer qu’ils rôdent. »
Les dieux ne sont pas des anges
Nous l’avons dit en préambule, ces dieux ne sont pas des anges. Leur tempérament, leur comportement, laissent à désirer : Cronos mange ses enfants, Zeus est menteur, Poséidon freine le retour d’Ulysse par mille stratagèmes. On pourrait dire qu’ils nous ressemblent, non seulement d’une façon générale, puisque leur caractère est tailladé de failles, mais encore d’une façon particulière puisqu’aujourd’hui notre monde est parsemé de guerres. « Il faut le reconnaître, les Grecs étaient des brutes, admet Pierre Judet de la Combe. Un des buts de la guerre de Troie, parfaitement assumé, c’était de piller la ville et de violer des femmes. En même temps, cette société possédait des raffinements remarquables. Aussi bien, si Homère n’aimait pas la guerre, il en a relaté les épisodes parce qu’elle est l’événement originaire de la Grèce, le seul auquel tous les Grecs – ou presque – ont participé, mais aussi pour mener une réflexion sur la violence en général. »
Ambivalence de toute société ? Certes. Mais alors on peut se demander dans quelle mesure ces personnages tenaient pour les Grecs un rôle comparable à celui que Dieu tient dans les civilisations monothéistes ou dans l’Hindouisme. Pour le dire autrement, la façon dont les Grecs – et plus tard les Romains – partageaient, transmettaient ces récits, jette un doute sur le caractère religieux au sens habituel de ces croyances. Cette religion, puisque c’en était une, ne se fondait pas sur une transcendance. Elle avait plutôt pour ambition première de faire tenir ensemble une vie commune difficile. N’est-ce pas, d’ailleurs, pour cette raison que fut forgé le terme de mythologie ?
Rites, temples, cultes…
« La discussion sur le rite, le rituel et la mythologie est vieille comme le monde, nous répond le philologue. En fait, c’est la même chose. La religion de l’antiquité grecque n’a pas de dogme, pas de vérité générale, révélée, pas de prêtrise dont la fonction consisterait à dire ce qu’il en est des dieux. Mais il y a des temples et des cultes, des cérémonies pendant lesquelles on entend les poètes raconter des histoires, lesquelles qui pouvaient changer suivant celui qui parlait, même si des invariants les caractérisaient. »
Ce que nous appelons mythologie, plus qu’une référence commune, avait donc bel et bien valeur de religion.
« Ces narrations disent qu’à un moment dans le passé, en un lieu très précis, quelque chose de décisif a eu lieu, précise Pierre Judet de la Combe. Dans des circonstances, un dieu qui porte un nom précis s’est livré à une action déterminée. L’essentiel est là, dans ce réel très concret qui s’ouvre à chacun pour devenir le lieu à partir duquel quelque chose d’universel va avoir lieu. Le mythe, par rapport au discours théologique ou philosophique, n’est pas un principe universel – comme les premiers philosophes ont pu dire de l’eau ou l’infini qu’ils sont des principes de toute chose. Il indique un événement qui s’est déroulé dans un lieu précis sous l’action d’un dieu qui porte un nom. Etant donné que les hommes sont coupés des dieux, que la plupart d’entre eux ne peuvent pas les voir, ils se racontent des histoires où ces dieux tiennent un rôle précis et situé. Ce ne sont pas, comme le disent les philosophes, des personnifications, mais des circonstances qui créent de l’universel, un moment de l’existence humaine. » En lisant ce beau volume, vous allez rêver tout autant que vous instruire. Quoi de plus délicieux ?
A lire : « Quand les Dieux rôdaient sur la terre », Pierre Judet de la Combe (et Christiane Donati), Albin Michel (avec France Inter et Les Belles Lettres) 542 p. 25 €