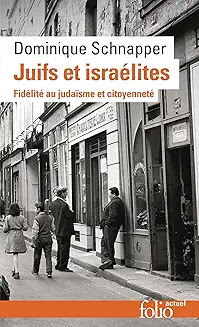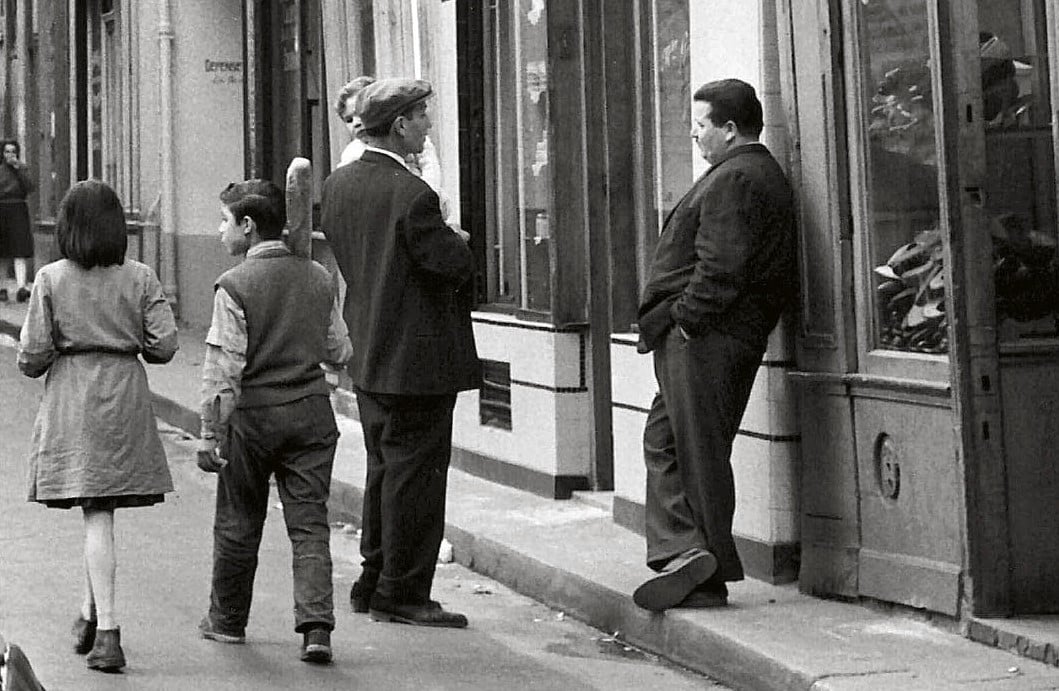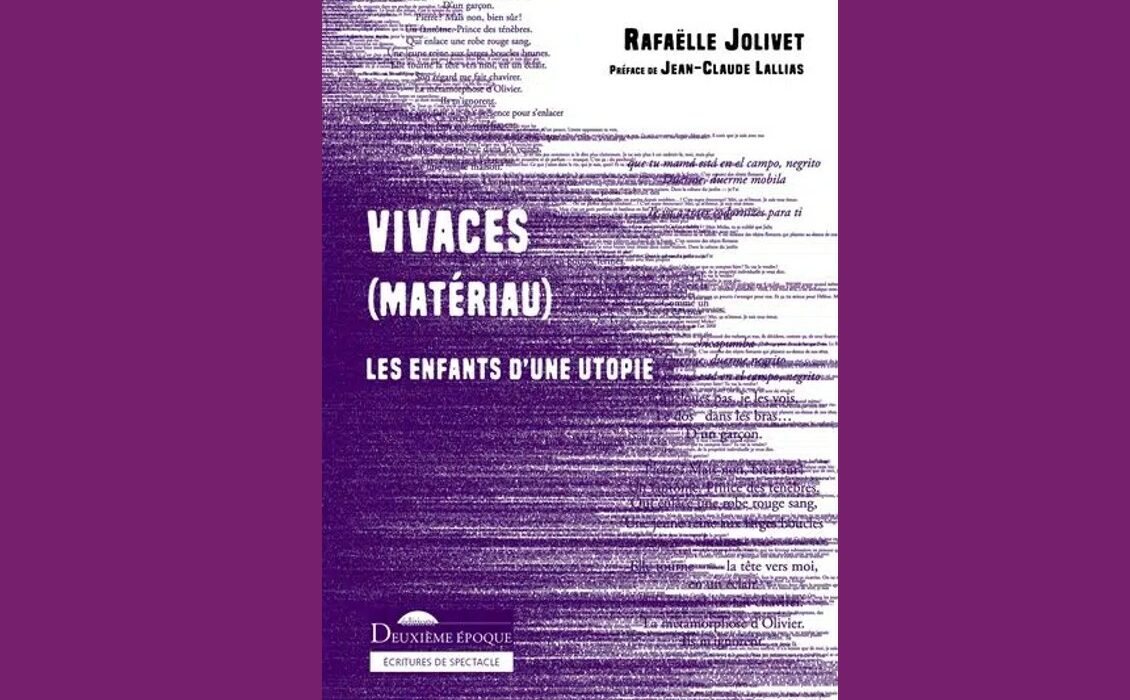Avant 1940, les juifs français se définissaient comme « israélites », laissant le mot « juif » aux nouveaux immigrés venant de l’Est de l’Europe. Par ce terme d’israélite, ils voulaient se montrer citoyens de leur pays de naissance, attachés aux valeurs de la République, ramenant le judaïsme à une religion. Aujourd’hui leur attachement n’est pas moindre, mais après la Shoah, l’arrivée massive des Sépharades et le regain de l’antisémitisme, ils se revendiquent comme « juifs », désirant assumer tout l’héritage juif, qu’il soit tragique ou glorieux, religieux ou culturel. Ainsi peut-on expliquer le titre de ce livre. Cet ouvrage reprend une étude sociologique publiée en 1980, et actualisée aujourd’hui par une préface sous le titre de « Retour du tragique ».
Cette étude interrogeait sur la fidélité aux pratiques religieuses et aux traditions identitaires. À partir des résultats, D. Schnapper établissait une typologie qui cherchait à répondre à la question existentielle « Qui est juif ? » Elle définissait trois « types » toujours valables aujourd’hui : les pratiquants religieux qui respectent les règles quotidiennes du régime alimentaire, du repos du shabbat et les rites des grandes fêtes. Les militants se contentent de quelques grandes fêtes, mais ils s’engagent massivement dans le soutien à Israël. Quant aux israélites, non pratiquants, ignorant la culture […]