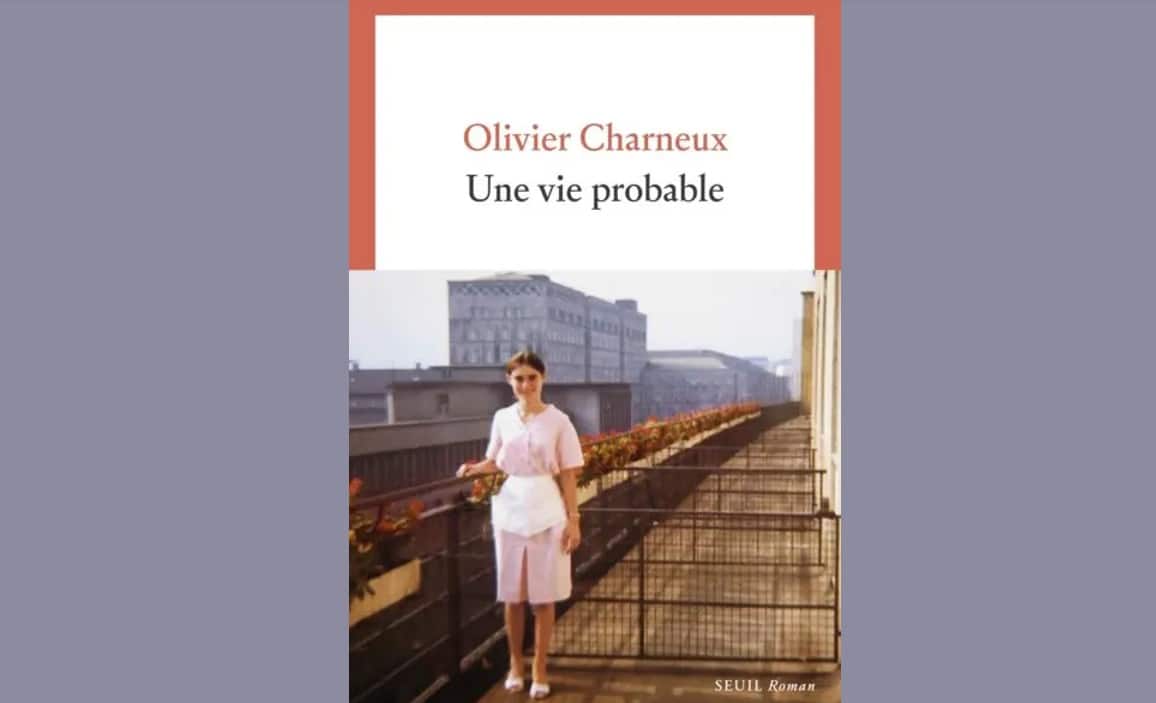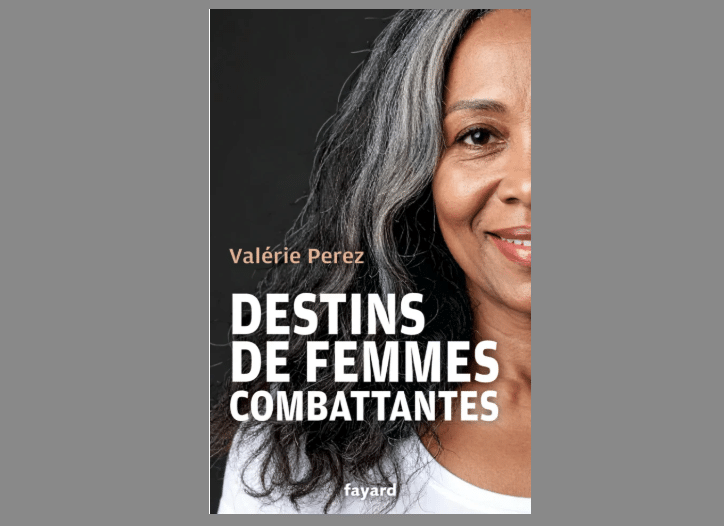La correspondance est un genre littéraire à part entière. Commençons par celle des Mauriac. Avec un air d’oiseau chiffonné, François veille sur son fils aîné, Claude, qui le lui rend bien, toute déférence bue. Parfois, Jeanne s’immisce en mère affectueuse. Les missives ne sont pas si nombreuses, qui paraissent en un volume. Ainsi va la proximité, qui facilite moins que la distance les longs courriers – monsieur de La Palice n’aurait pas dit mieux.
« Dire que j’ai été si près de la mort et que je serais mort comme un chien sans comprendre. Car cela frappe : cette sécurité où je me trouvais au moment où j’étais le plus menacé », note Claude, mobilisé le 13 juillet 1940. En réponse, le père interroge : « Crois-tu qu’un Laval, un Marquet pourront accomplir, en profitant de ce que la France est matraquée et demi-morte, ce qu’un Hitler, un Mussolini ont obtenu de leurs peuples ? Sur le papier, c’est facile… » Tangage des idées, quand tout prend l’eau. Mais la lucidité de Claude sur le Paris occupé sauve de l’aveuglement […]