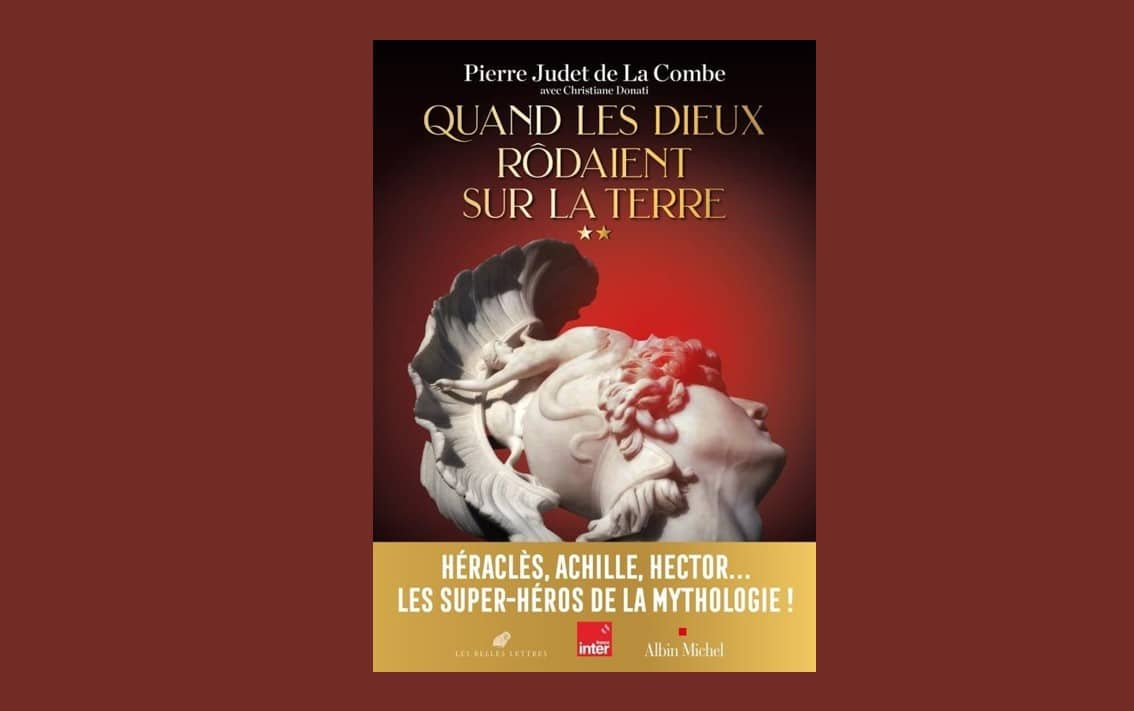Découvrir ou bien relire Louis Aragon, c’est partir à la recherche de la faille, creuser l’âme que chacun porte en soi, le combat formidable du spleen et de l’idéal, renouvelé du souffle de l’Histoire. A la fin des années soixante-dix, enveloppé d’hommes jeunes, dans les nuits de sa ville Aragon s’en allait. C’était une agonie de plaisirs et de tourments, l’Union Soviétique en veilleuse et des costumes signés Saint Laurent. Le 24 décembre 1982, de fatigue il est mort. Quarante ans déjà…
Combien de chemins, de visages Louis Aragon avait-il empruntés? C’en est un vertige. Tenez…Nul ne peut dire avec certitude quel jour il est né. L’hypothèse la plus crédible est celle du 3 octobre 1897. A quel endroit ? C’est encore une autre histoire. Il a raconté que sa mère avait accouché de lui sur l’esplanade des Invalides, un tableau de misère à l’ombre de la gloire. Mais les biographes – en tête on citera Pierre Juquin- retiennent Toulon.
Pourquoi le Var ? Parce qu’il a fallu cacher sa naissance adultérine : le père ne voulait s’embarrasser. Parlons-en de ce père. Louis Andrieux ne fut pas seulement député, préfet de police, mais encore anticlérical et franc-maçon, peut-être même de culture protestante. C’est lui qui a choisi pour le garçon le patronyme inspiré de l’Espagne. Et pourquoi ? Mystère à nouveau.
L’enfance du petit Louis se déroule à Neuilly, dans le silence et les secrets. De bonnes études, en compagnie de Jacques Prévert et Montherlant. Celui-ci témoignera que son copain de classe connaissait par cœur des tirades à n’en plus finir- quelque chose comme un surdoué. Celui-là ne lui pardonnera jamais son snobisme et ses diatribes qu’il jugera chauvines.
« La maison des amis des livres »
Etudiant la médecine entre le mois d’octobre 1916 et les mois de juin 1917, Aragon fréquente la librairie d’Adrienne Monnier, « La maison des amis des livres », un phalanstère intellectuel, artistique. Au mois de septembre, affecté à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, il fait la connaissance d’un autre carabin, qu’il pense avoir déjà croisé chez la fameuse Adrienne : André Breton. Songez- y: ces deux jeunes hommes veillent sur le quartier des fous. Louis Aragon réussit son examen de médecine le 4 avril 1918. Il quitte Paris pour le Front le 26 juin. Mais avant son départ, il se passe quelque chose. Oui, quelque chose à nulle autre pareille : Marguerite Toucas-Massillon, qu’Aragon prend depuis toujours pour sa grande sœur, lui révèle qu’elle est sa mère.
Combien de chemins, combien de visages ? « Et combien de masques ? » Ajouterait-on si ce n’était un cliché lorsqu’on parle de lui. Cette vie, poème de larmes et de sang, cette existence de mots qui riment et qu’on nomme roman, c’est le destin d’Aragon. Trois volumes paraissent aujourd’hui chez Gallimard : « Persécuté, persécuteur », « Les chambres, poème du temps qui ne passe pas », « Les Adieux et autres poèmes ». Un choix plus que judicieux, puisque ce sont des ouvrages méconnus.
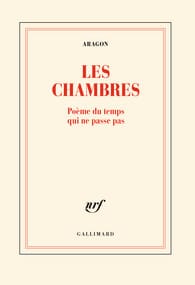
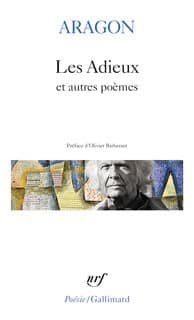
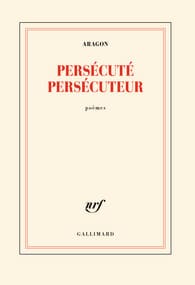
Le premier rassemble ce que l’on pourrait appeler des textes de combat : Front Rouge est le plus célèbre. On y trouve de furieux délires, « …déjà 80% du pain cette année/ provient des blés marxistes des Kolkhozes » et des fulgurances pourtant: « Le flot noir se formait comme un poing qui se ferme ». Un drôle de zèbre que ce jeune poète. « L’insolence, l’invective et l’imprécation vitupérante affaiblissent le propos, déclare Olivier Barabant, spécialiste d’Aragon, maître d’œuvre de l’édition de la Pléiade et de la parution du livre Les Adieux. Mais le recueil contient des textes bouleversants, reflets d’un homme brisé, égaré, porteur d’une révolte qui peine à trouver sa voie – et sa voix, idéologiquement perdu, proche du suicide. » Écoutez ceci : « Palmes pâles matins sur les Îles Heureuses/ Palmes pâles paumes des femmes de couleur/palmes huiles qui calmiez les mers sur les pas d’une corvette/ charme des spoliations lointaines dans un décor édénique ». Enfance d’un géant qui se devine.
Les deux autres livres unissent les poèmes de la vieillesse. « La Chambre est une ode bouleversante, observe Olivier Barbarant. Parce qu’il sent la fin d’Elsa prochaine, Aragon rédige un adieu déchirant, l’un des plus beaux, parce que dénué de toute afféterie, de tout effet. » L’être aimé face à la mort, dans le dénuement, le courage et la solitude apparente : «Chambre où tout est poussière passé nuit rien/ Ne tient sur ses pieds les chaises ni/ La table de toilette un guéridon le tapis de travers/ Et le haut lit d’édredons passés avec la couverture blanche/ Sa frange aux pompons arrachés…. Tes chaussures près d’un fauteuil inquiètes/ le linge à terre glissé/ Tout n’est qu’un murmure à la limite de l’être. »
Il faut célébrer ces ultimes poèmes, quand, revenu de tout, Louis Aragon chante encore, inventant de nouveau son langage. « Il a, jusqu’en 1979, écrit textes et vers, animé d’une énergie d’une extrême jeunesse, d’une voix lyrique, claudélienne, observe Olivier Barbarant. « Les Adieux », ce volume tardif, éclipsé par les polémiques entourant un auteur demeuré communiste jusqu’au bout, contient cependant certains des plus beaux et des plus intenses poèmes d’Aragon, des chefs-d’œuvre de la poésie du XXème siècle: « L’an 2000 n’aura pas lieu », « Hölderlin », « Cantate à André Masson »…»
On peut certes regretter, condamner les errances du bonhomme – et ses imprécations ; mais il ne faut jamais oublier ce que lui-même affirmait : «Je crois qu’on ne comprend rien à mes livre si on omet de dater mes écrits.» C’était un fou des altitudes, héritier de la plus haute littérature française, et tout autant capable de se battre pour Picasso, Matisse ou même Godard. Un illuminé si l’on veut.