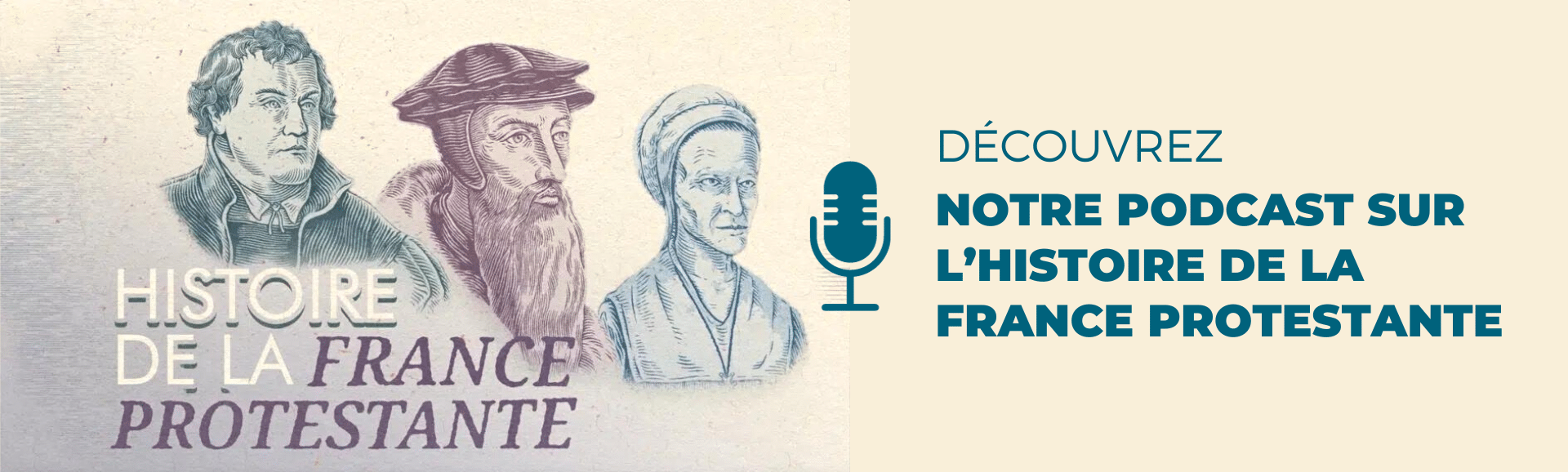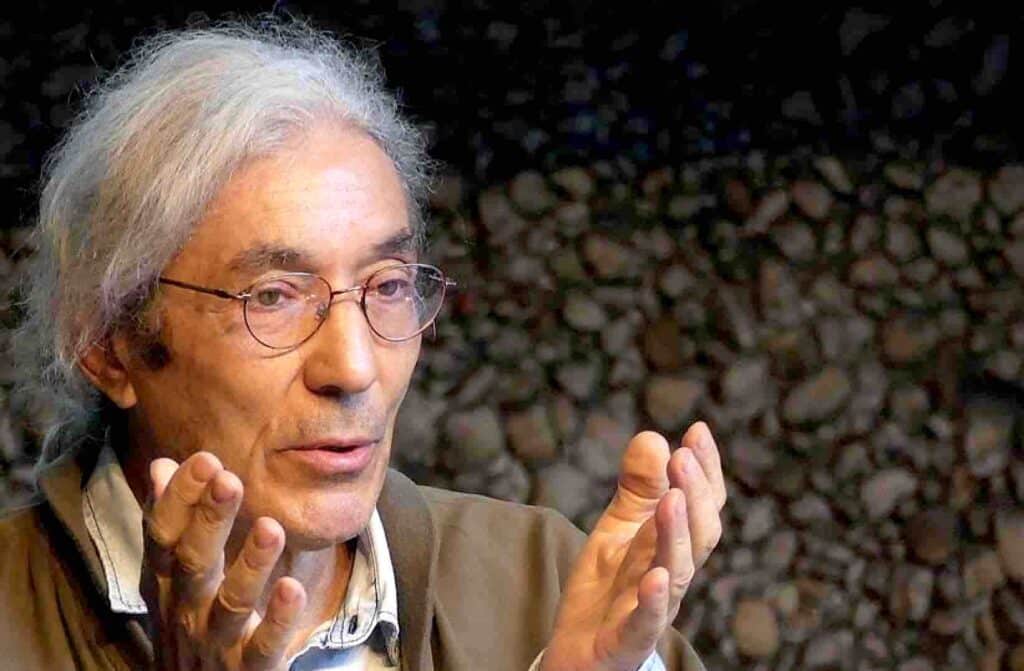Paula, premier long-métrage de la réalisatrice française Angela Ottobah, est un film tout à fait original et perturbant, pour parler d’emprise et de résistance, de façon peu habituelle avec une perspective métaphorique et non frontale assumée.
Juin à Paris. Paula vit avec son père en convalescence. À onze ans, elle est solitaire, l’école l’ennuie et elle n’a qu’un ami : Achille. L’été arrive et le père décide d’emmener sa fille au bord d’un lac, dans une petite et jolie maison. Mais l’été passe, et ils ne rentrent pas. Leur mode de vie devient de plus en plus âpre et dur, épousant un idéal éducatif chaque jour plus extrême. Paula entre alors en résistance, sous l’œil aimant mais intensément étouffant de son père.
Aimer à perdre la raison chantait Ferrat, sur un sublime texte de Louis Aragon qui évoquait l’amour-passion, qui loin d’apaiser et de satisfaire celui qui l’éprouve, peut lui faire perdre sérénité et bien-être, mesure et discernement. En 2012, le belge Joachim Lafosse, nommait aussi son film librement inspiré de l’affaire Geneviève Lhermitte, du nom de cette mère de famille ayant assassiné ses cinq enfants en février 2007. Avec Paula, Angela Ottobah renouvelle la thématique dans une approche toute-autre du drame passionnel fait d’abord de pudeur, de déplacement d’axe de caméra pour nous conduire dans un récit d’enfance et de séparation.
Paula, c’est l’histoire d’un père qui aime sa fille mais très mal, au point possiblement de la tuer, miroir de l’inceste. Une métaphore qui se construit très habilement et subtilement dans le hors-champ… le non frontal mais bien présent pour qui a des yeux pour voir, pour observer ce qui n’est pas clairement montré mais suggéré.

La réalisatrice choisit de ne donner aucune clé véritablement à son récit, laissant le spectateur dans la liberté. Peut-être celle qui est aussi la nôtre dans la vie réelle face à des situations semblables ou proches… Une liberté responsabilisante finalement ! Quelle vérité me ferais-je alors de ce père ? Seuls indicateurs, là encore maniés avec sens et intelligence, la musique en toile de fond et la photographie choisie, qui confirment que le pire se joue sous nos yeux.
Paula c’est la transmission d’une histoire simple, quasi insignifiante dans un premier sentiment qui peut naître dans la première demi-heure, mais qui devient de plus en plus trouble et inquiétante.
Une histoire à hauteur et vue d’enfant, comme un rêve qui devient cauchemar dans lequel surgissent des instants de rire ou de douceurs… pour évidemment laisser l’horreur de la situation peser plus lourdement encore.
Ottobah aborde sans besoin d’en faire des tonnes, des sujets extrêmement forts et parfois tabous, sur ce qui entoure l’horreur du viol incestueux ou, plus généralement, de l’emprise d’un parent sur son enfant. De la solitude de la victime à l’installation d’une relation, en passant par l’aveuglement des plus proches, le récit en tient compte et se construit autour d’eux.
Mais si le scénario est sombre, vous l’aurez compris, il subsiste une réelle dimension d’espérance qui se joue notamment dans l’utilisation de l’eau. Symbole de vie, de naissance ou de renaissance, l’eau devient ici l’endroit de l’émancipation de Paula, son outil, son pouvoir.
Angela Ottobah en parle comme d’« un espace parallèle, que son père lui transmet mais qui devient pour elle l’endroit de la joie et de la puissance, parce qu’elle peut respirer plus longtemps que lui. Je voulais que l’eau soit rouge, quelque chose qui évoque l’intérieur du ventre ». Évidemment, coup de chapeau pour le choix de la petite (mais tellement grande dans son interprétation) Aline Hélan-Boudon, qui apporte un supplément d’âme, mais aussi de beauté et de force à son personnage.