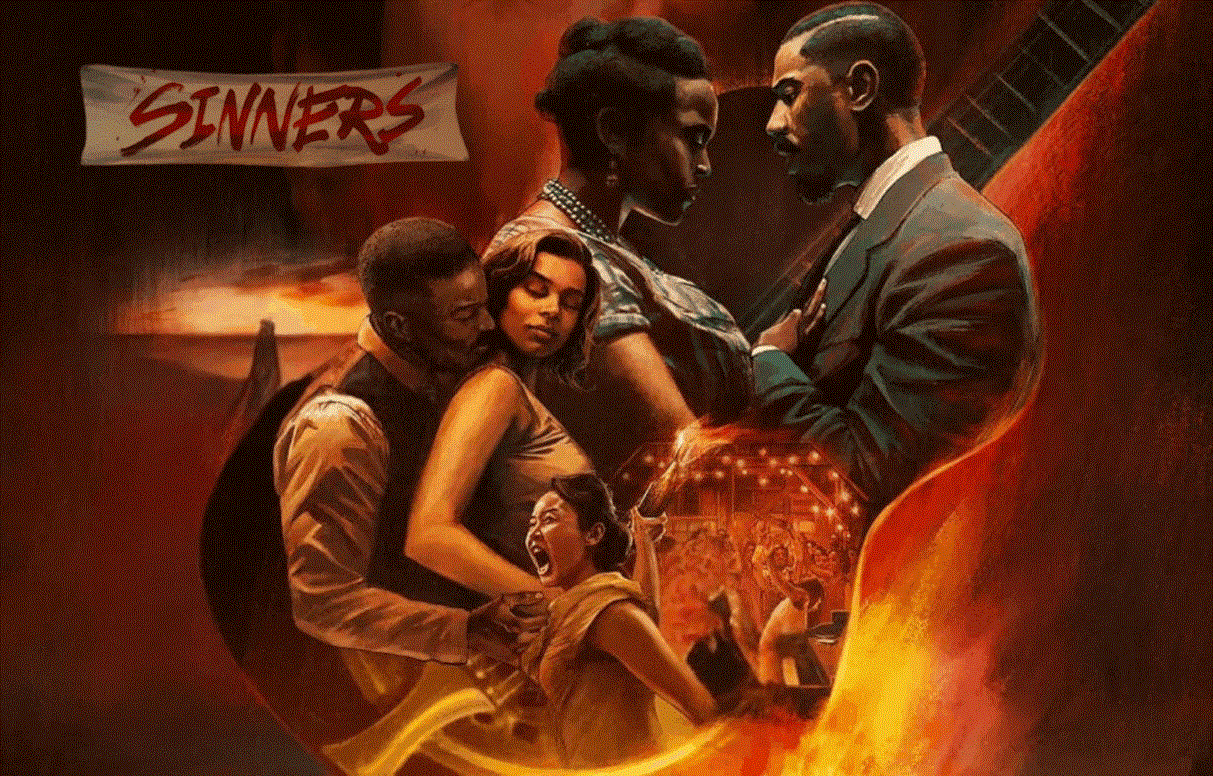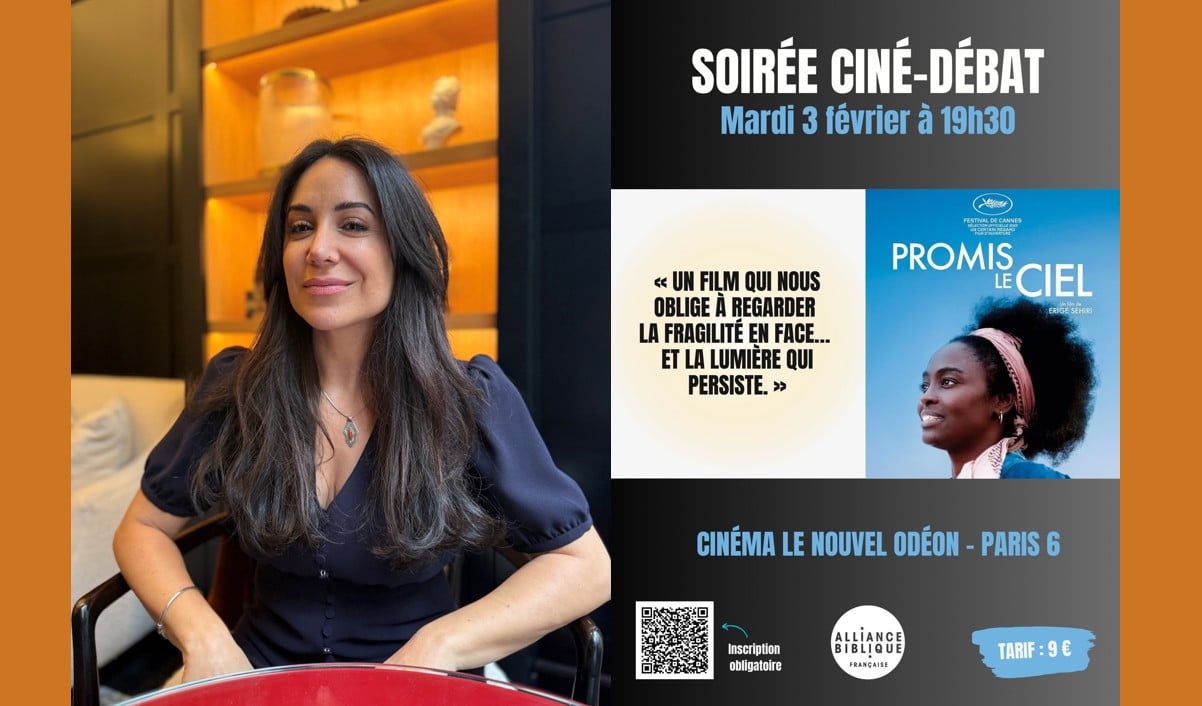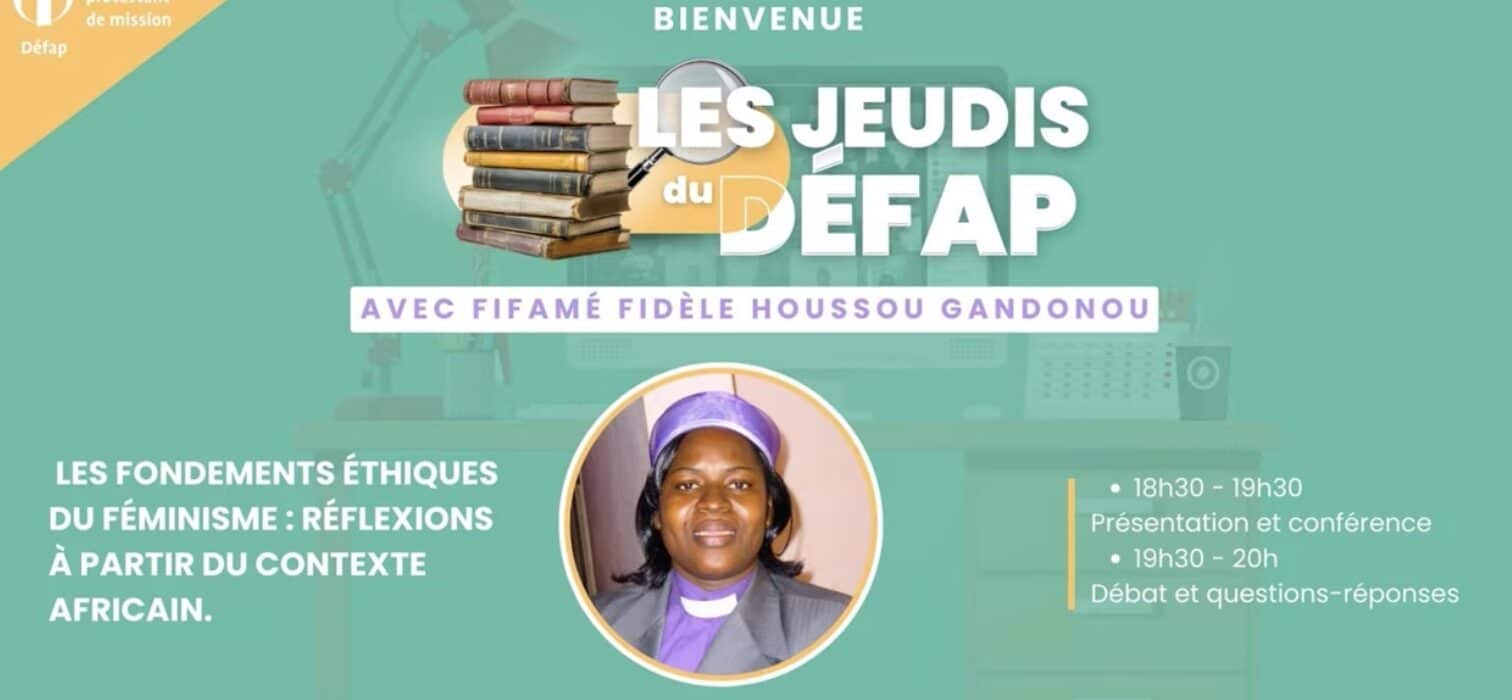Résurrection marque le retour du réalisateur chinois Bi Gan, après Un grand voyage vers la nuit (2018). Ce nouveau très long-métrage, d’une durée de 160 minutes, mêle science-fiction, drame et policier dans une narration fragmentée et visuellement saisissante. Plus qu’un film… une expérience !
Dans un futur où l’humanité a perdu la capacité de rêver, un être singulier, le rêvoleur, conserve cette faculté. Ses rêves le propulsent à travers différentes époques de l’histoire chinoise, incarnant divers personnages dans des contextes variés, du début du XXe siècle à la veille du nouveau millénaire. Chaque segment du film explore une période distincte, reflétant aussi les transformations sociopolitiques de la Chine. Une femme (Shu Qi) parvient à pénétrer ses rêves, cherchant à discerner la vérité au sein de ses visions. Le film s’interroge sur la nature de la réalité, la mémoire et l’identité, posant la question : est-ce que rêver est un acte de résistance ou une fuite ?
Une esthétique immersive et évocatrice
Bi Gan, fidèle à son style, offre une mise en scène immersive, utilisant des plans-séquences époustouflants et une photographie léchée signée Dong Jingsong. La musique du groupe français M83 accompagne les images, renforçant l’atmosphère onirique du film. Chaque chapitre adopte une esthétique propre, évoquant différents genres cinématographiques, du film muet expressionniste aux thrillers contemporains. Le film débute dans un univers rappelant le cinéma muet, avec des références à Nosferatu, puis traverse des scènes de guerre, des temples isolés et des clubs nocturnes, culminant dans un lieu nommé “Sunrise”, symbolisant peut-être un renouveau ou une fin.
Une réflexion sur l’humanité et la mémoire
Résurrection propose une méditation sur la condition humaine, la mémoire collective et individuelle, et la manière dont les rêves façonnent notre perception du monde. Le film suggère que, dans un monde où rêver est devenu rare, ceux qui conservent cette capacité détiennent une forme de vérité ou de pouvoir. La structure en épisodes permet d’explorer différentes facettes de l’histoire et de la culture chinoises, tout en posant des questions universelles sur le temps, l’identité et la résilience de l’esprit humain.

Quand le cinéma rêve de lui-même
Au cœur même de Résurrection, Bi Gan tisse une réflexion méta-cinématographique subtile. Le film, tout en étant une sorte de rêve en mouvement, devient aussi une méditation sur le pouvoir du cinéma à représenter ce que le réel rejette ou oublie. À mesure que le rêvoleur glisse d’une époque à une autre, c’est le langage du cinéma qui se transforme – comme si chaque période de l’histoire chinoise se racontait dans une esthétique et une grammaire propres. Bi Gan ne filme donc pas seulement les rêves, il interroge le rêve de cinéma lui-même : son rôle de mémoire, de fabrique d’images, de conscience alternative. Il suggère que dans un monde privé de rêve, c’est le cinéma qui peut encore porter une parole libre, poétique, non normative. Un espace pour ce qui ne peut plus être dit ailleurs.
Bi Gan livre ici une œuvre ambitieuse et poétique, qui défie les conventions narratives et visuelles. Le film invite le spectateur à un voyage introspectif, où les frontières entre rêve et réalité s’estompent, offrant une expérience cinématographique unique et profondément humaine.