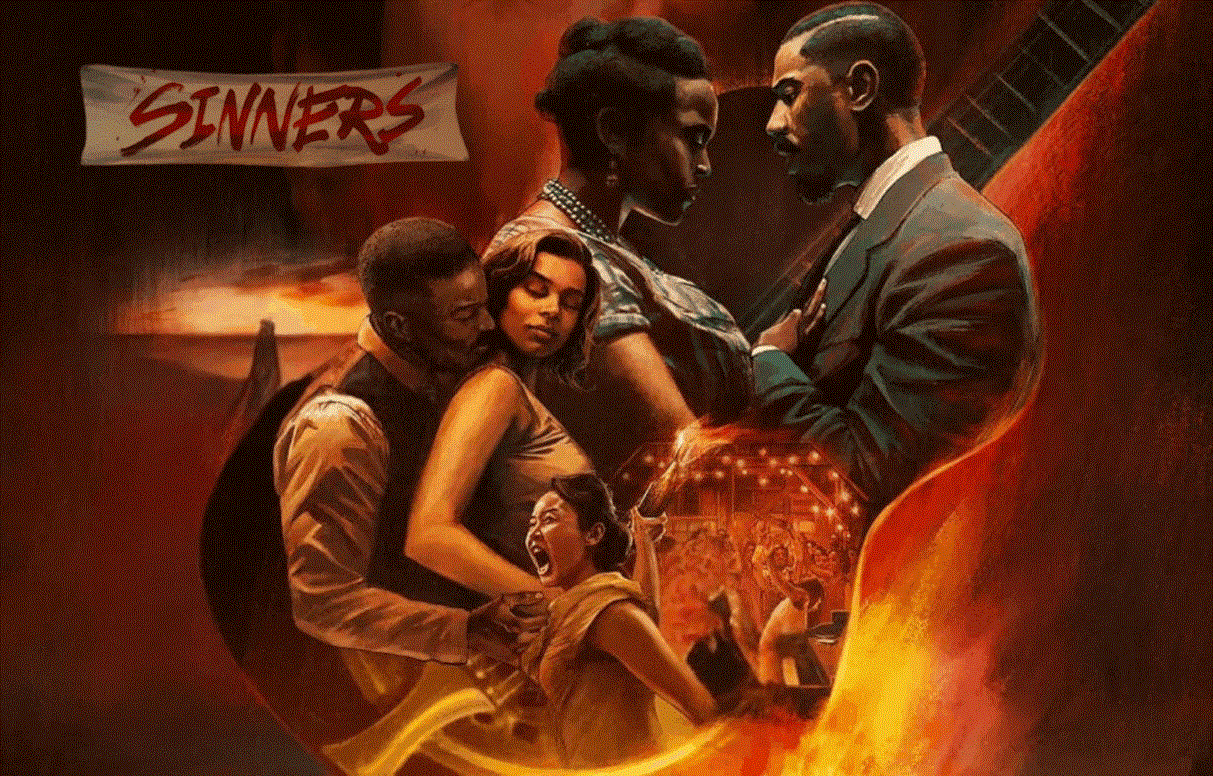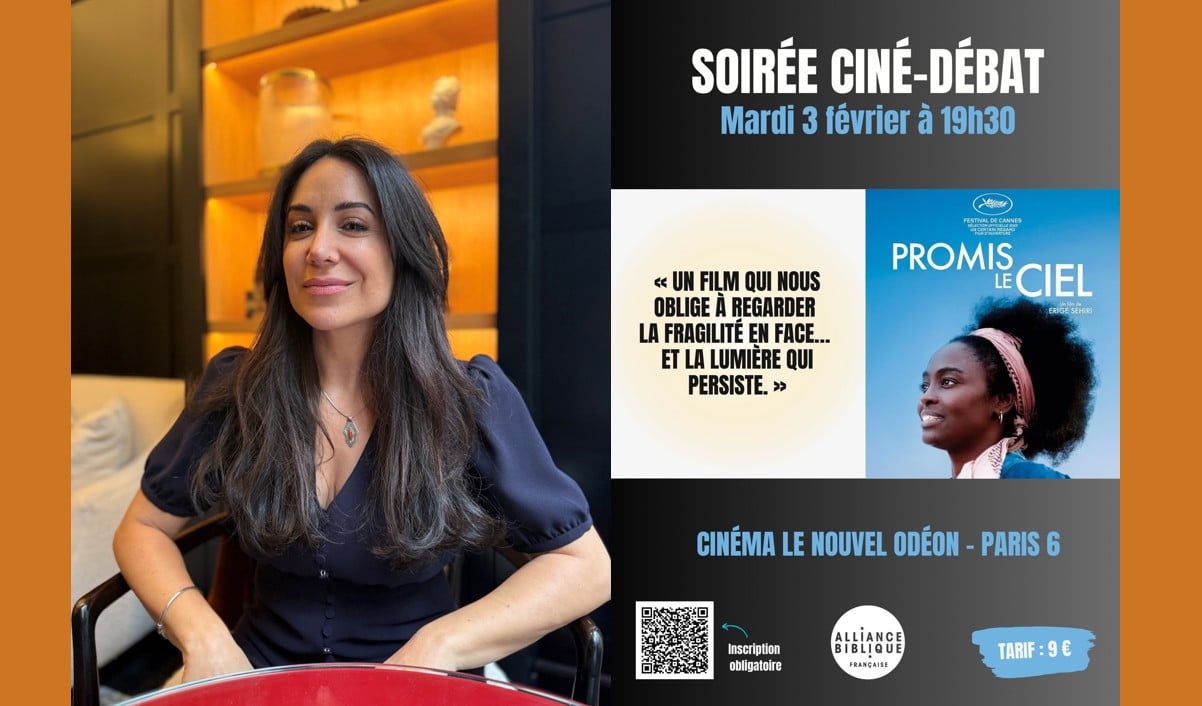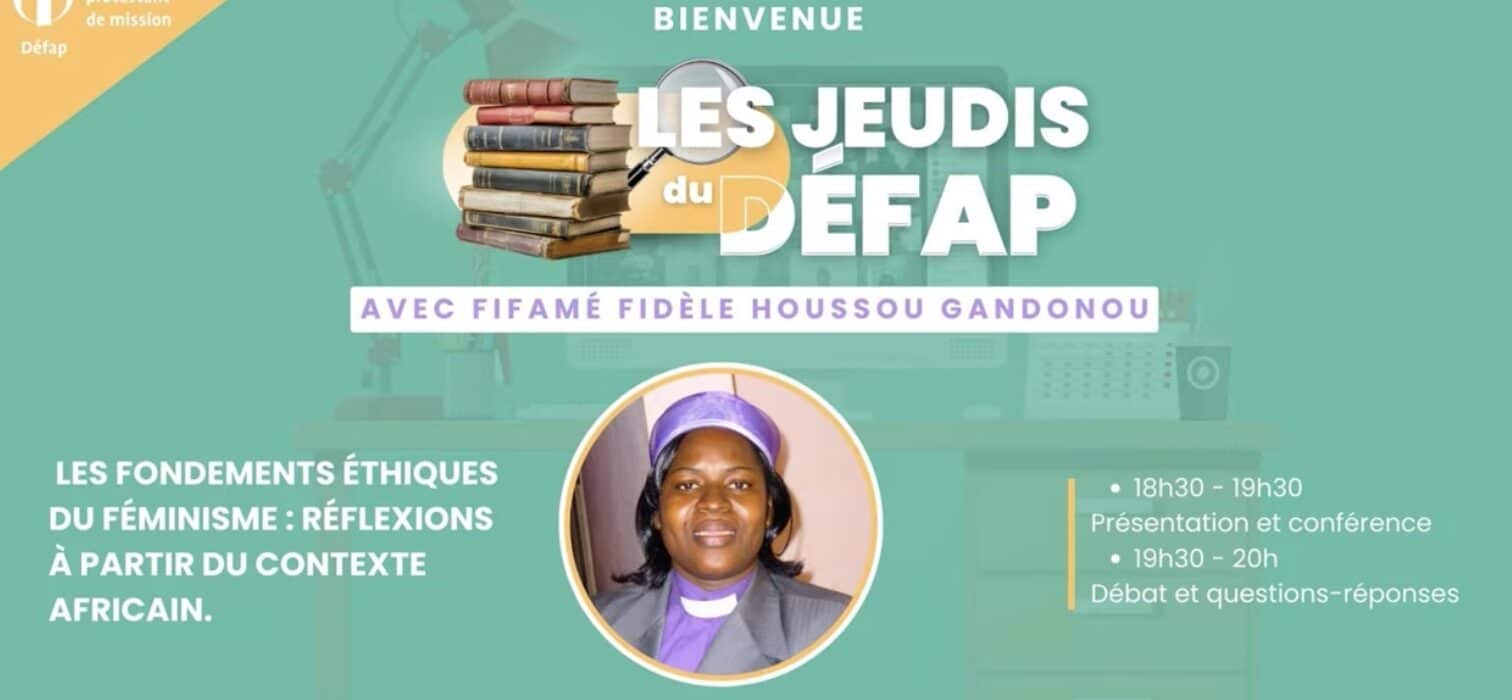Sous ses airs de chronique sociale, le film s’impose comme une fable contemporaine troublante sur le regard que nous portons sur l’autre – et sur nous-mêmes.
Simon a 21 ans. Il se présente comme aide-déménageur. Il dit ne pas savoir cuisiner, ni nettoyer une salle de bains, mais en revanche il sait faire un lit. Depuis quelque temps, il semble devenir quelqu’un d’autre.
Simón n’est pas véritablement en situation de handicap, mais il s’intègre à un groupe de jeunes en situation de déficience mentale. Il les suit, les imite, partage leur quotidien avec une sincérité désarmante… ou peut-être une certaine ambiguïté. Que cherche-t-il ? Une échappée face à un monde normatif et froid ? Une forme de reconnaissance ? Ou un espace où la vulnérabilité devient un langage commun ?
Si le film fait émerger plusieurs figures profondément attachantes, il reste constamment centré sur le visage impassible de Simón, dont les mouvements de tête répétitifs finissent par devenir une sorte de langage intérieur. La caméra ne le lâche pas, comme pour traduire un enfermement invisible, une solitude que rien ne vient vraiment éclairer. Le film nous plonge ainsi dans un monde où tout repère semble dissous. On ne sait que peu de choses des lieux traversés, du rôle des adultes, du passé de Simón. Le récit semble parfois éclaté, privé de ligne directrice, comme si l’histoire elle-même avait renoncé à toute logique rationnelle pour épouser le point de vue d’un être en décalage. Et pourtant, quelque chose s’éclaire : pour Simón, cette communauté de jeunes, à laquelle il ne peut tout à fait appartenir, devient une forme d’Église fragile. Non pas une Église institutionnelle, mais un espace de reconnaissance, d’accueil, où sa différence ne fait plus de lui un étranger.
Un personnage sur la brèche
Ce que le film interroge alors, en profondeur, c’est notre définition du handicap — ou plus encore, notre définition de l’humanité. À aucun moment Federico Luis ne nomme ou n’explique. Il ne médicalise pas, ne cherche pas à justifier. Il laisse Simón habiter cette frontière trouble entre normalité et fragilité. Et c’est là qu’une lecture théologique devient possible : Simón de la montaña invite à voir le handicap non comme une rupture, mais comme une autre modalité de présence au monde, peut-être plus proche de l’Évangile que bien des normes sociales.

Dans les Écritures, ce sont souvent les faibles, les fous, les exclus qui deviennent porteurs d’une révélation. Le Christ lui-même est celui qui « n’avait ni beauté ni éclat » (Ésaïe 53.2) et qui a choisi la croix — folie pour les uns, puissance pour d’autres (1 Corinthiens 1.18-25). Simón n’est pas explicitement un personnage christique, mais son errance silencieuse, son désir d’appartenance, son positionnement en marge du monde « normal » nous renvoient à cette autre sagesse, celle de la faiblesse assumée. Porté par la performance intense de Lorenzo Ferro (L’Ange), le film ne juge pas. Il expose. Et dans ce dépouillement, dans cette caméra à hauteur d’homme, surgit une vérité : celle de l’humain dans toute sa complexité, entre désir d’appartenance et incapacité à être « à sa place ».
Une mise en scène pudique et vibrante
Federico Luis filme au plus près des visages. Caméra portée, plans serrés, lumière naturelle. Il capte les silences, les hésitations, les gestes maladroits mais vrais. Le réalisateur fait le choix fort de travailler avec de jeunes acteurs en situation de handicap dans la « vraie vie », évitant ainsi le piège de l’imitation ou de la caricature. Ce parti pris donne au film une justesse rare, une densité émotionnelle qui n’a rien de spectaculaire, mais tout d’authentique.
Une éthique du regard
Ce film interpelle profondément nos sociétés modernes, obsédées par la performance, la norme, l’efficacité. Il interroge : qui décide de la normalité ? Qu’est-ce que la solidarité lorsqu’elle n’est plus institutionnelle mais choisie, vécue au plus près de la chair ? C’est l’accueil de l’ « étranger », du faible, de celui qui est « hors cadre » ou à la marge qui s’envisage. Comme une forme de théologie incarnée, le film peut aussi se lire comme une mise à l’épreuve du regard, du jugement, du don de soi. Il ne donne pas de leçon, mais pousse à l’examen intérieur.
Simón de la montaña est une œuvre particulière et rare à la fois. Une invitation à regarder autrement, à s’ouvrir à une autre forme de présence au monde. Il n’est pas question ici de compassion facile ou de bons sentiments, mais d’une traversée : celle du flou, du trouble, de la vulnérabilité. C’est précisément là que réside sans doute sa puissance interpellatrice. Il nous rappelle que la vraie rencontre naît là où tombent les masques, là où l’autre devient un miroir, parfois cruel, mais toujours révélateur.