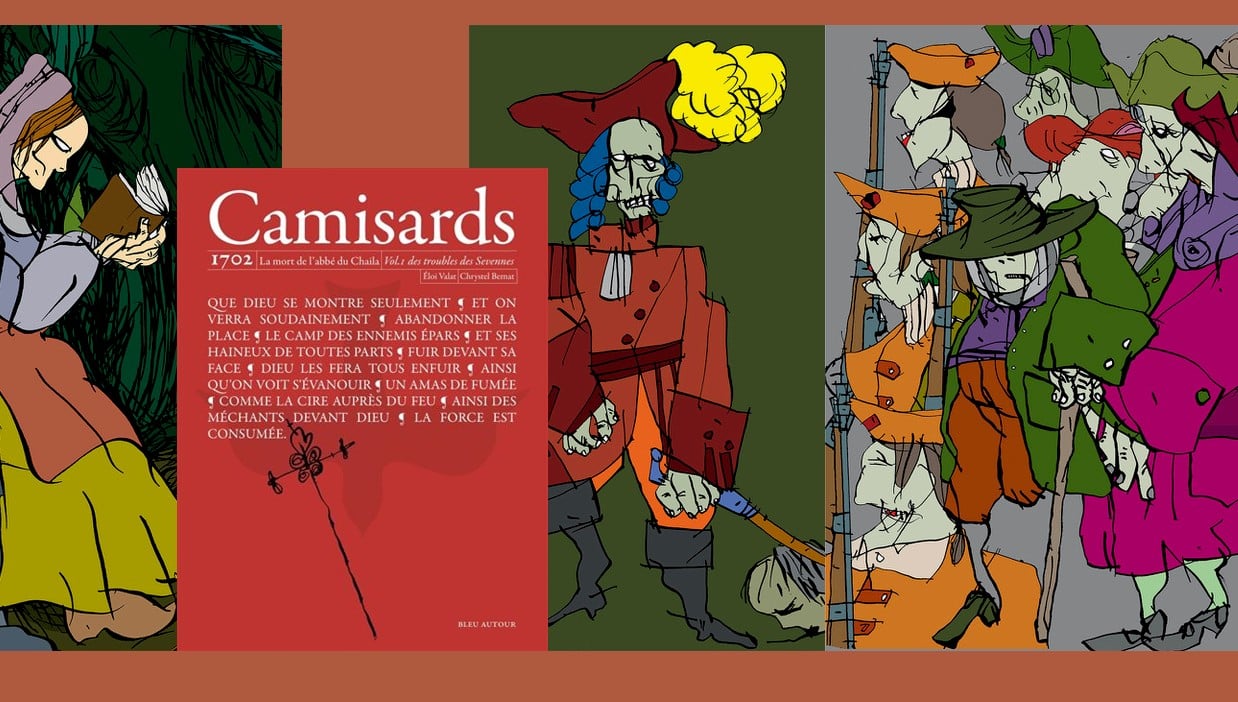Critique ciné publiée le 16 mai 2025 après la projection cannoise
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, Sirat est le quatrième long-métrage du cinéaste galicien Oliver Laxe, déjà salué pour Mimosas, la voie de l’Atlas et surtout Viendra le feu, prix du jury Un certain regard en 2019. Avec cette œuvre dure, sensorielle, et parfois déroutante, il poursuit son exploration de la spiritualité au cœur du chaos contemporain. Sirat est un film radical, exigeant, qui confronte le spectateur à l’expérience brute de la perte, de la foi blessée et d’un possible relèvement – mais à quel prix ? Une quête paternelle, entre exil et initiation…
Un père et son fils parviennent à une « rave « perdue au cœur des montagnes du sud du Maroc. Ils cherchent Mar – fille et sœur – disparue depuis plusieurs mois lors de l’une de ces fêtes sans fin. Plongés dans la musique électronique et une liberté brute qui leur est étrangère, ils distribuent inlassablement sa photo. L’espoir s’amenuise, mais ils s’obstinent et suivent un groupe de « ravers » vers une dernière fête dans le désert. À mesure qu’ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante, le voyage les confronte à leurs propres limites.

Sirat suit donc Luis, interprété par un Sergi López sobre et habité, qui quitte l’Europe pour chercher sa fille disparue dans le désert marocain, après qu’elle aurait été mêlée à une rave aux marges de la légalité. Il emmène avec lui Esteban, son fils cadet, témoin muet de cette errance douloureuse. Ce point de départ simple prend rapidement une tournure parabolique : plus qu’une enquête ou une aventure, c’est une traversée intérieure, une descente aux enfers qui évoque les figures de Job ou d’Abraham.
Une esthétique du dépouillement et de la tension
D’un point de vue formel, Sirat est un choc. Tourné en pellicule Super 16 mm, le film adopte une texture visuelle rugueuse, granuleuse, presque poussiéreuse. Le chef opérateur Mauro Herce (déjà à l’œuvre sur Fire Will Come) signe une photographie sublime et aride, jouant sur les ombres, les couchers de soleil écrasés, les visages marqués par la fatigue. La lumière n’éclaire pas, elle révèle. Elle éclaire l’attente, la souffrance, mais jamais l’espoir facile. Le son, lui, devient presque un personnage : bourdonnements sourds, silences suspendus, sons électroniques distordus, nappes d’angoisse qui envahissent l’espace mental du spectateur. La musique de Kangding Ray, minimaliste et industrielle, s’installe naturellement par la scène de la rave party pour ensuite durer et accompagner, rendant compte du trouble intérieur de Luis, et transformant le désert en lieu d’épreuve mystique. À noter d’ailleurs ses baffles qui jouent un rôle métaphorique important et là encore durable… avec une scène notamment où un haut-parleur déchiré et abandonné va pouvoir servir à nouveau pour apporter un son différent mais pas reconnu de tous. Que celui qui a des oreilles…

Une histoire de perte et d’après, incertaine
Sirat n’offre ni consolation ni conclusion. C’est un film qui affronte la perte sans fard : celle d’un enfant (et peut être d’avantage), d’un sens, d’un monde où les repères moraux seraient stables, d’un monde tout simplement tel qu’on le connait jusque-là. Luis n’est pas un héros, il est un homme brisé. Mais dans cette descente qui semble conduire de l’enfer vers l’enfer, quelque chose résiste. Peut-être une suite. Peut-être une vie après. Mais cette vie sera marquée, creusée. Rien n’y sera innocent. Le désert n’est pas seulement un lieu, c’est une épreuve spirituelle, une confrontation avec l’abandon – des autres, de Dieu, de soi-même.
Une traversée du désert aux accents bibliques
Le titre du film, Sirat, prend tout son sens à la lumière de la tradition musulmane. Le pont al-Ṣirāṭ, évoqué dans plusieurs versets du Coran et développé dans les traditions eschatologiques, désigne le pont qu’emprunteront les âmes lors du Jugement dernier. Il est décrit comme plus fin qu’un cheveu et plus tranchant qu’une épée – une image extrême, douloureuse, évoquée dès l’ouverture du film. En titrant ainsi son film, Oliver Laxe inscrit sa fable dans une perspective spirituelle universelle : Sirat devient le nom d’un chemin périlleux, à la fois concret (la traversée du désert), symbolique (le deuil, l’errance, la quête), et mystique (le jugement intérieur que Luis traverse). Chaque pas est une mise à l’épreuve, chaque silence une interrogation sur sa propre humanité. Dans cette lecture croisée, Sirat rejoint non seulement l’histoire de Job, confronté au silence de Dieu dans sa souffrance, mais aussi une tradition islamique où le salut n’est jamais garanti, où l’homme marche sur un fil, entre justice et perdition.

Cette image théologique donne toute sa portée au film : Luis marche sur ce fil, suspendu entre justice et perdition, entre fidélité et oubli, en suivance de personnages qui pourraient s’apparenter à des anges déchus mais bienveillants. Le film pourrait être lu comme une méditation sur l’épreuve, au sens biblique du terme. Comme Job, Luis perd tout, mais ici rien ne lui est restitué de façon spectaculaire. Finalement, la dignité de l’homme réside peut-être dans le fait même de tenir debout, de continuer à marcher, au-delà du désespoir.
Un film qui appelle au discernement
Oliver Laxe ne fait vraiment pas un film facile, ni aimable. Il exige du spectateur une immersion totale, un consentement à l’inconfort, à la lenteur, au mystère, au choc, une acceptation à être violenté psychologiquement. Il n’explique pas tout, il laisse des trous, des silences, des fractures. Mais c’est justement là que Sirat résonne avec une éthique chrétienne du regard : ne pas fuir la souffrance, mais chercher à la comprendre, à l’habiter, à lui opposer une espérance lucide.
Sirat est de ces films rares, qui parlent moins à la raison qu’à l’âme, et qui demandent aussi une certaine forme de « digestion » intérieure. Pour qui accepte de se laisser traverser, c’est une œuvre qui pourra marquer durablement.