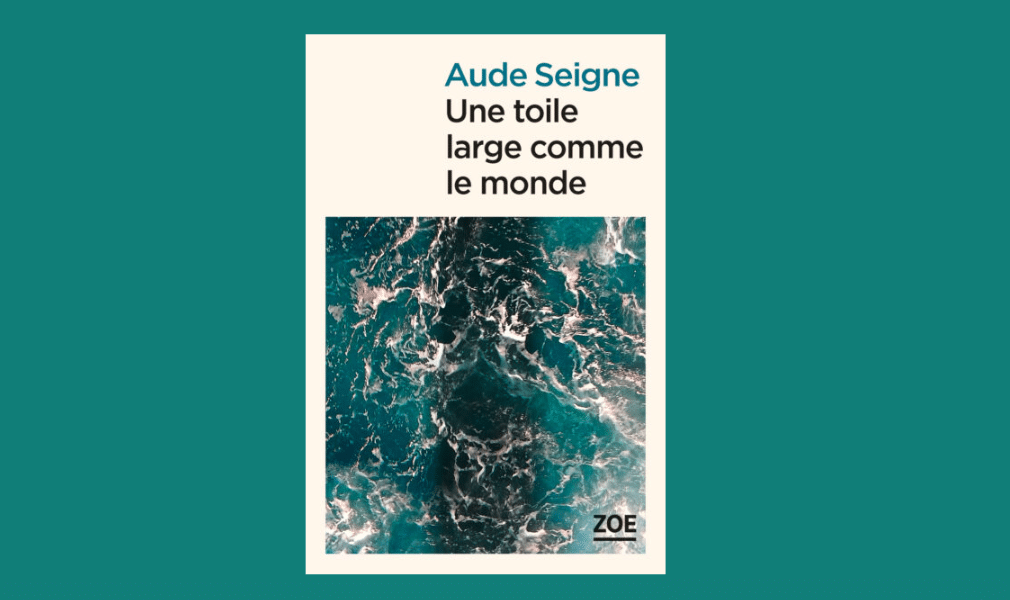Film de toute beauté qui devient sans doute aussi une leçon sur l’éphémère possible des honneurs et sur les risques d’un hédonisme exacerbé pouvant détruire les êtres les plus aimés.
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d’hôtel miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l’envahissent…
Est-ce bien lui celui qui, un jour, a été l’homme le plus célèbre de Londres ? L’artiste conspué par une société qui autrefois l’adulait ? L’amant qui, confronté à la mort, repense à sa tentative avortée de renouer avec sa femme Constance, à son histoire d’amour tourmentée avec Lord Alfred Douglas et à Robbie Ross, ami dévoué et généreux, qui a tenté en vain de le protéger contre ses pires excès ?
De Dieppe à Naples, en passant par Paris, Oscar n’est plus qu’un vagabond désargenté, passant son temps à fuir. Il est néanmoins vénéré par une bande étrange de marginaux et de gamins des rues qu’il fascine avec ses récits poétiques. Car son esprit est toujours aussi vif et acéré. Il conservera d’ailleurs son charme et son humour jusqu’à la fin : « Soit c’est le papier peint qui disparaît, soit c’est moi… »
C’est Everett lui-même qui incarne un Wilde vieillissant, installé dans la débauche et choisissant clairement l’autodestruction. Un personnage hors-normes à la fois révulsant et attachant, fait de paradoxes entre brillance et vulnérabilité où se côtoient cet affreux bonhomme et ce personnage authentique refusant les faux semblants, se battant, coûte que coûte, pour conserver son sens de l’autodérision dans les ténèbres de son existence et l’adversité cruelle à laquelle il fait face. Car il faut le reconnaître, le « mal » est loin de se cantonner d’un seul côté de la barrière !… Pour exemple, cette sublime scène qui place Wilde en bagnard sur le quai d’une gare, insulté par la vindicte bourgeoise après sa libération et réduit au rang de monstre. La scène rappelle magnifiquement celle d’ »Elephant Man » où le monstre de foire est acculé par des voyageurs, avec notamment, des gros plans de visages haineux et moqueurs qui font froid dans le dos… Et c’est aussi finalement ce qui nous interroge tout au long du déroulement de l’histoire quant à cette société d’un temps passée, sauvage et pleine de froide cruauté, mais tellement ressemblante encore à la nôtre à bien des égards.
J’oserai envisager ici une certaine « figure christique » qui apparait en la personne d’Oscar Wilde. Une métaphore qui, j’en convient, peut certes déranger fortement le croyant tant le personnage de Wilde est éloigné de l’image même du Christ, mais malgré tout, à certains égards, la comparaison est intéressante. Notamment dans la possibilité d’observer comment le rejet et la mise au ban de la société s’opère et impacte un homme et son entourage.
The Happy Prince raconte donc la déchéance… c’est un récit de chute des sommets les plus éclatants aux profondeurs les plus sombres et douloureuses. Et à ce titre encore, le film ne s’enracine pas idéologiquement dans une époque spécifique ou un unique personnage, mais devient parabolique. De l’Antiquité à aujourd’hui combien de Wilde ? Et chacun de nous peut aussi s’y retrouver à des titres divers en usant d’un peu d’honnêteté…
Ruppert Evertt a fait de The Happy Prince également un « survival movie », évidement loin (par le récit) de « The revenant » d’Alejandro González Iñárritu, de « Seul au monde » de Robert Zemeckis ou de « Seul sur Mars » de Ridley Scott… mais il rejoint cette trempe de réalisateurs dans cette capacité de filmer avec beauté et acuité la survie, ou plutôt peut-être plus encore, la quête de la vie. Wilde est en effet un homme qui n’a plus rien à perdre, puisqu’il a déjà tout perdu et que sa seule raison de vivre est maintenant de chercher à survivre en donnant encore sens à ce en quoi il croit sans doute encore… l’amour et la poésie. Alors certes, un amour qui souffre, fait souffrir et une poésie qui ne touche plus grand monde mais qui illumine malgré tout le cœur de deux enfants.
Parlons maintenant d’aspects cinématographiques. La photographie remarquable tout d’abord, de John Conroy, avec des lumières changeantes, selon que l’on se trouve à Londres, Naples, Dieppe ou Paris et avec les décors de Brian Morris et les costumes de Maurizio Millenotti et Gianni Casalnuovo apporte des ambiances extrêmement porteuses comme un écrin élégant pour le récit. On passe avec charme de la magnificence des palais et des théâtres à l’ambiance décadente des bouges ou des hôtels miteux.
Le casting est évidemment brillant avec des comédiens d’envergure autour de Rupert Everett qui tient là son plus beau rôle. Colin Firth, Tom Wilkinson, Emily Watson, bouleversante dans le rôle de cette épouse sacrifiée, et même une courte apparition de Béatrice Dalle en tenancière d’une auberge dans laquelle Oscar chante, rôle qui lui colle à la peau.
Et puis enfin, LA musique de l’immense Gabriel Yared toujours aussi impressionnant de justesse et d’intelligence qui fait ici l’astucieux choix de la simplicité et de la discrétion dans l’expression belle, délicate et sombre comme il le faut quand il le faut.
Si le réalisateur se dit avoir été « fasciné par la chute qui a suivi l’état de grâce d’Oscar Wilde » il réussit, avec The Happy Prince, à nous fasciner à notre tour en nous offrant un très grand film !