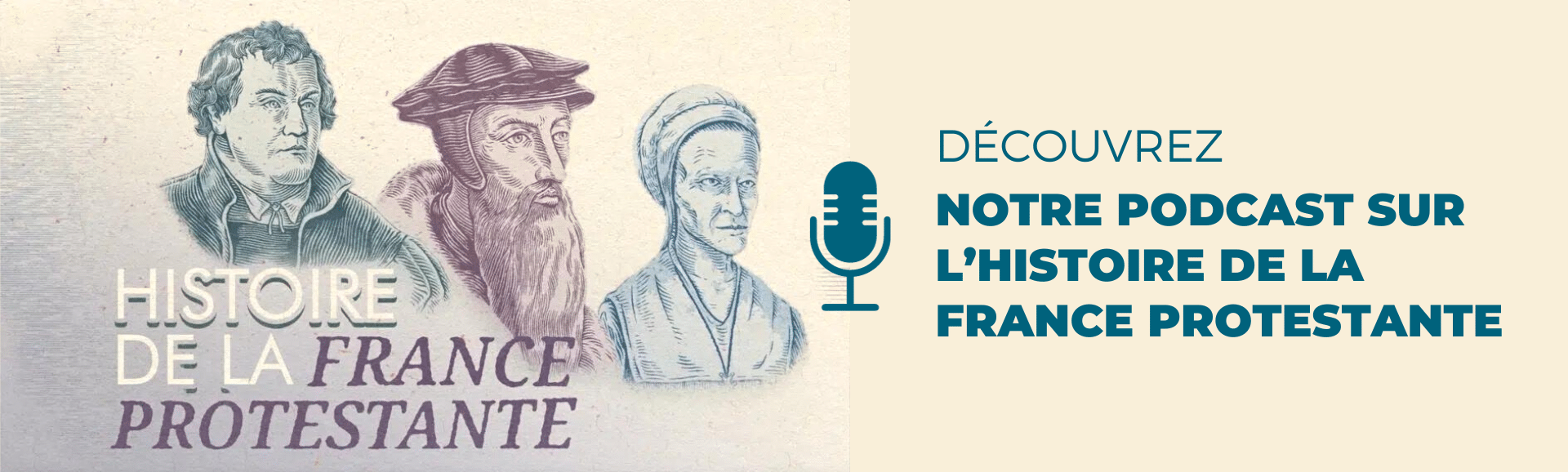Un chant du signe d’une force incomparable qui porte au plus haut les valeurs humaines qui lui sont fondamentales et qui peuvent se résumer avec ces trois mots qui s’inscriront comme une devise dans le film : Force, solidarité, résistance.
TJ Ballantyne est le propriétaire du “Old Oak”, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l’endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d’amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté́ locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines.
L’action se déroule dans le nord de l’Angleterre, en 2016, indique une légende. Plus précisément, nous sommes près de Durham, dans un village qui ne s’est jamais remis de la fermeture des mines dans les années 1980. Ce passé est un élément important dans la construction du film, car il sera une résonnance permanente pour l’histoire qui se déroule.

The Old Oak est l’histoire d’un lieu de rassemblement et de ce qu’il peut signifier pour une communauté. Dans ce cas-ci, le lieu est précisément chargé d’histoire, car l’arrière-salle de TJ, fermée depuis longtemps, est un sanctuaire vivant des luttes de la grève des mineurs – ce qui déclenche un commentaire sur la façon dont le démantèlement de l’industrie minière a à la fois fragmenté les communautés et semé les graines des attitudes racistes.
De ces années de luttes, de grèves, et où la misère s’est installée, demeure des photos et une phrase : « Quand on mange ensemble, on se serre les coudes » (décidemment la table, et avec la nourriture, sont des incontournables de cette année). Ce passé va pouvoir être revisité à nouveau dans un contexte très différent, celui de l’arrivée de ces familles de réfugiés. Mais, les oppositions restent violentes, expression de ce racisme ordinaire et, plus profondément encore, de peurs et de blessures enfouies, celles de cette société qui perd ses valeurs dans cette misère sociale environnante.

L’une des forces de Ken Loach, cette fois-ci encore, est de réussir à porter un message d’ensemble en s’intéressant à des parcours individuels. Il y a ainsi la rencontre de deux communautés différentes, et le film va devenir alors un témoignage de la force du collectif, de ce que la solidarité peut transformer, même quand tout semble perdu d’avance.
Mais le cinéaste britannique, avec cette empathie qui le caractérise, offre également un chœur de voix individuelles, incarnant leurs propres contradictions et nuances. Ces petits récits donnent de la chair à l’ensemble. Ils permettent de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Ils évitent aussi de tomber dans des clichés trop faciles sur le sujet ou dans un manichéisme qui gâcherait forcément le propos.
Ken Loach explique à ce propos qu’« il n’y a pas de méchants absolus ici. Un sentiment d’injustice peut pousser les gens vers les extrêmes, mais leur comportement est toujours motivé par une certaine logique. Si on passe à côté de cette dimension, on appauvrit la dramaturgie. » Rien de tout cela donc, mais une bouleversante vague d’humanité qui vous inonde.
J’aurais aussi envie de noter que, pour une fois, l’Église montre ici son beau visage. Elle n’est pas forcément au centre de tout, mais elle apporte sa pierre à l’édifice du vivre ensemble. Elle dit tout simple Dieu et son amour pour le monde.
Et si Ken Loach, qui clôturait la présentation des films en compétition, et pour son grand final personnel, renversait tout et repartait avec une troisième palme d’or, et/ou un troisième prix du Jury œcuménique. Ce ne serait que tant mérité…