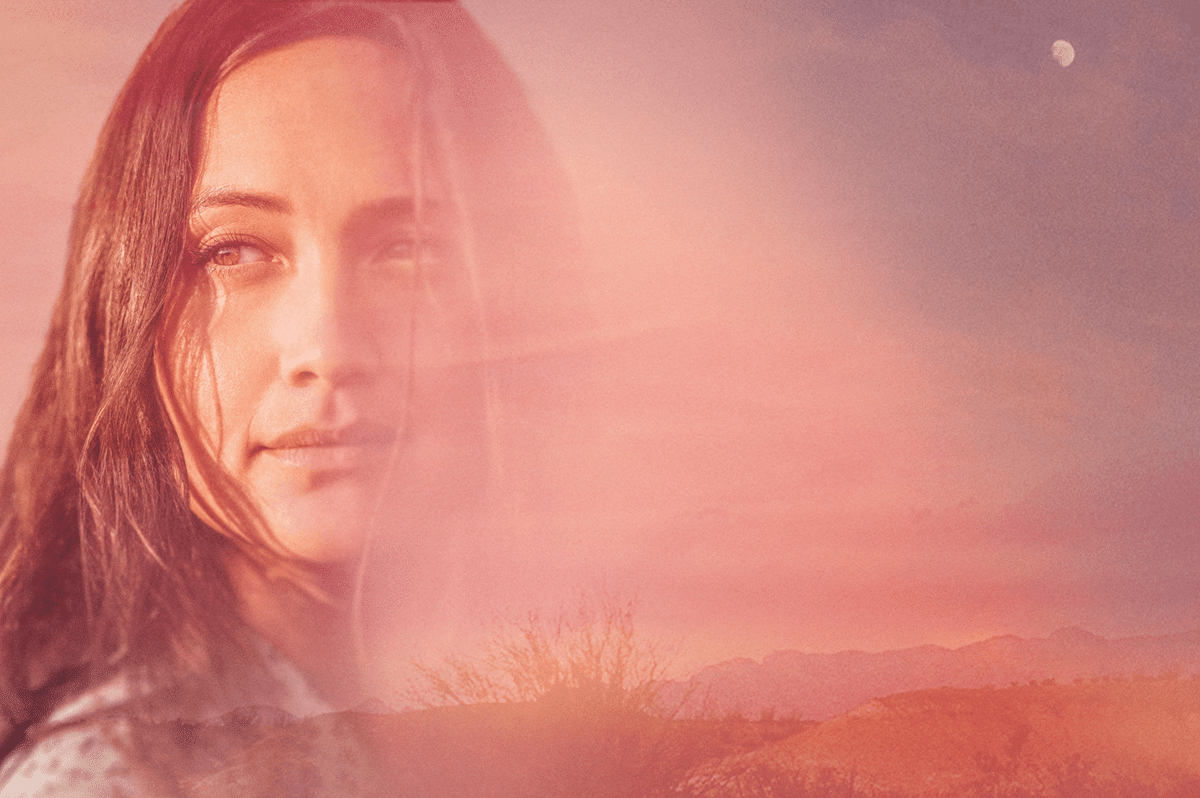En 2020, Anthony Hopkins performait dans le rôle d’un père âgé atteint de démence. The Son peut être vu comme une sorte de préquelle qui suit le fils du personnage de Hopkins, joué par Hugh Jackman, qui fait de son mieux pour comprendre son propre fils qui lutte contre la dépression.
Comme The Father, mais en abordant un autre versant de la maladie, The Son offre un portrait dévastateur de la maladie mentale. C’est un film bouleversant avec des performances époustouflantes, qui ne nous laisse pas totalement indemne.
Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Or, peut-on vraiment sauver quelqu’un d’autre que soi-même ?
The Son fait donc partie de la trilogie théâtrale de Zeller sur la famille, la fragilité et les liens que nous entretenons les uns avec les autres lorsque les choses vont mal et que les temps sont durs. Le dramaturge français devenu réalisateur aborde donc à nouveau la question des souffrances psychologiques telles que la dépression et les pensées suicidaires à travers un prisme ouvert et terriblement sincère (trop peut-être pour certains), montrant les nuances de la maladie et la façon dont elle affecte tous ceux qu’elle touche directement ou indirectement.

Pas de méchant dans l’histoire car, dans la vie réelle, il n’y a pas de personnes parfaites, ni de bons ou de méchants absolus. Les personnalités se déclinent en plusieurs nuances de gris. Lorsque Peter apprend que Nicolas n’est pas allé à l’école pendant un mois entier et qu’il le confronte, il ne le punit pas mais lui demande pourquoi et cherche à comprendre ce qui se passe. C’est un père attentionné qui veut aider son fils, et qui, avec la mère, fera aussi son lot d’erreurs et de choix contestables. C’est l’une des choses très appréciable d’ailleurs du scénario. La dépression peut être présentée comme une ombre ténébreuse et inquiétante qui plane sur cette famille, mais aucune culpabilisation ne se fait véritablement sentir, même si certaines accusations sont lancées parfois, comme c’est le cas aussi souvent dans la vraie vie. « Quand tu te fais mal, c’est comme si tu me le faisais à moi », dit Peter à son fils. « Quand tu as quitté maman, c’est comme si tu me le faisais », lui répond instantanément son fils, plein de rage.
Si le cœur du scénario est véritablement là avec la maladie dont souffre Nicolas, on peut aussi observer d’autres thématiques qui y font écho et viennent nourrir la réflexion. Il y a la transmission générationnelle notamment. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, celui que l’on m’a fait… Et comment ne pas alors évoquer la scène avec le propre père de Peter, joué naturellement par Anthony Hopkins, un type narcissique et un père négligent. Peter a beau vouloir se libérer de ce fardeau et agir différemment, il ne peut s’en empêcher et reproduit certains gestes ou prononce certaines paroles qui lui ont tant fait mal.
C’est aussi la construction familiale qui est en jeu avec la difficulté de recomposer sa famille, les choix de carrière personnels mais aussi ceux que l’on prend pour ses enfants. L’écoute est mise à mal (intéressant en début de film de voir la mère et le fils se parler mais sans jamais finir leurs phrases…).

Le rapport à la médecine est aussi effleuré avec la difficulté, la souffrance même, de devoir parfois prendre des décisions impossibles humainement. Zeller ose et ne fais pas dans la dentelle. Son casting est à la hauteur. Jackman, McGrath, Kirby et Dern sont tous excellents. Mais il est clair que tout cela fait mal, très mal… et dérange. Le fait d’être bouleversé par telle ou telle scène ou tel ou tel moment fait en fait partie du plan de Zeller en tant que cinéaste, qui nous encourage là à examiner nos sentiments avec honnêteté. Il y a ce moment clé où tout spectateur se sentira accablé par une décision qui est à prendre. Le film fait un choix, nous conduisant alors sur un chemin, mais cela vaut aussi la peine de s’interroger pour chercher si l’autre chemin aurait fonctionné (ce que Zeller nous propose d’ailleurs aussi peut-être…).
Mais finalement justement, le but de Zeller est sans doute de nous faire discuter du film – tout le propos est là : Nous devons en parler ! Et si pour les personnages, c’est malheureusement très difficile à faire ; pour nous spectateurs, les émotions et les rebondissements de l’histoire nous offre intensément cette possibilité. Il est impossible de ne pas avoir quelque chose à dire, à se dire, même, après avoir vu ce film, au-delà de notre avis cinématographique, et de nos émotions.
Tout cela me fait aussi penser au fait que le texte biblique nous raconte l’histoire du viol horrible de Tamar, de certains massacres d’enfants, de Sodome et Gomorrhe, de Job, de la lapidation d’Etienne, des déviances mortifères de David… Oui, la Bible parle aussi de l’horreur et ne fait pas non plus dans la dentelle souvent. Elle ne la met, en tout cas, pas sous le tapis pour faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes.
Alors, si pas mal de feel-good movies sortent sur les écrans actuellement (je pense à Les petites victoires, mais aussi d’une autre façon à The Fabelmans par exemple) et font terriblement du bien, il est vrai, nous avons besoin de film comme The Son, qui ne font pas du bien de la même manière, mais qui ouvre au dialogue, à la réflexion et donc à la vie.