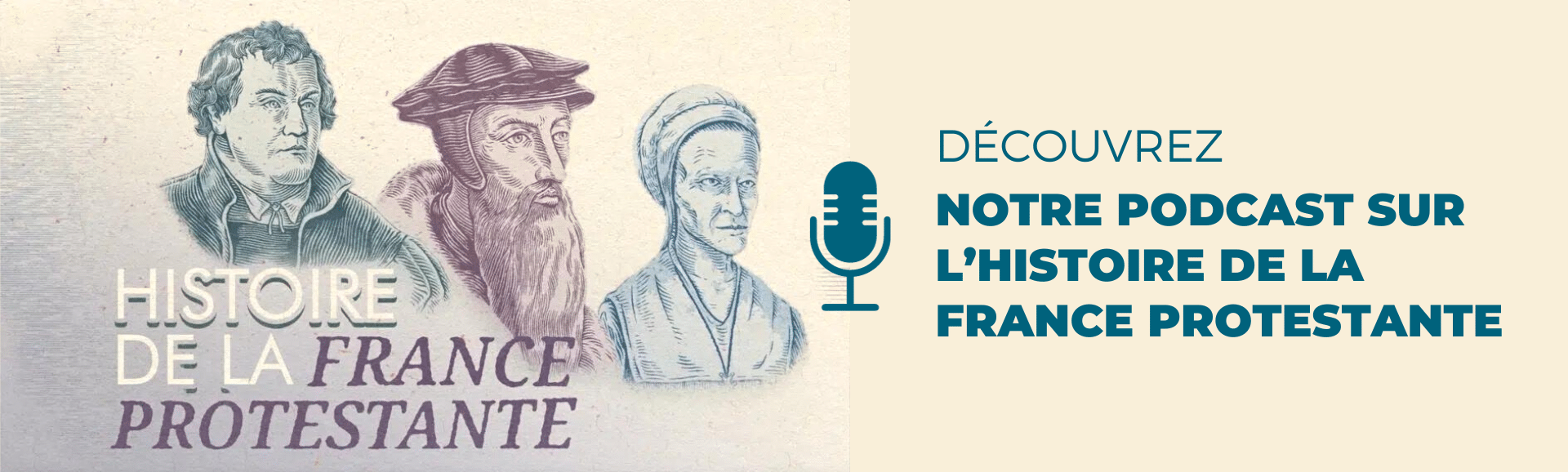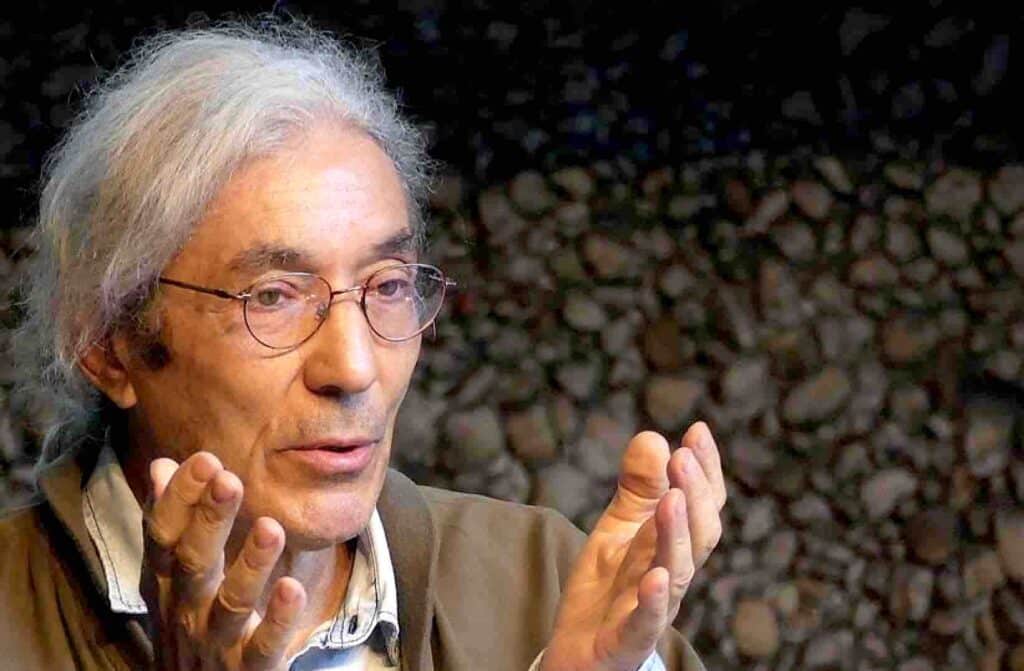Après l’univers si particulier de la famille Dorkel et la communauté des gens du voyage dans le nord de la France mis en lumière dans La BM du Seigneur et Mange tes morts, Jean-Charles Hue nous transporte aujourd’hui entre paradis et enfer au Mexique pour Tijuana Bible, son dernier film à voir cet été, à partir du 29 juillet.
De retour d’Irak, Nick Wilson (Paul Anderson) n’a jamais réussi à dépasser Tijuana sur la route du retour au pays. Là, échoué derrière le mur de la frontière, il survit au jour le jour au sein d’une communauté d’exclus de l’Amérique. Un jour, il fait la rencontre d’Ana (Adriana Paz), une jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu, Ricardo. Voulant la protéger malgré elle,il découvre que Ricardo a été déporté au Mexique après son engagement dans l’armée américaine, et que, devenu pasteur, il serait devenu un danger pour les narcos de la ville. Dès lors, il va faire tout son possible pour la convaincre de quitter Tijuana.

Disons le sans détour, Tijuana Bible est un film dur qui aborde le sujet peu connu de la déportation de vétérans américains. Ici, les clichés sont chamboulés, avec un inversement de ce que l’on raconte habituellement. C’est-à-dire, non pas le passage de la frontière vers les Etats-Unis, mais un Américain qui va « se réfugier » au Mexique. Et, au travers du prisme de la situation de ce GI, c’est la ville même de Tijuana, et son quartier nord en particulier, qui devient le sujet majeur du scénario. Le réalisateur français qui connait parfaitement les lieux, après plusieurs voyages et tournages, explique ainsi les choses : « C’est le quartier de la prostitution et de la drogue, auquel s’ajoute toute la faune interlope qui s’acoquine à ça … C’est la Cour des miracles dans le Paris de François Villon, à la différence que même si c’est très petit, c’est vraiment le cœur de Tijuana, qui est une ville qui a été conçue « pour le plaisir » des Américains : jeu, alcool, prostitution (hommes ou femmes). Une fois que tu es dans la Zona Norte, il y a une forme d’égalité. Les Mexicains ne sont pas dupes, ils savent très bien que les gringos sont bien souvent des white trash, des traine savates, ils pourraient leur reprocher les déportations mais ils ne leur disent rien. Tout le monde est dans le même bain. La Zona Norte est une affaire d’ambiguïtés. Ce n’est pas facile à montrer. Beaucoup de gens tombent amoureux de cet endroit. Ils ont pourtant de réels problèmes, mais ils n’arrivent pas à en décoller, ça devient leur identité. Si tu te drogues là-bas, tu n’es pas seulement un drogué isolé comme tu le serais ailleurs. Il y a tous ces néons la nuit… quelque chose de féérique et dangereux où les gens ont l’impression de vivre intensément, quitte à se brûler. »
C’est une lente plongée dans les eaux crasseuses d’un territoire où l’espérance n’a plus de raison d’être et où pourtant peuvent jaillir parfois, tels des miracles divins, des personnes qui manifestent la compassion et la bienveillance. L’absent du film physiquement, mais constamment au coeur de l’histoire, en est un exemple… Ricardo… le bon pasteur, inspiré de l’authentique récit d’un ancien marine déporté des Etats-Unis tombé dans la drogue à Tijuana, qui, après la rencontre avec des chrétiens évangéliques, a vu sa vie transformée, est devenu ce pasteur un peu étrange, en uniforme de cérémonie et qui a fondé sa propre église. Car, ce qui est aussi sans doute une force du récit, c’est que tous les personnages sont inspirés de la réalité, d’hommes et de femmes de là-bas et d’ailleurs, de parcours de vie et de mort. Avec en plus cette profonde spiritualité sous-jacente, pleine d’ambiguïté comme l’aime Jean-Charles Hue qui cite Thérèse d’Avila pour expliquer son point de vue sur la question. « Dieu marche entre les marmites… Si tu veux trouver Dieu, ne va pas forcément dans une église mais va le chercher entre les marmites. Le canal de Tijuana c’est ça, ce sont des camés mais en même temps c’est la nourriture partagée… Ici les gens sont confrontés tous les jours à la survie, à la mort. C’est à peine nécessaire d’ouvrir la Bible parce que tu l’as sous les yeux. »
Un film intense dans son atmosphère générale, avec une forme de tension constante étonnamment sereine en même temps. Hue joue sur les contrastes sans besoin d’user d’artifices mais en restant dans une approche quasi documentaire immersif de la situation. C’est ainsi par exemple la remarquable scène d’ouverture qui pose les choses avec une certaine force métaphorique qui l’accompagne. Nick, dans une nature sauvage, piège un chien qu’il tue d’un coup de poignard pour ensuite traverser la ville, laissant des tâches de sang sur son passage… et finir par le vendre dans l’arrière cour d’un restaurant asiatique pour quelques billets lui servant à se fournir en came. La caméra suit tout cela de près en nous accrochant ainsi dès les premières images pour ne plus nous lâcher jusqu’au générique final. La loi du plus fort… mais qui est le vrai prédateur dans tout ça ? Le film est ancré par une performance énorme du britannique Paul Anderson (Arthur Shelby de la non-moins excellente série Peaky Blinders) secondé parfaitement par l’actrice et danseuse mexicaine Andriana Paz. La photo de Jonathan Ricquebourg amplifie avec grâce la réalisation déjà extrêmement soignée, apportant une vraie esthétique à ce décor si particulier et à ces « gueules » cassées et ces corps meurtris.
Si les blockbusters des studios hollywoodiens font défauts dans les salles cet été, c’est peut-être l’occasion idéale pour découvrir d’autres formes de cinéma. Se laisser toucher par des auteurs, des histoires, des lieux, des comédiens et comédiennes de talent… Et Tijuana Bible est un sacré spécimen en la matière, croyez-moi.