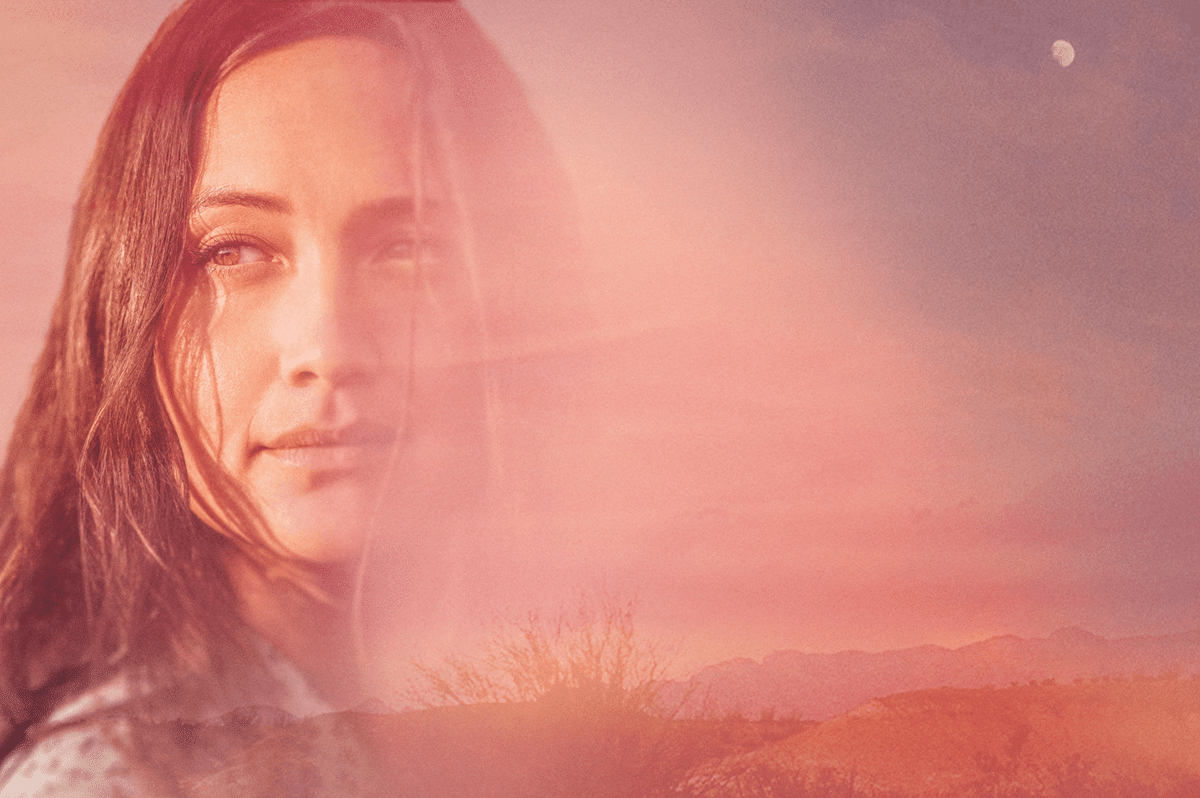Premier long-métrage du soudanais Amjad Abu Alala d’une grande maîtrise technique et artistique qui lui a valu un Lion du futur (meilleur premier film) à la Mostra de Venise, cette fable initiatique nous plonge au cœur d’une malédiction où tout avenir est exclu… une thématique qui ressemble vite à une métaphore puissante bien plus large que la simple histoire racontée, comme un hymne à la liberté.
Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de Muzamil ne peut pas supporter cette malédiction et quitte le foyer. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans…
Qu’est-ce que cela fait d’être vivant, mais en même temps mort de l’intérieur ? Comment peut-on vivre tout en anticipant la mort, respirer tout en sachant à chaque seconde que la mort est au coin de la rue ? Tu mourras à 20 ans d’Amjad Abu Alala aborde la question du poids de la croyance. C’est un regard sur la foi, ou plutôt sur son dilemme, dans une région particulièrement marquée pour sa dévotion aveugle à tout ce qui est spirituel. La foi nous rend-elle, en quelque sorte, plus vivants et plus attentifs à ce qui nous entoure ? Ou bien nous tire-t-elle en arrière lorsque, au nom de la piété ou de la tradition, nous perdons notre sens de l’aventure, notre volonté d’explorer la vie et l’amour pour donner la priorité aux opinions de la société qui nous entoure, à l’approbation des parents et que nous succombons à la pression de nos pairs ?
Ce sont là quelques-unes des questions très difficiles, et tout aussi complexes, qu’Abou Alala explore dans son premier long métrage. Tout en partageant certaines similitudes thématiques avec un autre premier film arabe remarquable (Le Miracle du saint inconnu d’Alaa Eddine Aljem, dont la première mondiale a eu lieu lors du dernier festival de Cannes dans la Semaine de la Critique), Tu mourras à 20 ans est une œuvre plus dense et plus complexe, filmée avec une photographie lumineuse, une bande-son obsédante et une approche étonnamment poétique qui la rend à la fois extrêmement réfléchie et pleine de fraîcheur candide, même si quelques scènes sont sans doute légèrement trop longues.
Une mère, Sakina (magnifiquement jouée dans une performance presque muette par l’actrice Islam Mubarak), se rend à un rituel religieux dans l’espoir de recevoir la bénédiction d’une des figures religieuses du village pour son fils nouveau-né. Lorsqu’un incident se produit sur place, on pense que le garçon est associé à une malédiction qui ne le fera vivre que jusqu’à l’âge de 20 ans. Incapables de se débarrasser de la malédiction, malgré leur extrême dévotion, la mère et le fils partagent une vie qui s’apparente davantage à la mort puisqu’ils comptent les jours jusqu’à ce que Muzamil atteigne l’âge de 20 ans, et quitte donc ce monde. En anticipant la mort pendant ces années, ils se transforment en morts-vivants dont la maison ressemble à une tombe et dont les cœurs ne font que fonctionner automatiquement. Au fond d’eux-mêmes, ils sont partis depuis longtemps, sans aucune volonté de vivre, sans aucun espoir en vue.
Ce qui rend le film d’autant plus unique et certainement stimulant pour tous ceux qui refusent l’abnégation comme mode d’existence, c’est ce choix de prendre un protagoniste délibérément passif et le placer dans diverses situations qui cimentent encore plus sa réticence à changer un destin qui lui est imposé. Ainsi, lorsque le changement se produit vers la troisième partie du film, dans un final vraiment magnifique, on comprend qu’Abu Alala n’est pas intéressé par un cadre narratif conventionnel où un personnage est soudainement éclairé pour changer de chemin, ni par une catharsis dramatique qui change sa vie. En représentant une soumission extrême à la religion, au destin et aux superstitions, le réalisateur met le spectateur au défi de se connecter avec un tel personnage passif. Pour certains, cela peut être frustrant. Mais la réalité est ainsi et sans doute bien pire encore avec tant de personnes complètement enfermées dans une vie qu’ils n’ont pas choisie, façonnées par des destins scellés. C’est d’ailleurs ce qu’explique Abu Alala : « Le film montre comment une forte croyance peut affecter la vie des gens – et la façon dont cette foi peut être instrumentalisée politiquement. Le gouvernement soudanais d’Omar el-Béchir a utilisé l’Islam pour faire taire le peuple – quand quelqu’un dit « C’est la parole de Dieu », plus personne ne peut parler… Mon film est une invitation à être libre. Rien ni personne ne peut vous dire : voici votre destin, il est écrit quelque part. C’est à vous de décider ce que sera votre vie. »
Pour Muzamil, son réveil arrive tard mais il est d’autant plus crédible qu’il sort enfin de cette prison invisible de superstitions et de croyances imposées. La scène finale, qui hante par sa beauté, sa musique et sa cinématographie, dit tant de choses sur l’état du Soudan en ce moment, d’autant plus que le pays se réveille d’une règle islamique qui a dépouillé des millions de personnes de leur bien le plus important : la vie. Ce n’est pas la pauvreté ni le manque de moyens qui ont fait mourir des millions de Soudanais de l’intérieur, affirme Abu Alala, mais c’est le manque d’action, l’absence de remise en cause du statu quo, l’incapacité ou la réticence de celui-ci à remettre en cause les notions établies et les figures autoritaires de la religion et du pouvoir très respectées. Et la course finale de Muzamil dans le film est une métaphore du geste du peuple soudanais en ce moment-même. Alors nous pouvons en rester, bien sûr, à cette explication et ce contexte politique et religieux du Soudan et de quelques autres pays plus ou moins identiques, mais la force de Tu mourras à 20 ans est aussi, par une lecture plus large encore, de pouvoir interpeller chacun sur son existence, sur son rapport à sa propre vie et à sa relation aux autres.
Un premier long métrage complexe, étonnant et sophistiqué d’Amjad Abu Alala qui est une réalisation majeure pour le cinéma soudanais mais qui sait aussi utiliser un langage universel. Un premier long métrage plein d’assurance qui ressemble déjà à un accomplissement.