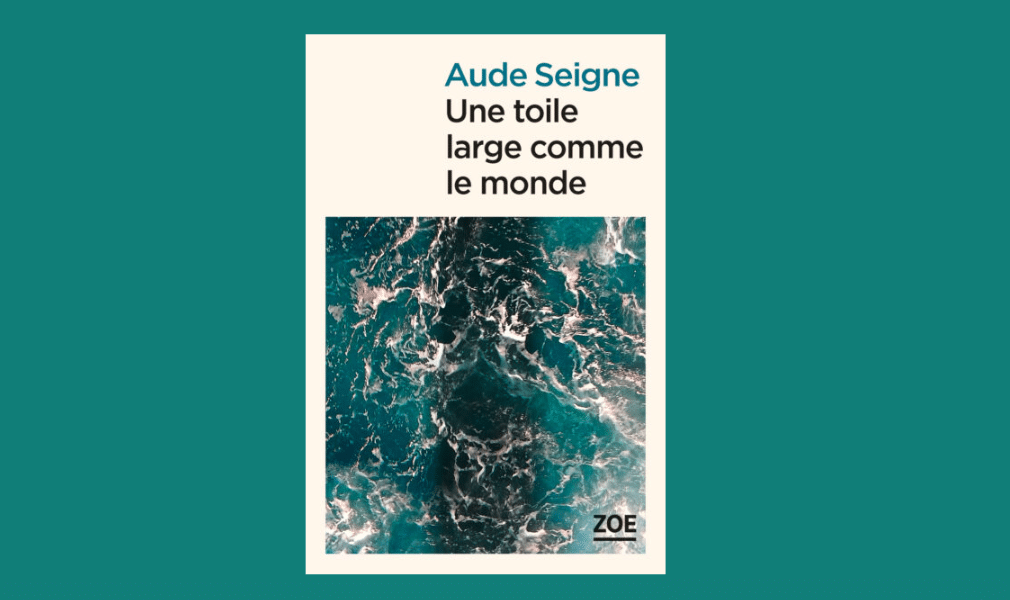Un Fils du Sud s’inscrit dans le grand mouvement des droits civiques des années 60 aux États-Unis, et précisément dans la suite du positionnement héroïque de Rosa Parks. Un scenario adapté de l’ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement. Produit par Spike Lee, le drame de Barry Alexander Brown offre de belles performances et une évocation vivante d’une période tumultueuse pas si éloignée et qui génère hélas de terribles échos avec la période actuelle.
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.
Si Barry Alexander Brown dresse un portrait admiratif de Bob Zellner, petit-fils d’un membre irascible du Ku Klux Klan, qui inversement se tourne vers la défense des droits civiques au début des années 1960, le réalisateur évite tout de même avec finesse et intelligence la plupart des clichés attendus sur le « sauveur blanc » propres à ce genre de scénario. Le biopic de Brown, bien conçu et convaincant, notamment dans la retranscription à l’écran de l’époque, trouve un bon équilibre dramatiquement sain et émotionnellement satisfaisant entre l’éveil moral de son protagoniste blanc et ses relations avec des leaders et des militants noirs tantôt encourageants, tantôt sceptiques.

Bob, interprété par Lucas Till qui dégage une sincérité qui convient au rôle, avec quelques amis étudiants, s’est lancé dans un travail de recherche académique sur la question des relations raciales. Ils décident interviewer le révérend Ralph Abernathy (Cedric the Entertainer) et Rosa Parks (Sharonne Lanier) dans une église baptiste à l’occasion du cinquième anniversaire du boycott des bus de Montgomery en 1955-1956. L’une de leurs professeurs (Nicole Ansari-Cox), une émigrée allemande qui a connu l’horreur nazie, lui conseille vivement d’éviter une situation potentiellement explosive. Même le révérend Abernathy dit au jeune blanc aux yeux écarquillés qu’il ne sait peut-être pas dans quoi il s’engage. Mais Bob persiste – et se fait arrêter et quasiment expulsé de Huntingdon. De fil en aiguille, Bob entre en contact avec de sympathiques libéraux blancs, dont la journaliste britannique Jessica Mitford (Sienna Guillory).
Plus important encore, il se fait ouvrir les yeux par Rosa Parks, qui révèle qu’elle n’était pas l’héroïne accidentelle que son mythe pourrait suggérer lorsqu’elle a refusé de céder sa place dans un bus ségrégationniste. Il y a des moments, dit-elle, où il faut faire des calculs pragmatiques tout en gardant les yeux fixés sur le prix, faisant là référence à des paroles de l’apôtre Paul. Le père de Bob, un pasteur méthodiste (Byron Herlong), marqué lui aussi depuis longtemps par le racisme, donne littéralement sa bénédiction à son fils alors que Bob s’engage sur un chemin qui croise celui des Freedom Riders de Birmingham et des manifestants de McComb, dans le Mississippi. Mais Carole Anne (Lucy Hale), la fiancée de Bob qui le soutenait au départ, finit par exprimer, comme le font généralement les fiancées dans ce genre d’histoires, une désapprobation qui met fin aux fiançailles. Lorsqu’il lui demande, ne serait-ce que pour le plaisir d’argumenter, ce que Jésus pourrait faire à sa place, elle ne veut rien entendre et répond : « Nous savons tous les deux que tu n’es le sauveur de personne » …

Après des décennies de travail exemplaire en tant que monteur pour Spike Lee (qui est producteur exécutif de ce film), mais aussi avec la crème du cinéma indépendant New-yorkais, il n’est pas surprenant que le scénariste-réalisateur Barry Alexander Brown qui a grandi dans le sud des USA, à Montgomery précisément, soit si habile à entrelacer de manière fluide et convaincante des images d’archives d’actualités avec son récit dans Un Fils du Sud. Mais il impressionne également par son expertise lorsqu’il s’agit d’évoquer de manière vivante ce Sud profond des années 60, avec des dialogues et des situations qui sonnent extrêmement justes pour tous ceux qui ont vécu la période du film ou qui ont fait des recherches sur le sujet. Et justement, cette belle histoire peut sans doute inciter de nombreux spectateurs à en apprendre davantage sur les événements décrits ici. Un Fils du Sud se veut abrupt et beau comme le Sud en 1961.
Le rythme y est dynamique avec des dialogues rapides et teintés d’un humour surprenant que Barry Alexander Brown veut miroir de cette culture sudiste. Il a d’ailleurs tout mis en œuvre pour creuser cette authenticité en tournant le plus de scène en Alabama et avec des équipes venant de cette région. Brown est depuis longtemps attiré par les sujets sociaux et politiques sensibles ; il a d’abord fait sa marque avec le documentaire anti-guerre The War at Home (1979), nommé aux Oscars, et on peut penser à quelques autres de ses réalisations comme Lonely in America (1990), qui raconte l’histoire d’un immigrant indien tentant de s’assimiler à la culture américaine, et Sidewalk (2010), un documentaire sur les vendeurs de livres sans domicile fixe de la ville de New York, majoritairement afro-américains. Un Fils du Sud vient donc s’y ajouter et s’impose comme une œuvre solide de cinéma progressiste.
Pour conclure, je voudrai retenir cette phrase forte, dite par Rosa Parks dans un dialogue avec Zellner : « Un jour, quelque chose de vraiment grave va se passer sous vos yeux et vous devrez choisir votre camp, car ne pas choisir c’est déjà un choix ».
Des paroles fondamentales qui nous situent au cœur du sens profond du récit. En décidant de raconter la période où ce jeune étudiant blanc se lance corps et âme dans l’activisme, Barry Alexander Brown prend le parti d’interpeller son public en l’invitant à préférer l’action face à ce qu’il y a de plus violent dans nos sociétés pour ne pas laisser la main aux oppresseurs.
Le film s’inscrit naturellement dans la mouvance du Black Lives Matter et veut être « un cri de ralliement symbolique de la lutte pour l’égalité et la justice d’aujourd’hui ». Mais en sortant en France en ce mois de mars 2022, il s’élargit forcément dans cet appel à ne pas rester spectateur des horreurs que l’homme peut générer mais à oser s’engager, quel qu’en soit le prix, pour que la violence et la guerre ne soient pas les vainqueurs. C’est ainsi qu’Un Fils du Sud trace une véritable ligne de démarcation philosophique et sans doute spirituelle – celle de la liberté de choisir entre l’acceptation et l’engagement, sans être particulièrement moralisateur.
Un film significatif dans ses convictions sur la nécessité pour les gens ordinaires de sortir de leur zone de confort pour rendre le monde meilleur, mais sans jamais « prêcher » ou devenir didactique. Et, déjà juste pour cela, il faut vraiment aller le voir !