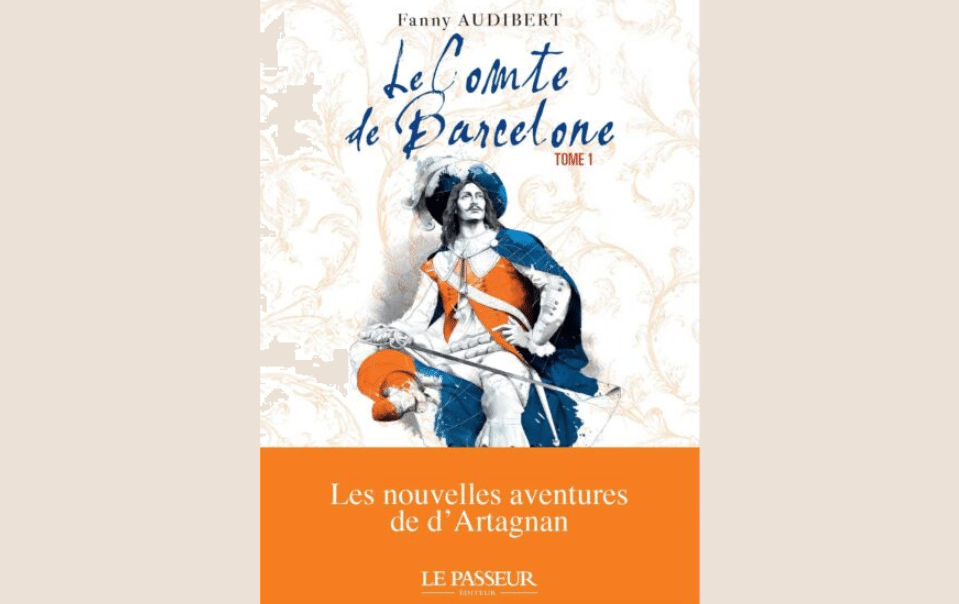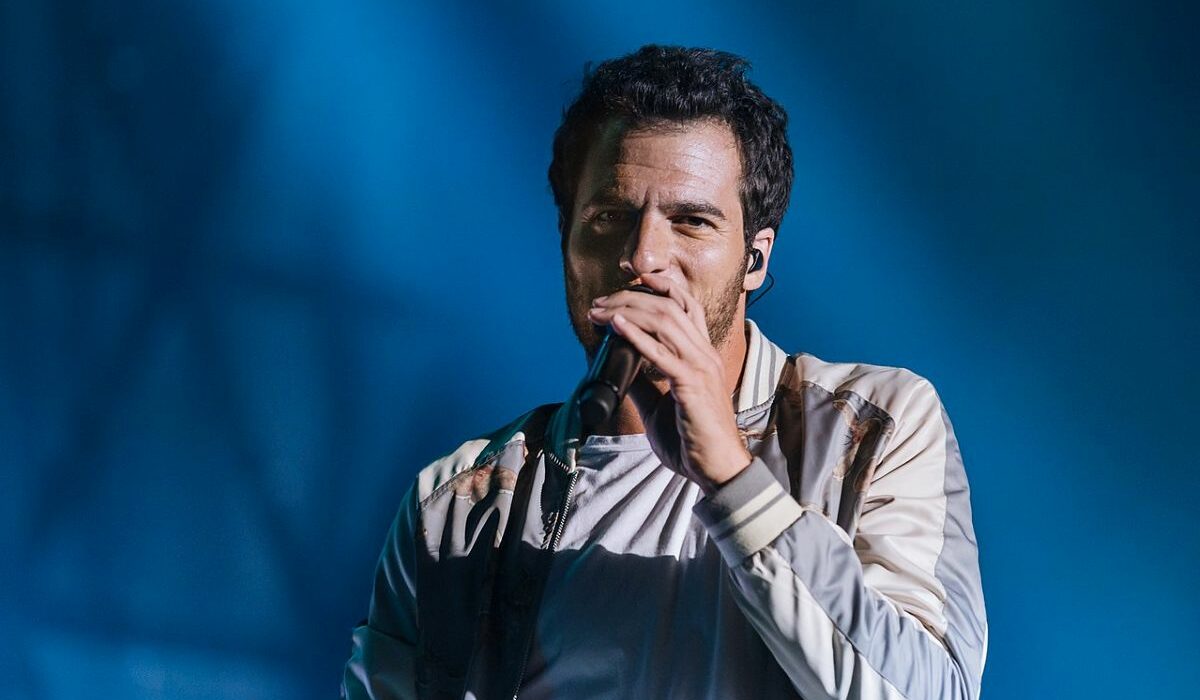Je dois y faire de la place et je balaye des pans entiers de rayonnages avec, il faut le dire, une certaine perplexité. Je me souviens vaguement de ce que j’ai attendu de tel ou tel livre, je me souviens éventuellement de ce que j’en ai retiré le moment venu, mais je suis, aujourd’hui, tellement loin de ces années, que je me regarde moi-même en arrière avec un brin d’ironie.
J’ai relu, également, un article que j’ai publié, en 1998, dans une revue assez prestigieuse : assurément je ne l’écrirais plus de cette manière aujourd’hui !
Je suis ailleurs.
La fausse recherche du langage comme levier d’action
Je perçois bien la tentation qui m’habitait alors : trouver des mots, des formulations, qui décrivent le monde (ou moi-même, ou les autres, ou Dieu) de manière adéquate, afin d’y agir ou de me comporter de manière pertinente et efficace.
Et cela m’a fait repenser à un très bref texte d’Erri De Luca (que j’ai relu, lui, avec bonheur), intitulé : « En haut, à gauche ». Ce texte a été traduit en français dans un recueil qui porte le même titre (Ed. Rivages, 1996). Erri De Luca raconte les quelques mois où il a accompagné son père frappé d’un cancer des os. Le paradoxe est que son père appartenait à la bourgeoisie intellectuelle, tandis qu’Erri, pour sa part, a filé une veine ouvriériste. Il a tourné le dos à l’héritage paternel, mais, pendant ces derniers mois, il retrouve son père autour des livres. Et son père lui fait comprendre que lui, le fils rebelle, accorde trop de foi aux livres, qu’il est, finalement, plus intellectuel que lui. « Tu aimes, lui dit-il, les pages absolues, les nécessaires, à l’abri des goûts. Mais les livres c’est nous, des gens qui tombent malades, s’effilochent, jaunissent et qu’on oublie. Ils sont à l’image de notre vie » (p. 145). Le père défend une pratique plus empathique de la lecture : suivre un auteur dans son récit, comme on accompagne une connaissance. « C’est beau, dit-il encore, de tourner la page lue et de porter mon regard en haut à gauche » (Id.). Et finalement, ajoute-t-il, il en va de même de ton travail : « en sortant de chez toi, le matin, pour te rendre au chantier, tu tourneras le dos au nord et tu verras poindre ce jour-là, derrière les maisons, le profil des champs, derrière la clôture, à l’est, en haut et à gauche » (p. 147).
« En haut, à gauche », autrement dit : passons à la page suivante. Cette formule décrit parfaitement le tournant (qui s’est étalé sur plusieurs années) que j’ai vécu. Il y a quelque chose de spécialement touchant, pour moi, dans ce texte d’Erri De Luca : c’est que cet accès à un rapport à la lecture et à l’écriture moins obsédé par la recherche « de l’absolu et du nécessaire », m’a aussi fait reconsidérer quelque chose qui habitait mon père. Mais le scénario était inverse : c’est en m’éloignant du style de mon père que j’ai rejoint un autre rapport à l’écrit.
J’ai (autre manière de parler de la même chose) une longue carrière de prédicateur laïc, derrière moi. Depuis des années je prêche environ une fois par mois. Et si je relis une prédication d’autrefois je retrouve cette manie « de l’absolu et du nécessaire ». Elle a fini par s’effacer au profit d’une autre formule proposée par le père d’Erri : « trouver des mots d’accompagnement pour l’expérience que l’on fait dans le monde » (p. 142). Et c’est bien ce que je cherche à faire ces jours-ci, et c’est bien aussi pourquoi je résiste à donner un sens « absolu et nécessaire » à ce qui se passe en ce moment.
La parole nouée à une relation
On trouvera peut-être étonnant qu’un chercheur en sciences sociales tienne un tel discours. Mais les sciences sociales sont au moins autant là pour donner sens à ce que tout un chacun vit, que pour proposer des explications définitives sur le monde.
Ou bien, encore, on dira que la théologie est un discours articulé, qui comprend des disciplines formelles comme la dogmatique. Oui : c’est un discours qui existe, mais qui est une construction à partir d’un texte de base, le texte biblique, qui n’a certainement pas cette forme.
En fait, tout cela me fait penser à la rencontre de Dieu et de Moïse, au début de livre de l’Exode. Moïse demande à Dieu son nom : il est à la recherche du mot qui fera se lever les hébreux et plier Pharaon. Mais Dieu lui répond : « Je serai qui Je serai » (Ex 3.14 ; le verbe « être » est, ici, à l’inaccompli, temps qui a plutôt une nuance de futur). Manière de dire : n’essaye pas de m’enfermer dans un mot « absolu et nécessaire ». Contente-toi de savoir que je serai à tes côtés. Puis il ajoute : « Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là mon nom à jamais, c’est ainsi qu’on m’invoquera d’âge en âge » (Ex 3.16). Il est le Dieu qui a accompagné les patriarches, qui accompagnera Moïse et le peuple et qui nous accompagne aujourd’hui encore.
Le Christ est la Parole (pour reprendre la formule de l’évangile de Jean), mais il est, avant tout, une personne qui nous parle parce qu’il a voulu se rendre proche de nous. Sa parole est nouée aux relations qu’il entretient avec les hommes. D’ailleurs, dans l’évangile de Jean, les quiproquos se multiplient. Des interlocuteurs comprennent de travers ce qu’il dit parce qu’ils lui sont hostiles. L’enjeu n’est pas d’emmagasiner ses mots, mais des les comprendre, de les entendre et de s’en nourrir.
Voilà à quoi j’ai pensé en regardant d’un peu près une partie des rayonnages de ma bibliothèque. Une bibliothèque n’est, finalement, que le rassemblement des témoignages des amis (que, la plupart du temps, nous n’avons pas rencontré en direct) qui nous ont accompagné au fil de notre vie. J’ai attendu de certains livres plus que ce qu’ils pouvaient me donner, assurément. Avec le recul, il reste certaines voix qui ont, pour moi, une force particulière. J’ai encore envie de les écouter, car elles m’accompagnent, encore et toujours, dans ce que je vis dans le monde. Elles m’accompagnent, en particulier, pendant ces journées très particulières.