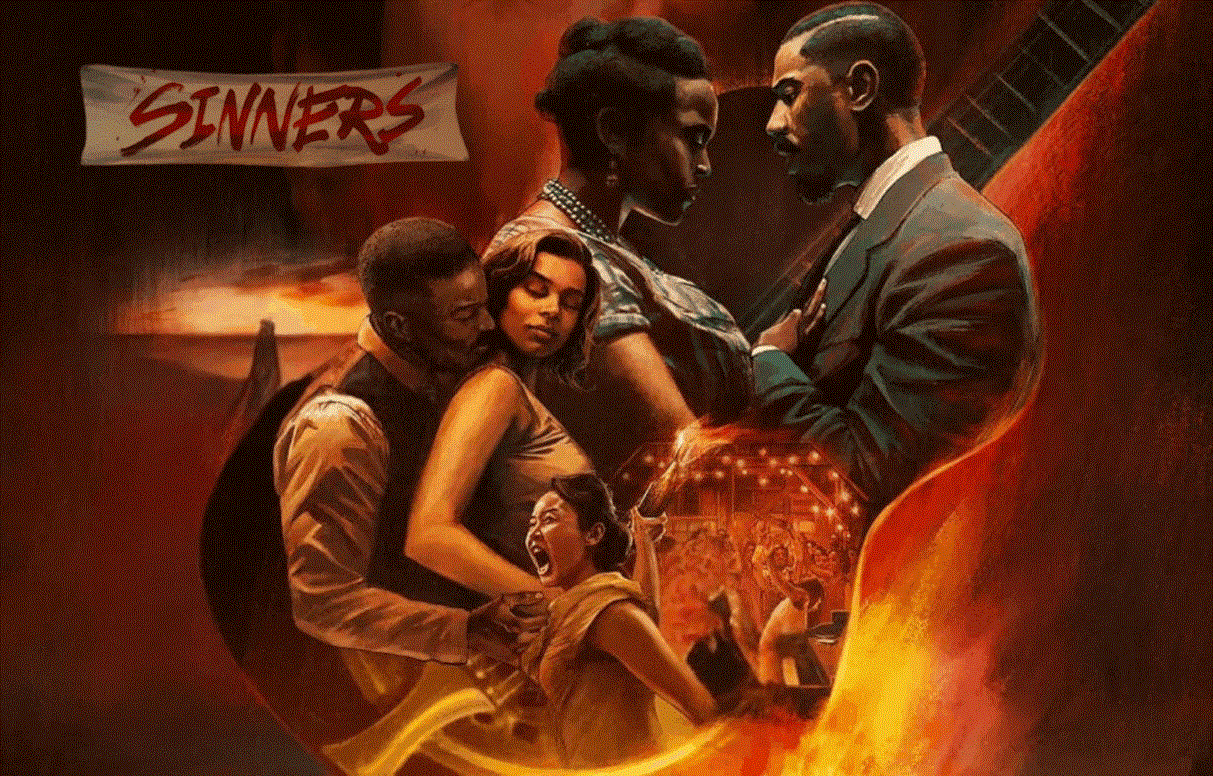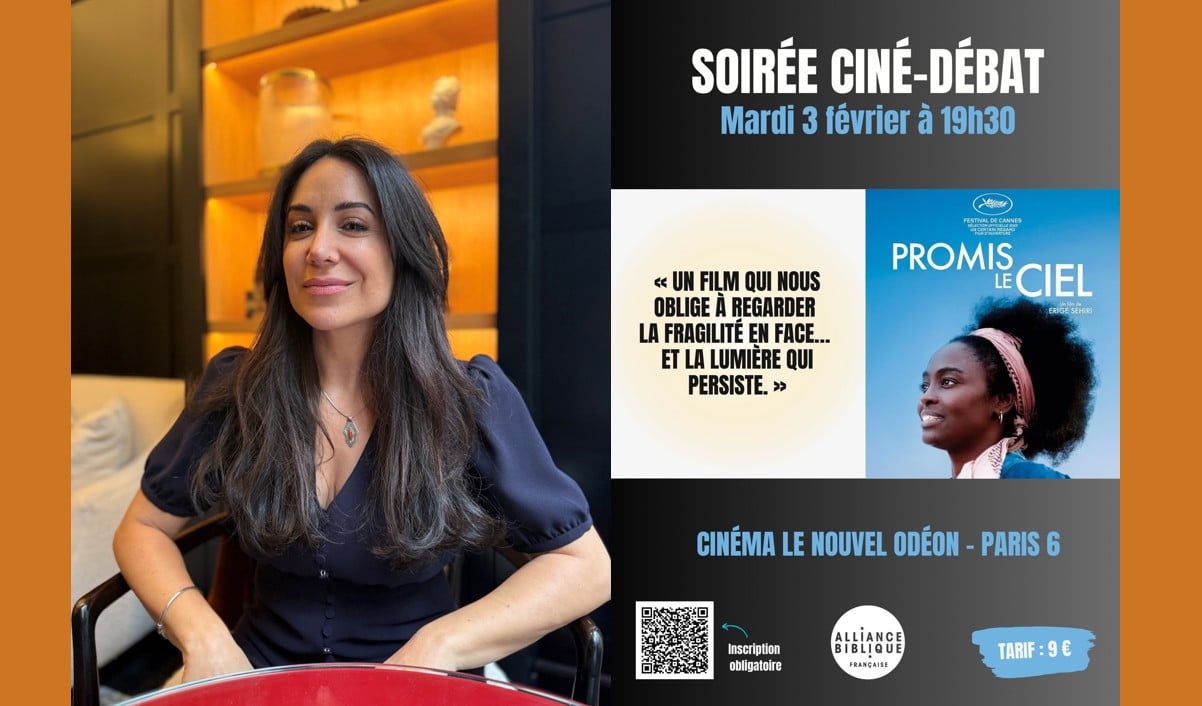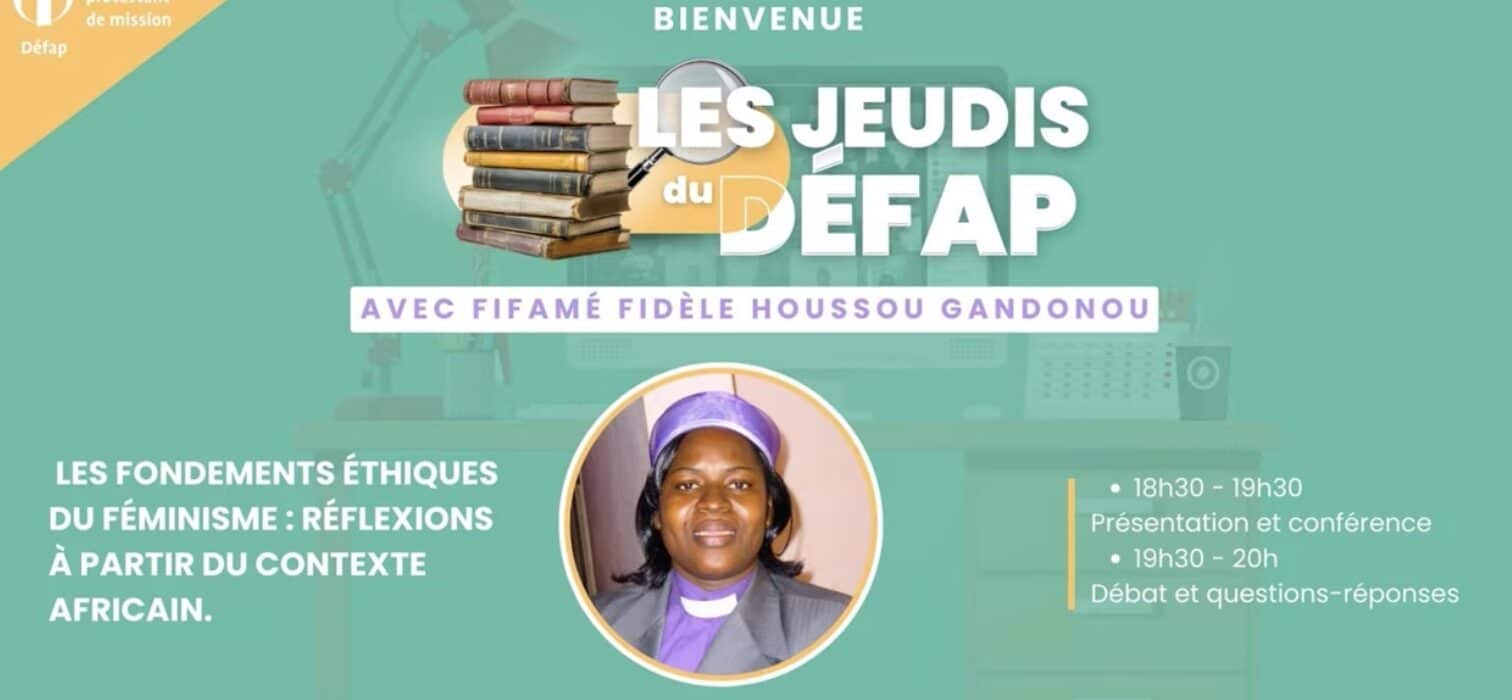Entre tension sociale et effondrement personnel, c’est aussi une méditation sur ce que signifie faire justice sans trahir l’amour, et comment une femme, broyée par la douleur, choisit de ne pas laisser la haine avoir le dernier mot.
Mahnaz, une infirmière de 40 ans, élève seule ses enfants. Alors qu’elle s’apprête à épouser son petit ami Hamid, son fils Aliyar est renvoyé de l’école. Lorsqu’un un accident vient tout bouleverser, Mahnaz se lance dans une quête de justice.
La trame pourrait ressembler à un simple conflit domestique, à « un simple accident » dirait Jafar Panahi, mais Roustayi fait vite monter la tension : un drame survient, irréversible, brutal, et son héroïne se retrouve confrontée à l’injustice d’un système, à la solitude d’un deuil impossible, et à la question terrible de la vengeance.
Une tension morale qui va crescendo
Roustayi filme les jours qui suivent avec un calme glaçant. La caméra reste au plus près du visage de Mahnaz, capte ses hésitations, ses retraits, ses sursauts de colère muette. Les enjeux judiciaires – dépôt de plainte, dépôt de preuves, pressions sociales – sont rendus avec précision, mais toujours à travers le prisme émotionnel d’une femme acculée, que la société n’écoute pas. Et pourtant, le film ne cède jamais au plaidoyer : il pose la question du droit, mais aussi celle, plus silencieuse, du pardon.
Une critique voilée du patriarcat
Bien que le film évite une dénonciation frontale du régime iranien, il expose subtilement les mécanismes d’oppression à l’œuvre dans la société. Le port du voile, omniprésent, symbolise la pression exercée sur les femmes pour se conformer aux attentes patriarcales. Mahnaz incarne la résistance silencieuse face à ces contraintes, cherchant à préserver sa dignité et celle de ses enfants dans un environnement hostile.
Un dernier acte bouleversant
C’est dans ses toutes dernières minutes que Woman and Child bascule vers une autre dimension. Une scène de confrontation inattendue, sans mots superflus, vient renverser le film — et le porter au seuil du spirituel. Confronté à la vie qui surgit, Mahnaz fait un choix : non celui de l’oubli, mais celui d’une paix que ni la loi ni la vengeance ne peuvent garantir. Par ce geste, elle redevient sujet, non victime, et le film s’élève à une vraie noblesse morale.
Un cinéma de la retenue, nourri de compassion
La mise en scène de Roustayi, d’une rigueur exemplaire, refuse l’esbroufe. Plans fixes, ellipses, travail sur les visages plus que sur les mots. Parinaz Izadyar, remarquable, incarne une Mahnaz tour à tour effondrée, digne, furieuse, perdue. Elle donne au film sa densité émotionnelle, et à ce personnage féminin une présence inoubliable. Face à elle, Payman Maadi campe un Hamid manipulateur et lâche, révélant les failles d’une masculinité toxique. Le jeune Sinan Mohebi, dans le rôle d’Aliyar, apporte une énergie brute et extrêmement touchante, reflétant les tourments de l’adolescence.
Woman and Child s’inscrit dans la lignée des drames sociaux iraniens, offrant une réflexion poignante sur la condition féminine et les entraves à l’émancipation.
C’est aussi un film sur le deuil, et sur l’impossible équilibre entre justice humaine et justice intérieure. Il laisse dans son sillage une question silencieuse : que faire de la douleur quand elle ne peut être réparée ? La réponse, ici, tient en un regard final. Ni résignation, ni triomphe. Une décision. Une paix âpre. Une fois encore, la grâce qui surgit. Seule la grâce !