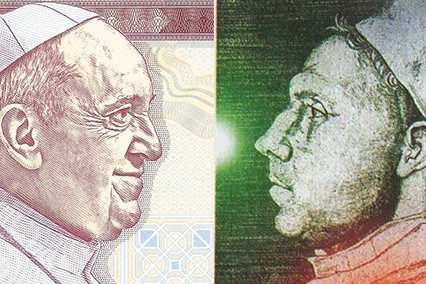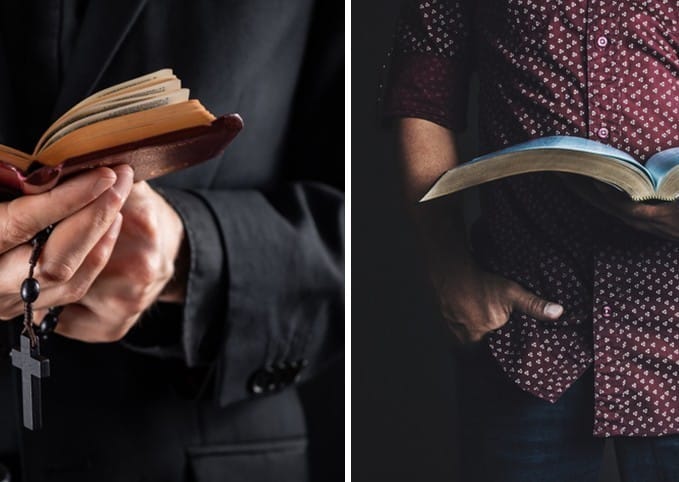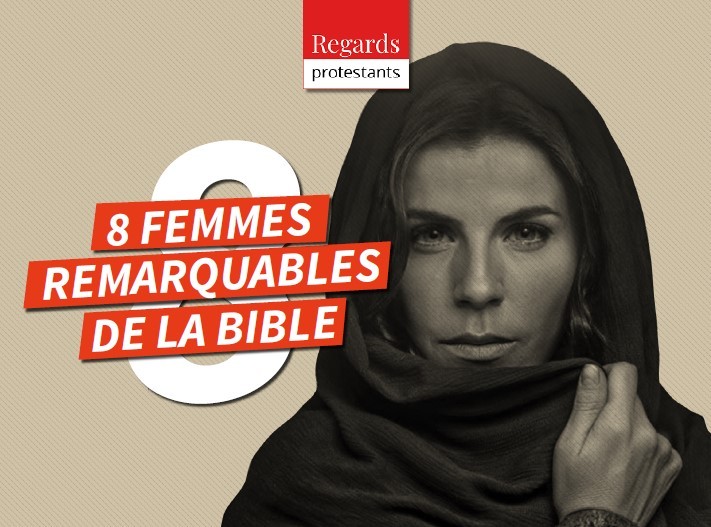Près de cinq siècles après la Réforme, que peut-on dire des distinctions entre catholiques et protestants ?
Au-delà des rites ou des termes, c’est tout d’abord une conception de l’Église qui distingue profondément ces deux traditions chrétiennes.
Pour les catholiques, l’Église est cette réalité visible, structurée, hiérarchique – une mère qui transmet le salut par le biais des sacrements. Les ministres, exclusivement masculins, ordonnés et célibataires, incarnent la présence du Christ dans la communauté. Au contraire, pour les protestants, l’Église est d’abord une conséquence : c’est la communauté de ceux que Dieu a rejoints par la foi en Christ. Pasteurs ou pasteures, souvent mariés, n’incarnent pas une médiation sacramentelle, mais assurent la proclamation de l’Évangile et l’édification spirituelle des croyants.
Cette divergence se retrouve aussi dans la pratique de l’eucharistie : sacramentelle, réelle pour les catholiques ; symbolique, mémoriale pour les protestants. La question de Marie illustre encore la nuance : vénérée et invoquée pour les catholiques, elle est respectée pour sa foi chez les protestants, sans prière d’intercession. Le mariage, sacrement chez les catholiques, est reconnu par les protestants comme bénédiction et engagement, davantage centré sur la liberté des époux.
Face à ces différences, l’œcuménisme révèle toutefois la complémentarité de ces traditions : le protestantisme peut aider le catholicisme à se garder de l’enfermement institutionnel, tandis que ce dernier rappelle au protestantisme l’importance de la mémoire théologique et de la profondeur du vocabulaire ecclésial. Et si la différence reste une réalité, le consensus sur l’essentiel – être en Christ, par la foi, en communion – invite à une unité toujours à bâtir.