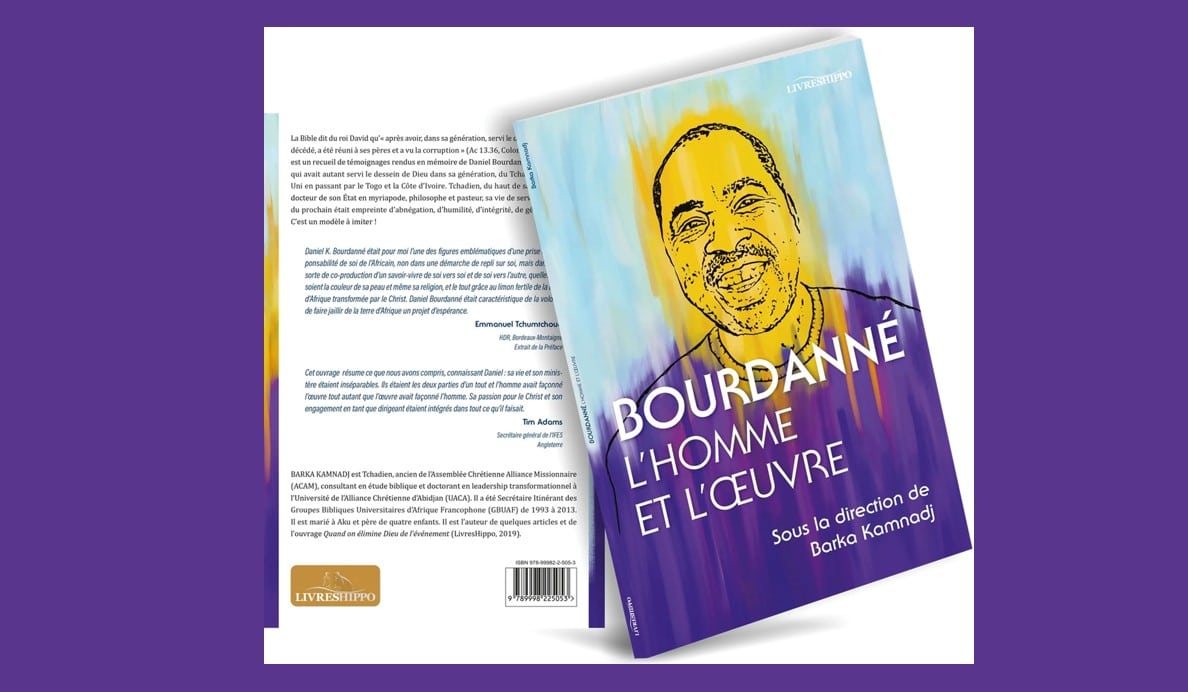La Nouvelle-Calédonie a pour l’instant le statut de « collectivité française », en l’attente d’un référendum d’autodétermination. Peuplée aujourd’hui d’environ 270.000 habitants, elle a été plus impactée que la métropole par les fils et filles de la Réforme calviniste. L’archipel doit son nom de baptême à un découvreur anglo-écossais, le fameux Capitaine James Cook (1729-1779). Mais ce dernier, bien que protestant de confession anglicane, n’était pas intéressé par la religion. En revanche, c’est à sa suite que l’évangélisation protestante de la Nouvelle-Calédonie commença, sous l’impulsion de missionnaires britanniques vite relayés par des natas (pasteurs) kanaks locaux.
« Dans dix ans il n’y aura plus de Kanaks » (sic)
Colonisée ensuite par la France à partir du milieu du XIXe siècle (1853), l’archipel entre désormais dans le champ de la Société des Missions Evangéliques de Paris. Ses missionnaires remplacent ceux qui avaient été envoyés depuis Londres. L’évangélisation porte ses fruits, particulièrement parmi les Kanaks colonisés par les blancs venus d’Europe (appelés caldoches). Une implantation catholique s’opère aussi, encouragée par les autorités, mais elle reste longtemps minoritaire. Le protestantisme s’impose peu à peu, au côté des religions traditionnelles, comme un acteur majeur de socialisation et de mobilisation religieuse en Nouvelle-Calédonie. Arrivé en 1902, le missionnaire[1] et anthropologue Maurice Leenhardt (1878-1954) va profondément impacter le protestantisme local. Les débuts sont rudes. Le maire de Nouméa l’accueille par ces mots : « Que venez-vous faire ici ? Dans dix ans il n’y aura plus de Kanaks ». Prophétie démentie ! Leenhardt quitte l’archipel en 1920 après avoir traduit le Nouveau Testament en langue vernaculaire. Progressivement sensibilisé à l’oppression subie par les Kanaks, Leenhardt se fait peu à peu leur avocat, et plaide pour une Eglise autonome et un effort éducatif et catéchétique qui respecte les cultures et langues océaniennes.
A partir des années 1960, le protestantisme calédonien, très majoritairement réformé (calviniste), s’autonomise, et gère avec réussite la lente évolution locale vers une société postcoloniale respectueuse des droits des populations mélanésiennes. Les missionnaires prennent « fait et cause pour les Kanaks », à la fois « au nom de la lutte contre l’influence pernicieuse de la civilisation européenne post-chrétienne », et « parce que la marginalisation politique du peuple kanak aurait signifié le démantèlement d’une structure sociale chrétienne »[2]. Le catholicisme, qui a beaucoup progressé, au point d’être devenu majoritaire, reste très dominant chez les populations caldoches (arrivées avec les colonisations), alors que le protestantisme est nettement plus représenté au sein des populations mélanésiennes qui aspirent à davantage de reconnaissance. D’où la centralité de l’Eglise évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux iles Loyauté (EENCIL) lors des douloureux événements de 1988-89 (tragédie d’Ouvéa, puis assassinat de l’indépendantiste Jean-Marie Tjibaou[3]). D’où, également, le rôle exercé par Jacques Stewart, alors président de la Fédération Protestante de France, auprès du premier ministre d’alors, Michel Rocard. Les accords de Matignon de juin 1988 matérialisent une médiation réussie, qui ouvre la voie à une sortie de crise et un scénario d’autodétermination.
Trois protestants pour dix habitants
Les protestantismes de cet archipel d’Océanie situé à plus de 1400 kms de l’Australie et de la Nouvelle Zélande s’inscrivent toujours aujourd’hui sous la double ombrelle des cultures et langues mélanésiennes et de la francophonie. Ils encadrent de près ou de loin entre 70.000 et 80.000 personnes au total, soit environ trois protestants pour dix habitants. Ils participent à une France d’outremer qui tâtonne pour tenter de corriger les spoliations et discriminations coloniales, et ouvrir un avenir mieux partagé. Un dernier trait de ces expressions protestantes néocalédoniennes est une diversification croissante. L’Eglise calviniste principale, qui a changé de nom en 2013 pour devenir Eglise protestante de Kanaky (EPKNC), reste largement dominante, avec environ 40.000 fidèles (en son sein, un bon tiers est de forte tendance évangélique/pentecôtiste). Mais s’ajoutent aussi environ 5000 pentecôtistes des Assemblées de Dieu, implantées en Nouvelle-Calédonie à partir de 1955[4], ainsi que d’autres réseaux d’Eglises indépendantes (EEI) ou évangéliques libres (EEL), et de nouvelles expressions charismatiques. Quelques anglicans, adventistes, complètent le tableau, ainsi que des mouvements issus du protestantisme (mais non protestants) comme les Témoins de Jéhovah et les Mormons.
Trait commun à ces protestantismes : sur des modalités différentes, ils se sont très largement réencodés localement, dissociant christianisme et colonisation; par ailleurs, ils se sont aussi réappropriés la généalogie d’une histoire du salut qui peut même passer…. par les camisards cévenols : Maurice Leenhardt rapporte ainsi ces réflexions d’un protestant kanak rencontré au Musée du Désert : « Un canaque de Nouvelle-Calédonie, en séjour dans le Midi de la France, fut surpris, un jour, assis dans un temple vide, et copiant, sur un carnet, les noms des pasteurs martyres conservés sur une plaque de marbre, serrés et émouvants par leur rapide succession / – Que fais-tu là ? / – Je copie les noms de mes ancêtres. / Et ne se voyant pas compris, il expliqua lui-même : – Vous, les Blancs chrétiens, vous avez été adoptés d’abord; par vous, nous l’avons été ensuite« [5].
[1] Lire R. Decker, « Maurice Leenhardt, le missionnaire », Journal de la Société des océanistes, tome 10, 1954. p. 11-27.
[2] Frédéric Fabre, Protestantisme et colonisation. L’évolution du discours de la mission protestante française au XXe siècle, Paris, Khartala, p.301.
[3] Dont l’épouse était protestante.
[4] Cf. Yannick Fer, Pentecôtisme en Polynésie française, l’Évangile relationnel, Labor et Fides, 2005, p.49. Il précise que la première Eglise pentecôtiste ADD de l’archipel est créée en 1968 dans le quartier Blanchot de Nouméa.
[5] Rapporté par M. Leenhardt, dans Fabre, op. cit., p.100.