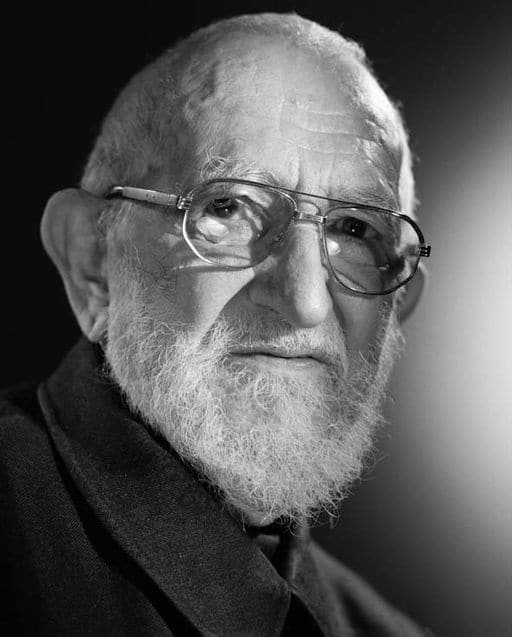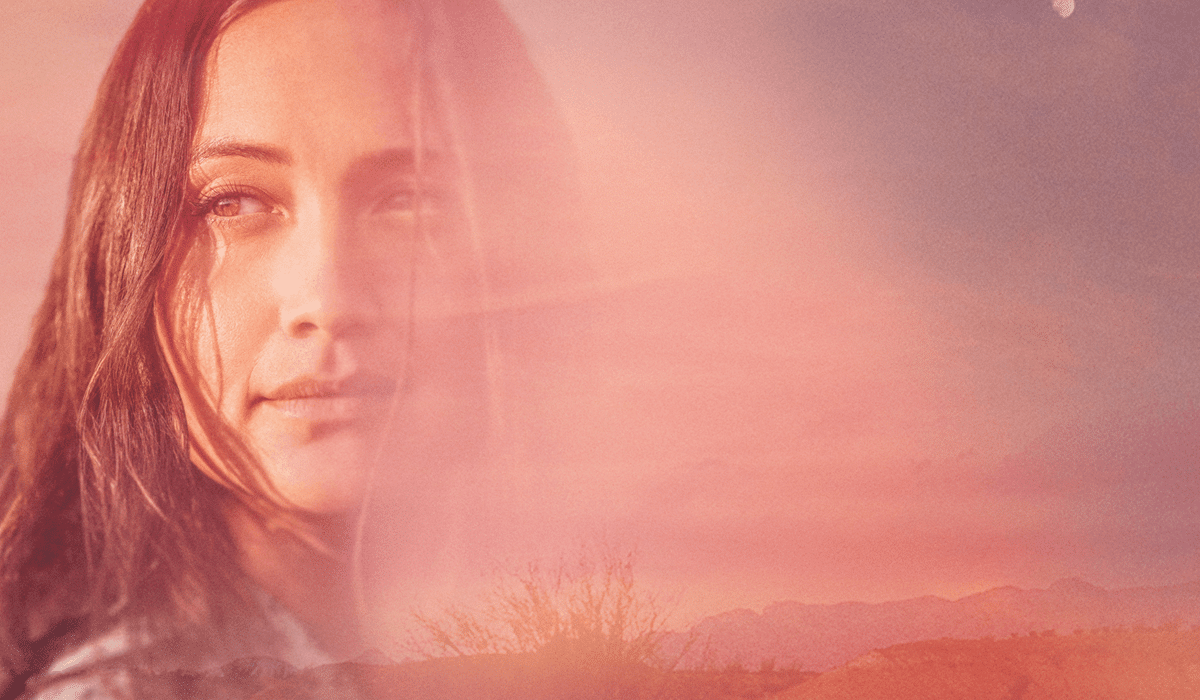En France, le protestantisme évolue. De nouvelles Églises naissent régulièrement, dans la mouvance pentecôtiste et dans les milieux de l’émigration. Ces nouvelles Églises font-elles partie de la même famille : ses membres sont-ils enfants de la Réforme ? Pour répondre à cette question, il convient de définir les principes qui fondent la Réforme au XVIe siècle : nous en pointerons trois.
Un principe théologique
Luther était un moine angoissé par la question de sa propre justice. Il se sentait écrasé et jugé par la grandeur de Dieu face à la petitesse de sa foi. Il multipliait les jeûnes, les veilles, les confessions et les exercices spirituels, sans arriver à la perfection que, pensait-il, Dieu attendait de lui. Dans son désespoir, il était troublé par le verset de l’épître aux Romains qui dit : « Je n’ai pas honte de l’Évangile… en effet la justice de Dieu s’y révèle, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. » La méditation de ce verset, et notamment de sa conclusion le juste vivra par la foi, a été à l’origine d’une nouvelle compréhension du rapport entre Dieu et l’humain. La justice de Dieu, ce n’est pas Dieu qui me juge, mais Dieu qui me voit juste par Jésus-Christ. Autrement dit, ce ne sont pas mes actes de justice qui me rendent juste devant Dieu, c’est parce que je suis juste en Jésus-Christ que je peux accomplir des actes de justice.
Pour Luther, ce principe fonde la foi chrétienne. Quand il est présent, nous sommes […]