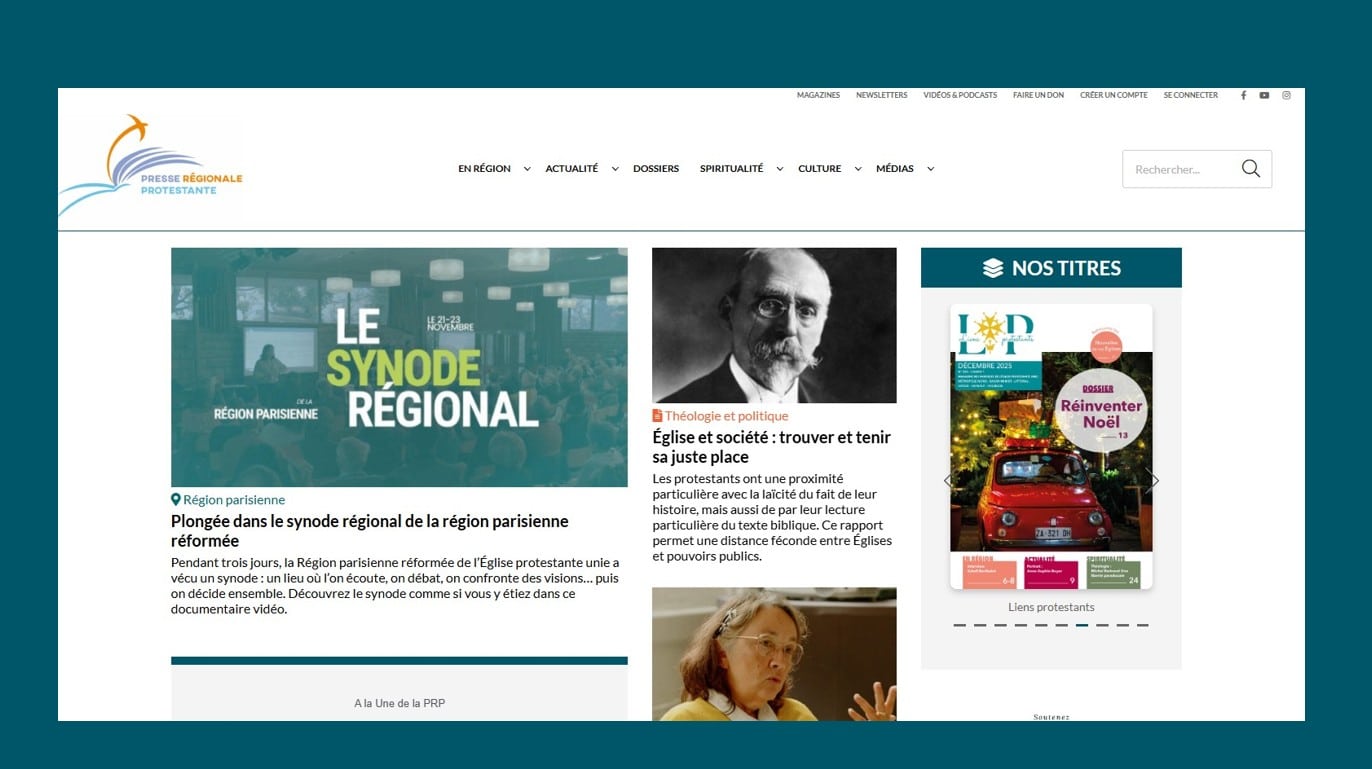« Presbytéro-synodal » vient des mots presbuteros et sunodos, signifiant en grec respectivement un « ancien », chargé de diriger la communauté, et un « chemin ensemble », autrement dit : le fait de s’assembler pour délibérer. Ces deux lieux – le local et le synodal – et leur articulation sont essentiels pour comprendre le fonctionnement de l’EPUdF. Il faut y ajouter la dimension épiscopale issue de sa composante luthérienne : dans deux régions, un inspecteur ecclésiastique assume une fonction de « veille », en relation avec les synodes et les conseils qui en émanent.
D’où provient cette organisation ? Au XVIe siècle, l’Église d’Occident connaissait la conciliarité, c’est-à-dire le fait que des conseils ou assemblées prennent des décisions. Mais la papauté avait évolué vers un type de gouvernement d’Église de plus en plus monarchique. La Réforme introduit trois changements majeurs en lien avec la question de la conciliarité.
L’Église selon la Réforme
Le premier est la distinction entre l’Église, invisible, formée de la communauté des croyants passés et présents, et l’Église visible, humaine et donc potentiellement faillible, contemporaine, reconnaissable à des signes : parce que la Parole de Dieu y est prêchée et reçue et parce que les sacrements y sont « droitement » administrés, c’est-à-dire correctement selon l’Évangile. Les deux Églises se recoupent, mais partiellement, et seul Dieu en connaît les frontières.
Le deuxième changement consiste en l’affirmation du sacerdoce universel des croyants, dit autrement : tout le monde est prêtre ou prêtresse, même si ce dernier point, en pratique, a été lent à se réaliser… Il n’existe donc plus de différence de qualité ou de nature entre les croyants, dont certains seraient sacrés et d’autres non. Seule la fonction spécialisée de ministre (« serviteur ») de la Parole et des sacrements implique, après une bonne formation théologique, une distinction pratique entre des membres de l’Église mis à égalité. Enfin, puisque l’Église visible a pour seul chef le Christ, elle n’a plus ni un seul représentant exclusif ni de centre. Son unité de base est l’Église locale qui a toute latitude pour choisir ses ministres. Cependant, pour éviter l’anarchie, ces Églises sont assez vite placées sous l’autorité de conseils. Historiquement, elles se sont dotées de synodes (avec ou non des évêques élus) et de constitutions, véritables règlements ecclésiastiques, parfois assortis – pour les réformés – d’une discipline (comment être disciple, comment pratiquer une « correction fraternelle » si l’un des membres de la communauté vient à s’égarer).
Une autorité répartie
Dès la Réforme, le lieu de l’exercice de l’autorité dans l’Église est aussi bien réparti dans un ministère personnel (le ministre « fonctionnaire » ou fonctionnel, l’évêque ou inspecteur ecclésiastique) que dans l’assemblée (conseil ou synode), raison pour laquelle on parle en protestantisme de ministères personnels et collégiaux.
Au cours de l’histoire, les protestants ont souvent suscité la méfiance des souverains du fait de leur organisation d’apparence parlementaire, jugée trop démocratique. Napoléon n’autorisa que de très rares synodes réformés locaux et au XIXe siècle un seul synode officiel eut lieu, en 1872. De plus, la multiplicité des Églises protestantes représentait un inconvénient pour dialoguer avec l’État. C’est pourquoi la Fédération protestante a été créée au même moment. Mais si son mode de fonctionnement lui confère un aspect très moderne, il faut bien prendre conscience que l’Église n’est pas une démocratie, pour au moins quatre raisons.
L’Église n’est pas une démocratie
D’abord, le chef est le Christ, et non « le peuple souverain » ; ensuite les conseils qui délèguent des représentants au synode sont composés de membres, certes élus à la majorité des voix, mais préalablement discernés, cooptés selon des critères religieux ; de plus, il n’y a pas de parti qui explique ce qu’il faut voter, chaque membre d’une assemblée est libre en conscience ; enfin, et surtout, l’Église est un lieu à la fois immanent – elle fait corps dans la société –, mais aussi transcendant, comme signe d’un Royaume qu’elle annonce et dont elle vit.
De fait, la forme de l’Église n’est ni parfaite ni définitive : en situation de détresse ou de persécution comme en situation de domination, celle-ci pourrait être tout autre, comme le soulignait déjà Calvin.
Par Gilles Vidal, Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier