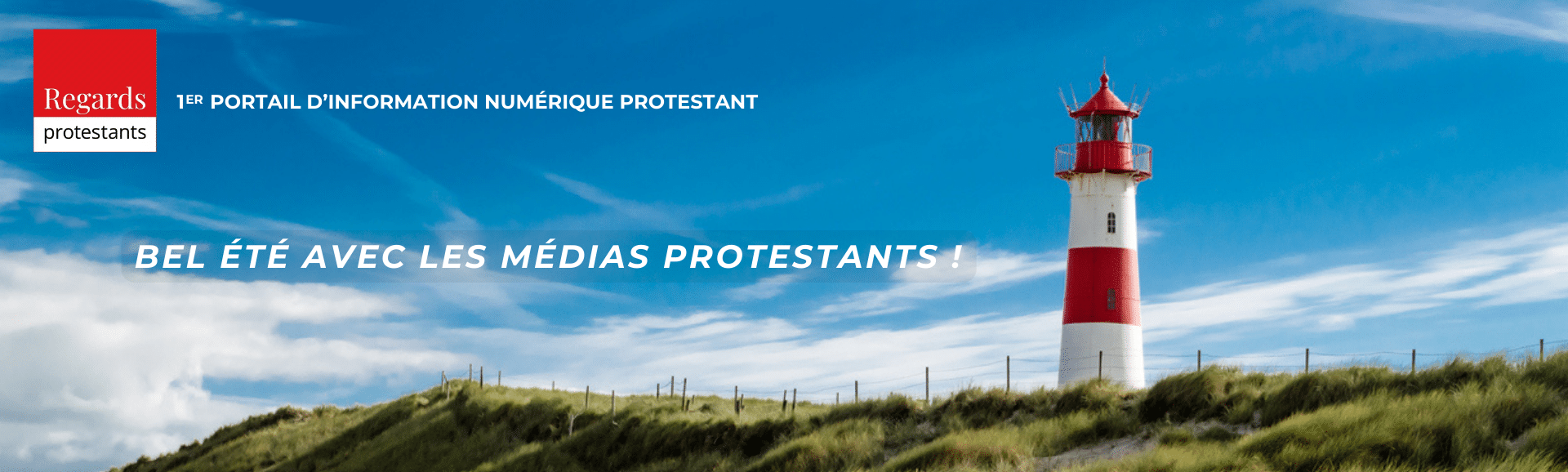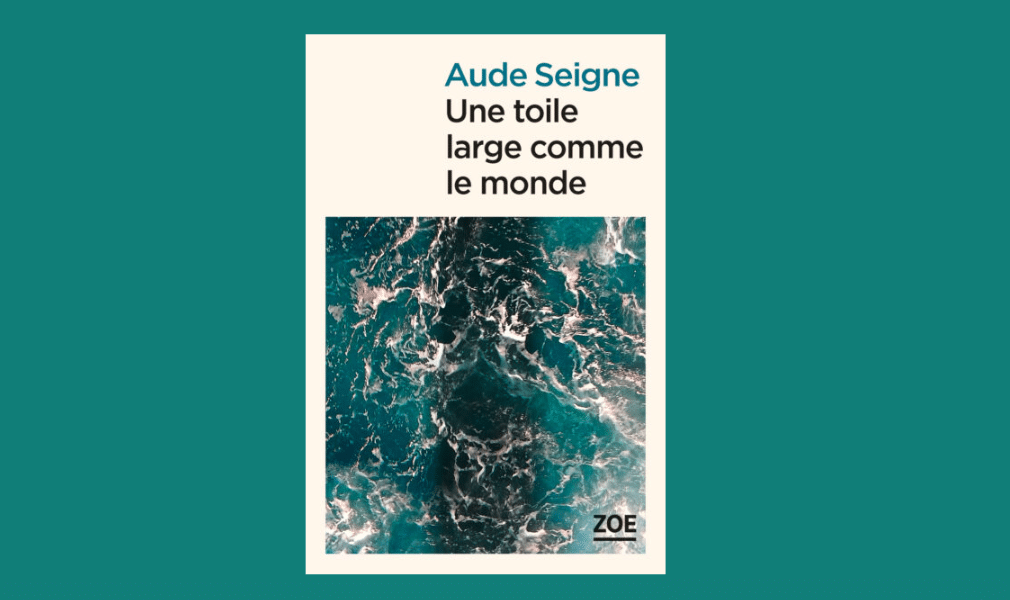J’ai souvent déconcerté mes questionneurs (qui étaient plutôt de mauvaise volonté, en général) en leur disant qu’il était assez facile de trouver et que, d’ailleurs, dans chacune des mes recherches j’avais trouvé quelque chose ! Je ne suis pas sûr, en revanche, qu’ils auraient été contents de savoir ce que j’avais trouvé. Les résultats des recherches ne font pas que des heureux.
Cela dit, j’ai quand même toujours admis que la question, même formulée de manière légèrement agressive, avait une certaine légitimité. Toute profession doit rendre compte de son utilité sociale. Et il y a souvent une tension entre ce qu’un financeur de la recherche attend et ce que le chercheur considère comme important et décisif. L’Etat m’a payé pendant toute ma carrière et est-ce que je l’ai servi de manière correcte ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière claire, mais il vaut la peine de se la poser, malgré tout.
Une volonté de pilotage de la recherche par l’aval
Ces tensions (entre financeurs et chercheurs), qui sont aussi vives dans la recherche privée que dans la recherche publique, ont conduit les financeurs, depuis plusieurs années, à vouloir piloter la recherche de manière plus serrée, en liant les financements à des commandes précises. C’est ce qu’on appelle le pilotage par l’aval. C’est une reprise de pouvoir sur des chercheurs dont on considère que, livrés à eux-mêmes, ils se perdent dans des objectifs obscurs et peu valorisables.
L’évolution, depuis plusieurs années, est donc de financer de plus en plus de recherches, y compris les recherches publiques, par des appels d’offre. C’est ce que fait l’Europe depuis assez longtemps. C’est ce que fait également l’Etat français en dotant de moyens sans cesse croissants l’Agence Nationale de la Recherche, qui gère lesdits appels d’offre. La conséquence de ces évolutions est de créer une population de jeunes chercheurs qui vivent sur des contrats temporaires (financés par les appels d’offre) et qui n’obtiennent que tard (ou jamais) un poste fixe.
Le débat est sorti sur la place publique, ces derniers jours, avec le projet de Loi de Programmation de la Recherche. Il y a, dans ce projet de loi, un point qui concerne les postes statutaires : la revalorisation des salaires qui étaient scandaleusement bas (j’en parle d’autant plus librement que j’ai été un chercheur payé sur un statut très particulier et, pour le coup, très bien payé). Pour le reste, la dynamique pèse clairement du côté de la multiplication des postes temporaires : la loi crée des contrats un peu plus longs, mais toujours temporaires ; et elle prévoit d’augmenter les moyens de l’Agence Nationale de la Recherche, plutôt que de créer des postes stables. Tout cela est évidemment mal reçu par la communauté des chercheurs qui sont un peu las de voir des jeunes passer une énergie considérable à sauter de contrat en contrat, et pour certains d’entre eux, se décourager et renoncer à la recherche parce qu’ils sont dans des conditions trop précaires.
Le projet du gouvernement est assez clair : augmenter (un peu) les financements de la recherche, d’accord, mais à condition d’en retirer les bénéfices, en termes d’innovation et de valorisation économique, assez rapidement. Il y a, sous-jacent, une défiance à l’égard de chercheurs jugés incontrôlables, qui, forcément, passe mal.
En fait, je le répète, la volonté du gouvernement de piloter un peu plus par l’aval la recherche ne me choque pas. Mais cela soulève une question plus complexe : est-ce que cette manière de faire produit de la meilleure recherche, une recherche plus utile pour tout le monde ?
Le rêve technologique, sous-jacent au pilotage par l’aval, a ses propres limites
Le raisonnement sous-jacent à ce mode de pilotage est assez simple : nous avons besoin d’innovations dans des domaines identifiables et nous savons assez précisément sur quoi doivent porter les innovations, focalisons donc les efforts autour de ces points durs et l’économie, le développement durable, la qualité de la vie de tout un chacun suivra. Ce raisonnement a une plage de validité et je pense qu’il est correct de piloter une partie de la recherche de cette manière là.
Mais cette approche a aussi ses limites qui n’apparaissent pas à première vue. Par exemple : une des difficultés actuelles dans le développement durable est que les innovations disponibles ne sont pas du tout adoptées par les entreprises qui devraient les mettre en œuvre, les usagers qui pourraient en profiter et les administrations qui sont censées les promouvoir. Et cela résulte d’un raisonnement technologique trop fermé où l’on conçoit des innovations en se coupant des conditions de leur usage. A la fin, on convoque les sciences sociales pour rendre ces innovations plus « acceptables », mais il est bien trop tard. L’usager n’a que faire d’accepter une innovation que l’on a conçue sans lui demander si elle répondait à ses besoins, ou si elle s’insérait dans ses pratiques. On se lamente, alors, sur le côté borné des usagers, sur la résistance au changement des administrations ou sur le manque de hauteur de vue des entreprises ! Tout cela pour dire que, si pilotage il doit y avoir, il ne peut résulter que de concertations beaucoup plus larges, qui incorporent autre chose que la commande publique imaginée dans un cabinet ministériel.
Par ailleurs, pousse-t-on les jeunes chercheurs à faire du meilleur travail en les mettant sans arrêt sous pression, en les laissant dans l’incertitude par rapport à leur avenir et en les faisant naviguer d’un sujet à l’autre au gré des demandes ? A court terme c’est sans doute un calcul qui a sa pertinence : ponctuellement on obtient des résultats identifiables. A long terme, je suis convaincu du contraire. J’ai participé à plusieurs recherches financées par de gros appels d’offre, et employant des jeunes sur contrat. La vérité est que cela les pousse au conformisme et que cela coupe leur réflexion de fond. Or, la recherche est affaire d’innovations incrémentales, assurément, mais elle est aussi affaire de ruptures conceptuelles. Et les ruptures conceptuelles surgissent avec le temps. Elles donnent sans doute lieu à pas mal de gâchis : tous les chercheurs n’ont pas des idées venues d’ailleurs. Mais même si on est plus créatif lorsqu’on est jeune, je suis convaincu que les grandes idées mûrissent et deviennent vraiment pertinentes au bout d’un certain nombre d’années. Il faut donc supporter une partie incontrôlable du travail de recherche si on veut faire des bonds discontinus.
Enfin, la recherche est souvent mal vue parce que les chercheurs se posent trop de questions, sont trop critiques, sont un peu rêveurs et n’ont pas le sens des réalités. Mais ce recul critique est, lui aussi, très utile, dans le contexte actuel où le scepticisme et l’éclatement des lieux de débat, vont devenir des fléaux, si on n’est pas capable de leur donner sens et de leur faire une place officielle dans la société. Il faut pouvoir donner sens aux réserves, au scepticisme et à l’hostilité de pans entiers de la population et donc laisser de la place aux regards critiques.
En résumé, une vision par trop utilitariste de la recherche fait fausse route. Je ne suis pas idiot au point de dire qu’il n’y a jamais de recherches inutiles. Il y en a. Et il y en a même beaucoup. Il y a même beaucoup de ce qu’on appelle, par dérision, de la RANA : de la Recherche Appliquée Non Applicable ! Mais il y a aussi beaucoup d’innovations abouties et industrialisables qui ne trouvent pas leur emploi parce qu’on s’est posé, au départ, des questions trop étroites et trop pointues.
La valeur du non-conformisme
Je suis forcément sensible aux vertus du regard décalé, du fait que j’appartiens à un mouvement religieux qui fait une place centrale au non-conformisme. Ce non-conformisme est d’abord mis en œuvre pour des raisons de foi : on attache de la valeur à des pratiques et des manières de faire qui ne sont pas forcément valorisées dans l’ensemble de la société. Mais il faut constater qu’il finit, parfois, par servir à la société toute entière. Quand un groupe social est dans une impasse, il se tourne assez spontanément vers des groupes qui ont testé d’autres voies, d’autres modes de vie. Et l’innovation socio-technique doit beaucoup à des personnes qui ont fait de grands détours par rapport aux avenues toutes tracées.
En d’autres termes, un Etat a tout intérêt à avoir un budget « têtes de lards » et « non-conformistes ». Ils sont souvent plus utiles à la valorisation de la recherche qu’on ne l’imagine. L’originalité radicale peut se perdre dans les sables de l’utopie. Mais elle peut aussi embrayer de manière surprenante avec un contexte historique. Dans un langage sophistiqué on appelle cela le « modèle de la poubelle » (Cf. Michael D. Cohen, James G. March, Johan P. Olsen, « A Garbage Can Model of Organizational Choice », Administrative Science Quarterly, 17(1), 1972). L’idée de ce « modèle » est que le monde des « problèmes » et celui des « solutions » évoluent chacun de leur côté. Bien sûr, un problème pris au sérieux encourage à trouver une solution. Mais, dans la plupart des cas, les choses ne sont pas aussi linéaires. Les solutions existantes ne sont pas satisfaisantes. A l’inverse, certaines solutions imaginées par X, Y ou un groupe, n’ont jamais pu s’exprimer faute d’un contexte favorable. Et, soudain, le contexte change, une solution qui dormait devient intéressante pour faire face à un nouveau problème.
Voilà en gros l’idée. Tout cela pour dire qu’il est sans doute utile d’améliorer le dialogue entre demande sociale et recherche (et de l’améliorer d’une manière plus large qu’au travers d’appels d’offre qui filtrent fortement la demande sociale). Mais qu’à côté de ce dialogue, il y a place, aussi, pour faire vivre des approfondissements qui appellent du temps et de la sérénité. Tout rabattre sur le temps court et les fausses évidences de l’utilité à court terme est, en fait, stérilisant à long terme.