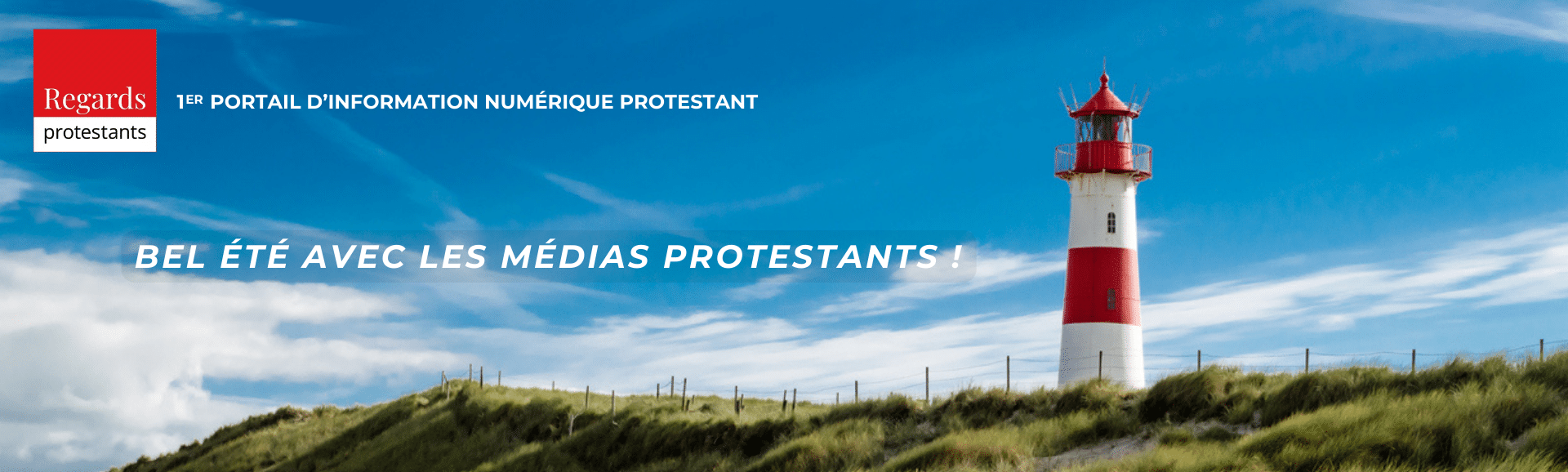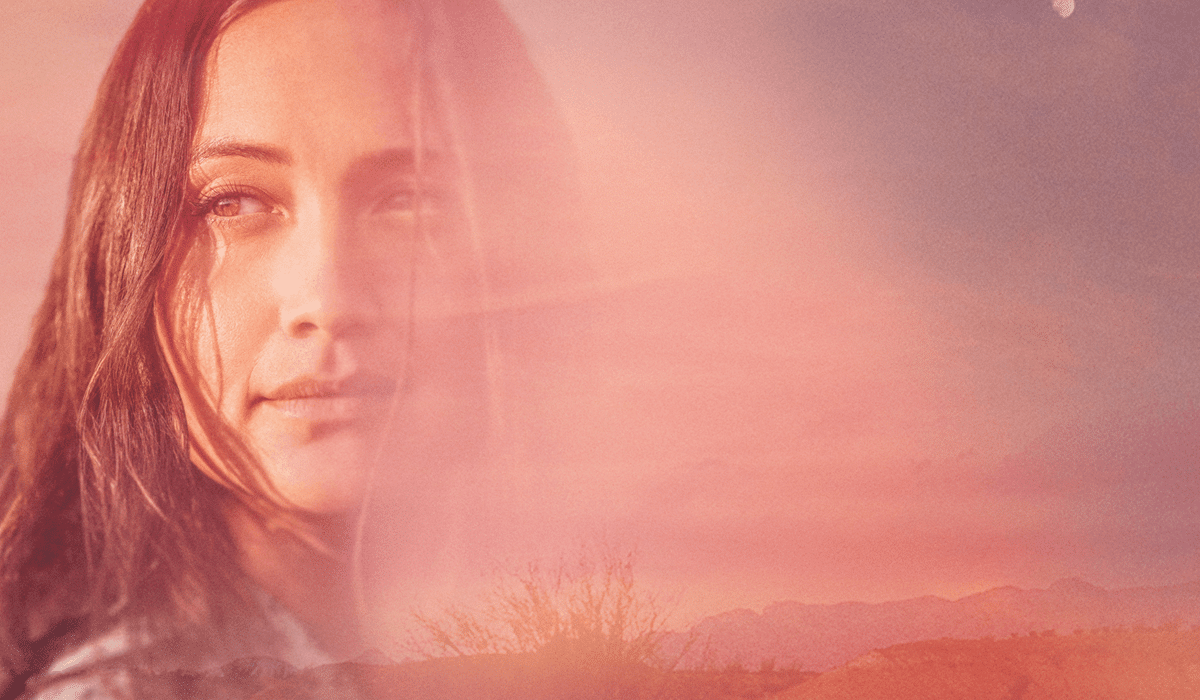On le perçoit confusément : nous sommes abreuvés d’images de pratiquement tout ce qui se passe autour de la Terre, mais, finalement, cela ne nous conduit pas à nous interroger tant que cela. Les photos, les vidéos défilent, en temps réel, et, la plupart du temps, elles nous glissent dessus.
Même à titre privé, nous n’arrêtons pas de prendre des clichés que nous partageons avec nos proches. Or ils nous font beaucoup moins d’effet que, par exemple, une photo vieille de dix ans qui, tout de suite, enclenche des souvenirs, une interrogation sur le temps qui passe, de la nostalgie ou que sais-je ?
L’instantané a, disons-le, manifestement ses limites.
Cela dit, mon propos n’est pas de dénigrer le photojournalisme qui a, au moins, une valeur d’alerte. Il est plutôt de relever qu’un autre travail social reste souvent en friche : c’est le travail d’après-coup, le retour sur, et la digestion des événements, avec du recul. Et là, les images les plus directes ne sont pas celles qui nous questionnent le plus. Il faut plutôt en passer par des évocations, des figurations indirectes, un travail de symbolisation pour que ce travail d’après-coup déplace quelque chose en nous.
Ces deux temps du travail à partir de l’image sont, qu’on s’en rende compte ou non, toujours nécessaires. Je vais les évoquer ici à propos des guerres civiles colombiennes, puisque je reviens de ce pays. Mais mon propos pourrait parfaitement s’appliquer à d’autres terrains et même à des conflits moins violents comme les tensions sociales qui traversent nos quartiers. On ne peut digérer et aller au-delà d’un événement traumatique (même peu spectaculaire), qu’au moyen d’une symbolisation qui lui donne du sens et qui nous conduit ailleurs.
Une première mise à distance possible : revenir sur des clichés d’actualité après-coup
Que faire, donc, après une guerre civile ?
On ne peut pas dire, à ce propos, que la France brille par son travail de mémoire, suite aux guerres coloniales dans lesquelles elle a été engagée. L’époque était autre, bien sûr, et la couverture des événements bien moins poussée. Mais j’ai rarement vu des expositions qui retracent les guerres d’Indochine ou d’Algérie. Or, nombre de tensions sociales renvoient, aujourd’hui encore, à ces guerres perdues (autant sur le plan militaire qu’idéologique). Le silence gêné est-il la seule issue ?
A Bogotá, en tout cas, à proximité immédiate du palais présidentiel, une exposition se tient depuis fin octobre (jusqu’à fin août) et retrace, photos à l’appui, la myriade de combats qui ont opposé les différentes factions combattantes jusqu’à récemment. Des statistiques macabres relèvent le nombre de morts et d’enlèvements et la masse des populations déplacées à cause des conflits armés. Il s’agit d’un travail, soigné et complet, fait par l’Université. Les gens viennent, nombreux et en famille, parcourir les salles.
Il est perceptible, comme je le disais, que la simple distance temporelle, crée quelque chose. Elle rend la parole possible, alors que l’événement brutal sidère. Les processus de justification par lesquels chaque camp défend son action sont, aux aussi, largement entravés par cette mise à distance. L’objet de certaines luttes apparaît, certes, toujours comme légitime (par exemple : la défense de la propriété de la terre pour les agriculteurs). Mais le basculement dans la lutte armée pose forcément question ne serait-ce que dix ans plus tard.
La simple possibilité de regarder en arrière permet une première élaboration sur les événements du passé.
Prenons un exemple qui nous concerne : le début de la crise des subprimes date de 2007. Nul doute qu’un retour sur les misères, les appauvrissements et les enrichissements qu’elle a engendrés et, pourquoi pas, photos à l’appui, serait fort utile à tous les pays qui en ont subi les conséquences.
La force du regard indirect
Cela dit, il est possible d’aller plus loin.
En comparant ce travail de miroir rétrospectif à d’autres travaux photographiques, il est évident qu’un travail photographique plus élaboré, entièrement construit après-coup, reposant sur des indices indirects et appelant un travail du spectateur pour « boucher les trous » et les nourrir de ses émotions, a plus de force.
J’avais déjà vu des travaux sur la guerre de Bosnie qui prenaient ce parti de la métonymie : utiliser un détail qui, au milieu d’un environnement apaisé, évoquait de manière poignante le passé récent de la guerre.
En Colombie, le photographe Juan Manuel Echavarría a entamé un travail de ce style depuis la fin des années 90. Ce travail se nourrit, évidemment, de contacts longuement entretenus avec les populations qui ont connu de près les combats.
Il photographie, dans la série Silencios, des écoles qui ont été réquisitionnées, pendant un temps, par la guérilla et qui se sont, de ce fait, vidées de leurs élèves. Il ne reste, aujourd’hui, que le silence d’une absence, et une vie qui reprend le dessus, envers et contre tout, mais qui ne revient pas à l’identique si facilement. Ces territoires sont, désormais, largement privés de lieu d’instruction.

Ailleurs, il fréquente un cimetière qui recueille des combattants morts non-identifiés qui dérivaient au gré d’une rivière et qu’un groupe de villageois a décidé de prendre en charge. Dans une autre série, il s’arrête sur des objets qu’ont travaillés des personnes enlevées, pendant le temps de leur détention : des tentatives de survie dans un environnement hostile. Ou bien il retrouve, au fond des bois, des objets (tasse, carnet, veste) laissés à l’abandon par d’anciens occupants, qui tenaient là des campements.
L’impression d’ensemble est saisissante. L’ellipse, qui évoque les combats passés avec leur cruauté, tout en projetant la dynamique persistante de la vie (au moins végétale ou animale), et la reprise balbutiante de la vie sociale, a quelque chose de bouleversant. Elle en dit plus, c’est là le paradoxe, sur les souffrances concrètes infligées par les combats de naguère, que des reportages. Et elle situe exactement notre responsabilité dans le pénible travail de reconstruction. Elle sollicite la mémoire, mais elle ne la fait pas tourner en boucle dans un ressassement morbide. Il ne s’agit pas de recuire, une fois de plus, sa haine, mais de considérer un passé comme nous appelant à vivre un autre avenir.
« Souviens-toi … »
Le constat s’impose : nous sommes, dans nos pays surinformés et saturés d’image, des sur-développés du présent, mais des sous-développés du souvenir.
Cela dit, le retour en arrière n’a, semble-t-il, jamais été un exercice si facile. L’Ancien Testament résonne de l’appel incessant, adressé au peuple, de faire retour sur le passé pour en tirer une inspiration au présent. Les prophètes lient souvent l’oubli de Dieu et l’oubli du passé.
Bien sûr, on peut utiliser le passé comme une excuse pour s’installer dans la haine et le ressentiment. Et nous en avons de nombreux exemples autour de nous. Mais on peut aussi l’utiliser pour méditer sur nos propres errances, prendre conscience des souffrances des autres et viser un autre avenir.
Après tout, nous sommes au bénéfice d’une histoire écrite des dizaines d’années après les faits, où ceux qui ont pris la plume n’ont pas cherché à fuir leurs responsabilités ni à masquer leurs insuffisances ; une histoire de violences, d’hostilités et d’incompréhensions, où la vie finit pourtant par reprendre le dessus sur la mort. On appelle cela les évangiles !
Découvrez d’autres contenus sur le blog Tendances, Espérance