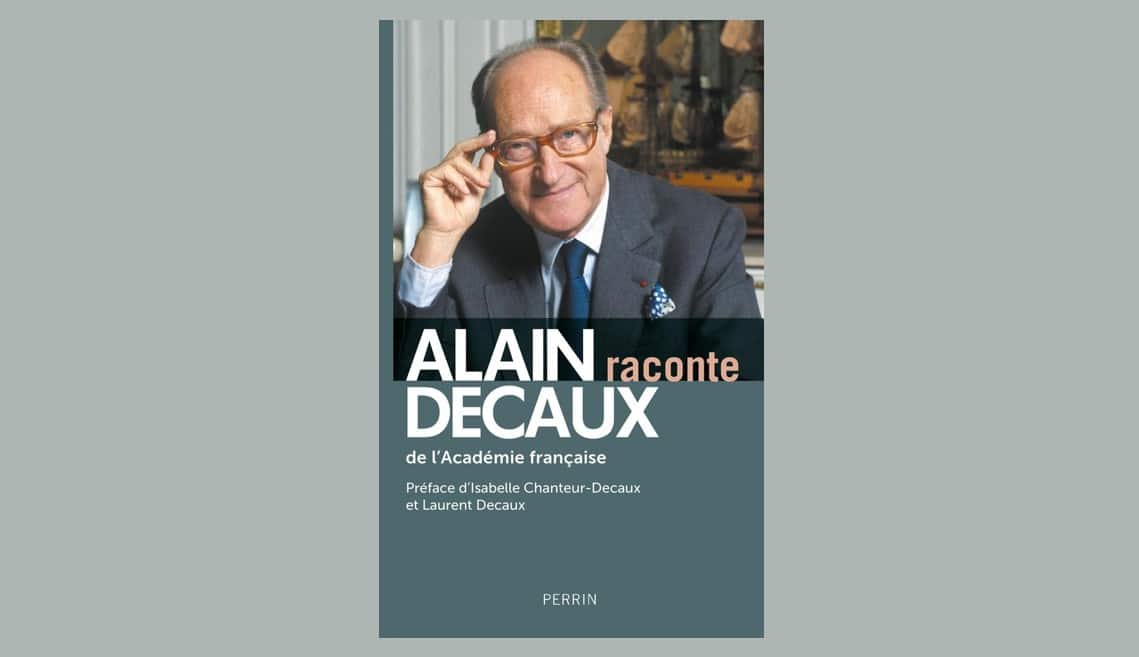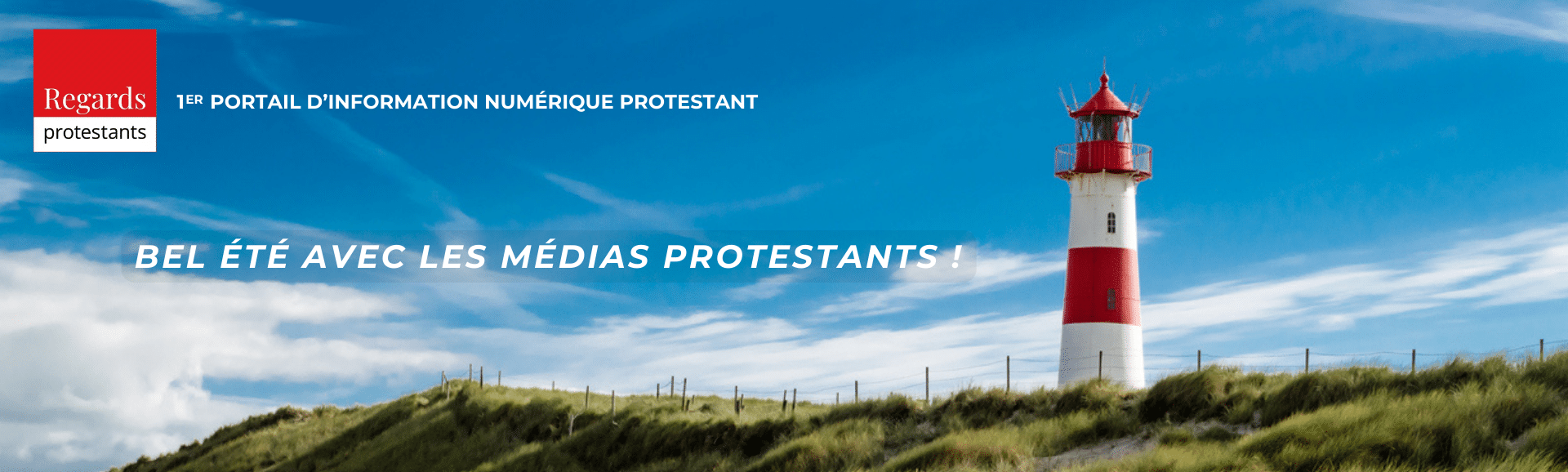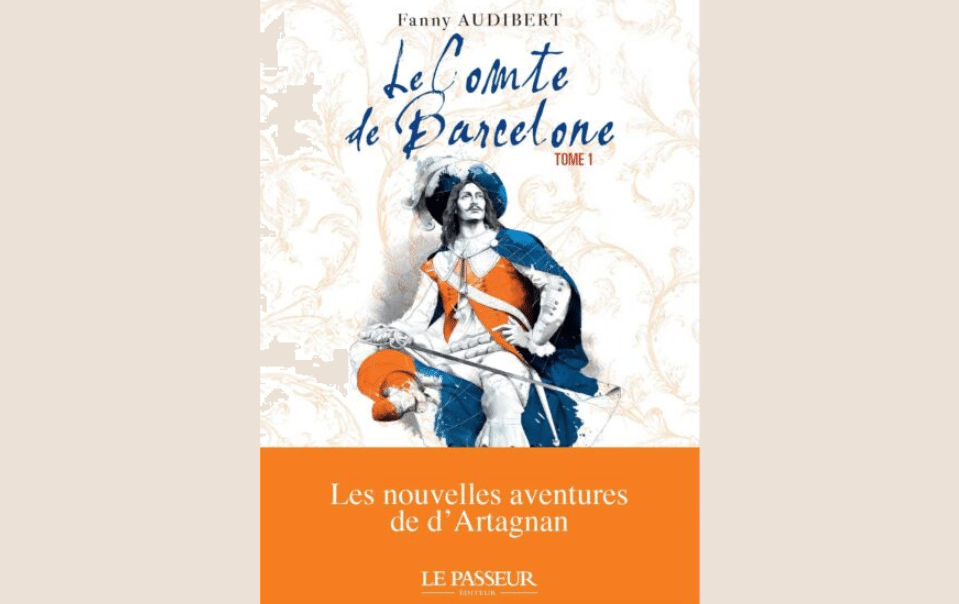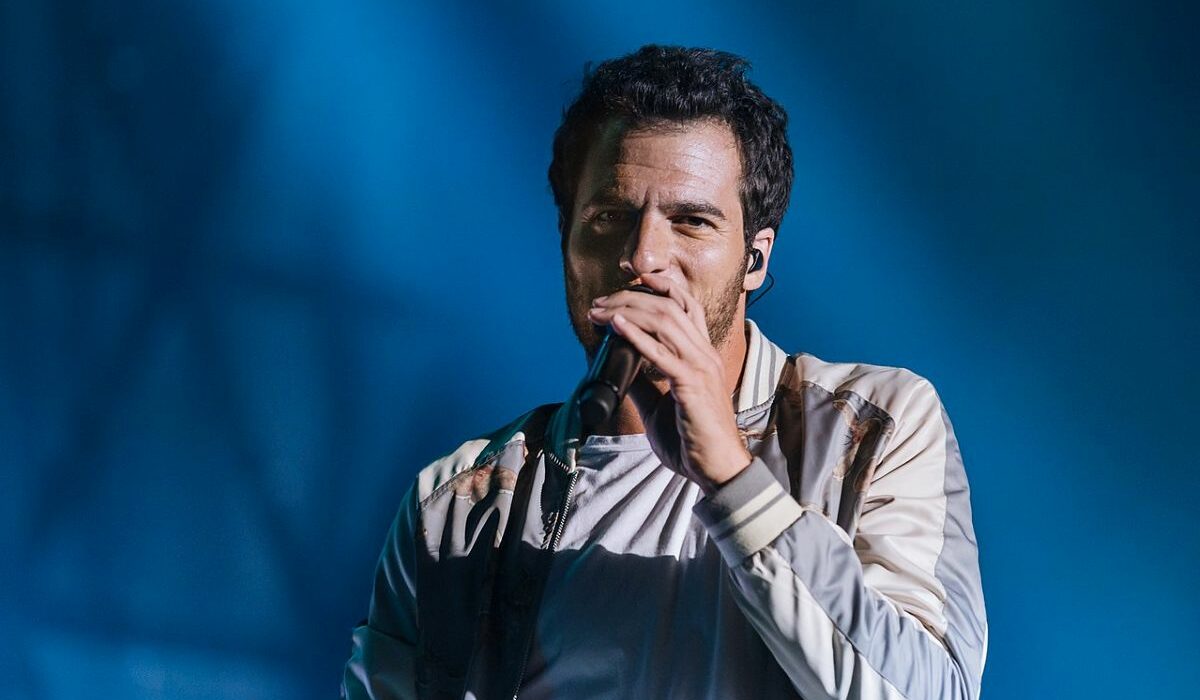Par un matin de l’hiver 2005, au lendemain d’un Gala protestant- le premier qui dit : « vive les oxymores !»…- l’auteur de ces lignes devait rencontrer dans un hôtel situé devant la gare du Nord, Elie Barnavi. Sollicitant les employés de la réception pour se faire annoncer, le journaliste encore vert eut la surprise de s’entendre dire: « cher monsieur, nous sommes désolés, mais nous n’avons pas de client portant ce nom. » Le débutant, plus que soucieux, trouva son interlocuteur au bar, planqué parmi les viennoiseries. Miracle? Évidemment non. Comme dans l’histoire de Moshe demandant au rabbin pourquoi la tartine de Schmalz est tombée du côté sec, on avait oublié qu’il n’y a pas de miracle mais qu’un officiel israélien, par sécurité, s’inscrit souvent sous un faux nom quand il voyage à l’étranger.
Déployant tout à la fois sa vigilance à l’endroit des enjeux politiques et sa hauteur de vue, l’ancien ambassadeur, qui exerçait alors la direction scientifique de l’Histoire européenne à Bruxelles, offrit l’enchantement de son intelligence, de sa générosité, d’une espérance en l’avenir que l’on peine à rencontrer chez nous depuis des lustres. Ellie Barnavi vient de publier ses Mémoires, 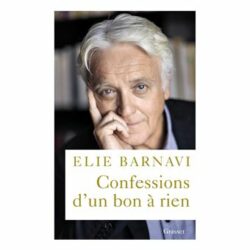
Minute, papillon. Ne soyons pas si pressés. Le destin de cet homme a plus d’un tour dans son sac, et s’il prend naissance à l’ombre de la Shoah -ce qui, pour un enfant de juifs roumains et moldaves, peut paraître une dramatique évidence – il n’a rien de conventionnel. Barnavi découvre Israël en 1961, c’est le temps des kibboutz et des folles amours au soleil des pionnières, s’engage dans un régiment de parachutistes-Dieu vomit les tièdes- et poursuit ses études (amorcées à Tel Aviv) à la Sorbonne sous la direction de Roland Mousnier. La Ligue, tel est le sujet de sa thèse de Doctorat.
« Ce qui m’intéressait, à l’intérieur de ce vaste « parti », comme l’on disait à l’époque, était sa composante jusqu’au-boutiste, plébéienne et proto-démocratique, surgie à Paris en 1585 pour y prendre le pouvoir trois ans plus tard, à la suite d’un coup d’Etat antimonarchique, écrit Barnavi.
Le choix du sujet n’était évidemment pas dû au hasard. Outre la nouveauté radicale de l’organisation- la première, un siècle avant les Diggers anglais et deux siècles avant les Jacobins, à épouser trait pour trait les caractéristiques des partis révolutionnaires-, ce que je trouvais fascinant était l’usage politique du religieux, de la religion comme idéologie partisane. » On le voit, Marc Bloch avait raison: si le passé explique le présent, le présent explique le passé. La dialectique ignore l’anachronisme ; elle en joue, se gausse de lui, ce qui l’entraîne à rejoindre l’uchronie. « L’histoire ne se présente pas comme une chaîne causale en ligne droite mais en une série de carrefours, où prendre tel chemin plutôt que tel autre, relève autant du hasard que de la nécessité, parfois davantage, observe encore Elie Barnavi. Voilà pourquoi affirmer que l’on ne fait pas l’Histoire avec des « si » est tout bonnement stupide. Il faut au contraire faire de l’Histoire avec des « si », car en imaginant les chemins qui auraient pu être pris, et en se demandant pourquoi ils ne l’ont pas été, on comprend mieux celui qui, pour le meilleur et pour le pire, l’a été. »
A cet instant, on continuerait bien, secouant l’esprit des lecteurs au cocktail de cet admirable humaniste, lutteur comme quinze et charmeur comme pas deux. Mais l’impatience vous gagne et vous vous demandez de nouveau ce que vient faire un tel personnage, aussi remarquable soit-il, dans une chronique à vocation politique.
Eh bien voilà…placé presque au centre de ses Mémoires, Elie Barnavi parle de la Cité.
« Je pense que nos credo politiques sont d’abord affaire de tripes, de sentiments, que nous sublimons ensuite en idéologie. Le mien emprunte à Hippocrate le principe primum non nocere, d’abord, ne pas faire de mal. Transposé de la médecine en politique, il signifie qu’on se souvienne que, si l’on ne peut effectivement pas faire d’omelette sans casser des œufs, les œufs qu’on se dit prêt à sacrifier pour cuire l’omelette sociale idéale sont des êtres en chair et en os. Évidemment, je ne parle pas des moments d’exception- gagner une guerre, renverser un pouvoir inique, créer de toutes pièces ce que Machiavel appelait une « principauté nouvelle »- quand le fonctionnement ordinaire du corps social se trouve suspendu. C’est alors le temps de grands faiseurs d’omelettes et je ne vois pas que l’on puisse faire l’économie des œufs. Mais en temps normal, mon idéal politique est de se passer de l’idéal politique. »
A quelques heures de déposer dans l’urne un bulletin de vote- un geste qui, dans l’ordre de la citoyenneté, confine à la transcendance- on ose espérer que ces mots, rédigés par un amoureux de la France, de l’Europe et d’Israël, illuminent votre cœur autant que votre esprit.