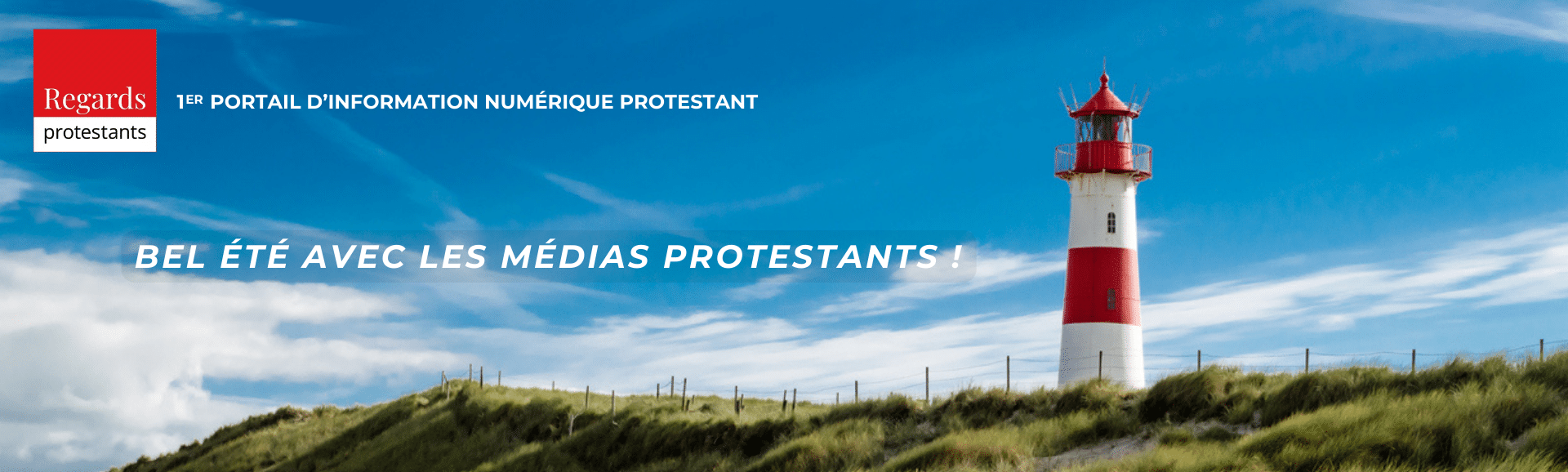J’ai un plaisir particulier à suivre les épisodes de Top Chef, seule émission de téléréalité que je suis régulièrement. Il faut dire que j’aime cuisiner (à un niveau, on l’imagine, qui n’a rien avec voir avec celui de ces professionnels confirmés !). Cette année, un candidat a, à mes yeux, crevé l’écran dès la première émission. Adrien Cachot, chef d’un petit restaurant, à Paris, a tranché dès la première épreuve, en se dirigeant à pas lents vers le garde-manger, pendant que tous les autres candidats se bousculaient. Il a, à vrai dire, dérouté les coachs-chefs de brigade, qui se demandaient s’il était vraiment sérieux, à l’exception de Paul Pairet, chef de restaurants prestigieux et hors norme, à Shanghaï, qui a flairé tout de suite le potentiel de ce candidat atypique.
La suite a été à l’avenant : rapprochement improbable de saveurs, utilisation de produits habituellement délaissés, dessert à la pomme de terre, pâtisserie aux champignons, plat exceptionnel avec de la salade, etc., il n’a cessé de proposer des idées venues d’ailleurs, souvent inventées en temps réel. Adrien Cachot et Paul Pairet ont formé une paire réjouissante, s’entendant comme larrons en foire, Paul Pairet parcourant la scène en faisant l’avion chaque fois que l’un de ses candidats gagnait une épreuve. Lors de la demi-finale, diffusée mercredi dernier, les deux se sont tombés dans les bras, aussi émus l’un que l’autre, quand Adrien s’est qualifié pour la finale;
Paul Pairet dit lui-même qu’il n’a pas toujours compris les idées d’Adrien. Mais plutôt que de s’énerver quand il était dérouté par une de ses initiatives, il préférait éclater de rire. Il est clair que Paul Pairet a retrouvé quelque chose de lui dans ce jeune chef. Dans ce concours où la pression pour gagner est, évidemment, forte, il a fini par dire à Adrien qu’il l’avait choisi, non pas tellement parce qu’il voyait en lui un gagnant en puissance, que parce qu’il discernait en lui un cuisinier en devenir. Et Adrien, de son côté, a abordé les épreuves en usant systématiquement de ce qu’on appelle « la pensée latérale » : ne jamais concentrer ses forces pour aborder l’obstacle de front, mais toujours chercher une autre manière de voir le problème.
Cette rencontre entre un chef confirmé et un jeune chef est d’autant plus touchante qu’Adrien, comme beaucoup de personnes travaillant dans la cuisine, a eu un parcours scolaire difficile. Il dit lui-même : « j’ai été très tôt dans une case : sans avenir ». Enfant rêveur et peu concerné par l’école, il a fini par se découvrir en étant accepté en apprentissage chez un restaurateur. Très ému, en apprenant sa qualification pour la finale il a lâché : « ça a été très long, pendant toute ma vie, de décrocher quelque chose de positif ». De fait, aujourd’hui encore, ses idées stratosphériques ne font pas toujours l’unanimité. Dans le concours, il a souvent provoqué une curiosité bienveillante de la part des jurys, sans emporter tout à fait l’adhésion. Par moments, le courant est passé, mais la créativité a son prix : elle provoque rarement le consensus.
Une société qui manque d’espaces d’invention
Cette situation m’a fait repenser à un livre d’un chercheur américain, Matthew Crawford, Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du travail (trad. franç., La Découverte, 2010). Matthew Crawford, n’est pas que chercheur. Il consacre à peu près un mi-temps à la réparation de vieilles motos. Une partie de sa thèse est assez classique : la division du travail oppose conception et exécution, de sorte que toute une partie de la population n’est pas censée développer ses capacités de conception dans le champ du travail. On se souvient, à ce propos, des remarques grinçantes de Georges Canguilhem : « Il est évidemment désagréable que l’homme ne puisse s’empêcher de penser, (souvent) sans qu’on le lui demande et (toujours) quand on le lui interdit ».
Mais Matthew Crawford va plus loin en disant que cette mise entre parenthèses de la part d’inventivité en chacun de nous s’est répandue dans, pratiquement, tout l’espace social. Entre les processus soi disant optimisés, la communication taillée au cordeau, les recettes toutes faites des consultants, la pesanteur des organisations, la part d’initiative de salariés même assez haut dans la hiérarchie est de plus en plus faible. Il relate, à ce propos, dans un style tragicomique, certaines des missions (assez bien rémunérées) qu’il s’est trouvé devoir remplir et qui étaient totalement dépourvues de sens. Pour ma part, en écoutant ce que racontaient de jeunes consultants de leur travail, j’ai souvent eu l’impression d’un travail incroyablement répétitif, même si les personnes avaient fait de longues études.
En fait, en réparant ses vieilles motos, Matthew Crawford dit que les défis que lui lancent de vieux modèles, dont les pièces détachées ne sont pas en magasin et qui résistent à des procédures rôdées, mobilisent davantage son imagination que les tâches réputées intellectuelles auxquelles il a eu l’occasion de se consacrer. Il parle « d’hypocrisie du travail créatif » et, de fait, ayant eu l’occasion de côtoyer pas mal de personnes assez haut placées dans les hiérarchies d’entreprises et même un grand nombre de chercheurs, je peux témoigner que la créativité n’est pas toujours ce qui est demandé aux salariés. Des personnalités comme Adrien Cachot lâchées dans les organisations verrouillées d’aujourd’hui donnent des sueurs froides à beaucoup de managers. Le paradoxe est que tout le monde a l’innovation à la bouche, mais qu’elle n’est pas si souvent au rendez-vous.
L’exemple de la réparation des motos, et l’exemple que je prends ici, à savoir celui de la cuisine, pourraient faire croire à une nostalgie romantique du travail manuel. Ce n’est pas exactement l’idée de Matthew Crawford : ce qu’il veut pointer du doigt est que nous ne parvenons plus à faire face à un problème concret. Ou bien nous sommes face au problème, mais l’organisation ne nous donne pas la marge d’action pour inventer une solution (et c’est la cause d’un grand nombre de malaises professionnels), ou bien tellement de médiations s’interposent entre le problème et nous, que nous ne mesurons pas en quoi et comment nous agissons sur ledit problème. Et cela vaut pour un problème social, culturel, etc., aussi bien que manuel.
Tout le monde n’a pas le goût d’Adrien Cachot, de Paul Pairet ou de l’auteur de ces lignes, pour les idées décalées. En revanche, je peux témoigner de l’enthousiasme jamais démenti des ouvriers à qui on a proposé de transformer leur environnement de travail pour qu’il fonctionne mieux.
De la revendication à l’invention
Dès lors, la seule position restante, pour ceux qui sont bridés dans leur inventivité, est la revendication. On sait que les français sont réputés pour leur insubordination. Personnellement, je me demande si c’est vraiment là la question de fond. Je pense plutôt que c’est un fruit du faible espace d’initiative que l’on donne aux enfants, aux écoliers, aux lycéens et aux étudiants, aux salariés, etc. Même dans les professions artistiques les règles et les contraintes de la production culturelle produisent du formatage. Est-ce plus le cas en France qu’ailleurs ? Si on compare la France à d’autres pays qui ont les mêmes possibilités économiques, j’ai tendance à le penser.
Quoiqu’il en soit, l’inventivité sociale est une ressource dont on aurait tort de se priver. Dans l’initiative qu’a prise Bruno Latour, pour aider tout un chacun à tirer des enseignements de l’épidémie de COVID19, et du confinement qui s’en est suivi, j’aime bien la troisième grande question qu’il pose : qu’est-ce qu’on invente ?
Mais qui va inventer ? Est-ce que c’est là quelque chose que nous devons déléguer, une fois de plus à des spécialistes de la question ?
Bruno Latour propose, précisément, pour éviter cet écueil, que chacun commence par faire retour « sur une expérience personnelle directement vécue. Il ne s’agit pas seulement, ajoute-t-il, d’exprimer une opinion qui vous viendrait à l’esprit, mais de décrire une situation. C’est seulement par la suite, si vous vous donnez les moyens de combiner les réponses pour composer le paysage créé par la superposition des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique incarnée et concrète, mais pas avant« .
De fait, si on veut inventer d’autres manières de vivre ensemble, le préalable est de libérer la capacité d’inventer qui sommeille (même si c’est à des degrés divers), chez tout un chacun.
Et cela renvoie, au passage, à des questions qui touchent l’organisation de l’église elle-même. Les protestants défendent l’idée du sacerdoce universel : chaque croyant est prêtre, à sa manière, et n’a pas à plier devant un magistère qui lui dit quoi penser et quoi croire. Met-on toujours en œuvre un tel sacerdoce universel ? Non, sans doute. Mais je peux témoigner que, lorsque l’on parvient à le mettre en œuvre, pour de bon, dans l’Eglise, on est étonné du résultat.