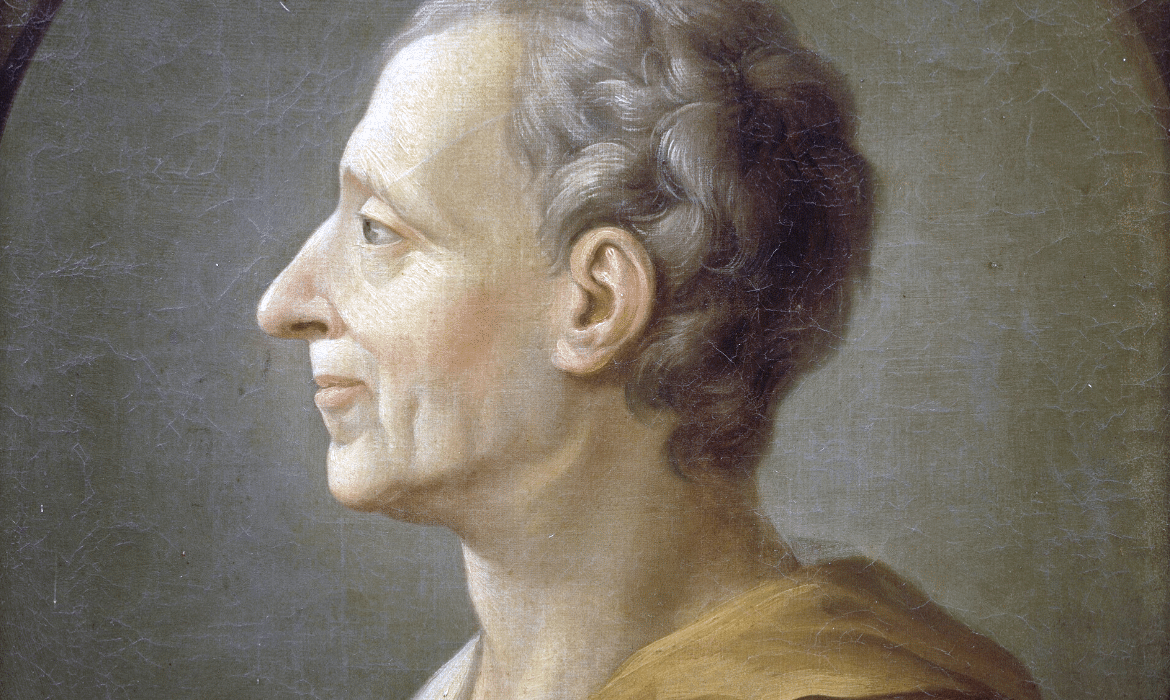Le chef d’entreprise revient sur son parcours et les perspectives de son métier !
L’attachement de Patrick Armand à l’orgue se nourrit de continuité et de ruptures familiales. Issu d’une famille mélomane, dont un père facteur d’orgues, c’est au côté de celui-ci que tout jeune, il a affuté son intérêt pour la musique. « À six ans, mon père était chef de chœur, je tournais les pages de l’organiste pour Le Requiem de Gabriel Fauré », se souvient-il. « Les jours sans classe, je tenais les chevalets pendant qu’il accordait des orgues. » Parmi ceux-ci, Patrick Armand garde encore en tête le grand Cavaillé-Coll de l’église de Saint-Sernin à Toulouse. « C’était monumental. Il y avait même un escalier à l’intérieur. On y passait la journée. »
Chorales des parents, répétitions des organistes sur les instruments que son père leur louait… L’adolescent a côtoyé des artistes. L’attrait du travail manuel n’était pas en reste : « Le soir, je bricolais des modèles ferroviaires dans l’atelier de mon père pendant qu’il travaillait. » À 15 ans, l’héritier vit ses premiers moments d’émancipation : il emménage seul à la ville pour suivre lycée et cours de piano au conservatoire de Toulouse : « Ma première ouverture sur la ville, et l’autonomie très tôt. » Après deux ans d’apprentissage chez son père à Foix, le futur facteur d’orgues franchit un autre cap en 1984 : il quitte l’Ariège pour l’Alsace et rejoint la manufacture Muhleisen comme apprenti, sous la responsabilité de Georges Walter, petit-fils du fondateur. La région était alors la seule où se former au brevet de compagnon. « Je suis passé de l’atelier solitaire de mon père à une boîte de 20 salariés qui faisait de la construction d’orgues. »
Le protestant réformé s’attache à son nouvel environnement de travail comme à la richesse culturelle de sa nouvelle région : « C’était le jour et la nuit avec l’Ariège. J’ai découvert la tradition des Passions à l’église Saint-Guillaume de Strasbourg. Cela m’a beaucoup marqué et j’ai tout de suite voulu entrer dans le chœur. » Depuis son foyer d’étudiant, l’apprenti acère son goût du dessin et présente ses plans de pédaliers à son patron. Des années plus tard, les responsabilités administratives lui sont venues progressivement, jusqu’à ce que la maladie de Georges Walter précipite sa reprise de l’entreprise en 2008. « J’ai dû me jeter à l’eau, mais je l’ai fait parce que j’ai senti un consensus. » Si ses nouvelles responsabilités l’ont éloigné de l’atelier, le chef d’entreprise continue de dessiner tous les plans. « J’espère garder ça jusqu’au bout. » La musique et la famille sont ses ressources privilégiées. Avec son épouse allemande, l’alsacien d’adoption a eu trois fils élevés dans la double culture et dans l’amour de la musique. Patrick Armand est aussi chef de chœur dans l’ensemble vocal La Fratola. Cultes de familles dans sa paroisse d’Erstein, fêtes de la musique… il joue autant que possible avec ses fils. « Quand je fais de la musique, tout le reste s’efface. Ça me rééquilibre. » L’homme confie que bien plus que par le culte, c’est par la musique, sous toutes ses formes, qu’il vit et exprime sa foi.

Quatre questions !
Quelle est la force de la musique d’orgue ?
La musique rythme l’office, c’est le complément de la parole. Ça porte la foi. C’était d’autant plus flagrant lors de la confirmation de mon dernier fils avec ma belle-famille allemande. C’est la musique qui lui a permis d’accéder à l’émotion. On peut toucher beaucoup de gens avec la musique d’orgue, aussi bien dans le cadre liturgique que profane. Il n’y a pas d’autre instrument qui ait ce double rôle. On peut aussi bien trouver des chorals de Bach, porteurs de la foi, que du jazz à l’orgue électronique comme celui de Barbara Dennerlein. Je déplore qu’il y ait aussi peu d’orgues hors des églises. Mais ça vient : les deux dernières salles de concert construites à Paris ont chacune le leur.
Comment concevez-vous la restauration et la création d’orgues ?
Les projets de restauration constituent souvent du travail en déplacement sur plusieurs mois. Ils font tous appel aux mêmes compétences : respecter l’existant et faire abstraction de ses goûts personnels. C’est un travail d’humilité et de respect des générations précédentes. À travers mes voyages, en Europe et aux États-Unis, je découvre des types d’instruments différents. Dans certains pays, il n’y a pas de recul historique comme en France. C’est plus débridé. L’attachement aux racines est important mais peut faire passer à côté de l’opportunité de faire évoluer l’instrument pour le rapprocher des auditeurs d’aujourd’hui. C’est un grand débat : d’un côté les partisans de l’innovation dans la création et de l’autre ceux qui privilégient la tradition. Je suis attaché aux traditions mais aussi très ouvert à faire des choses adaptées à leur environnement et aux aspirations du client. Je ne cherche pas à créer un « modèle muhleisien ». Je garde à l’esprit le mot de mon ancien prof de français : « Que le travail efface le travail », que ça coule de source sans qu’on se rende compte du travail derrière. Avec le souci que l’œuvre reste pour les générations d’après.
Comment se porte votre secteur d’activité ?
L’activité ralentit. On hésite à embaucher et c’est un vrai problème pour les apprentis. L’École nationale des facteurs d’orgues d’Eschau prend de moins en moins d’élèves. En France, les commandes passent surtout par des marchés publics. Ça demande d’être visibles sur les salons, pour faire prendre conscience aux décideurs qu’ils ont un patrimoine. Nous sommes choisis sur nos capacités à vite rédiger des dossiers. Il faut répondre immédiatement et faire vite mais les négociations peuvent prendre des années. C’est très inconfortable. J’ai connu des situations où des projets étaient en négociations mais je ne savais pas ce que les salariés feraient deux mois plus tard. Le marché allemand est autre. Ce sont des commandes de paroisses qui viennent visiter notre atelier. Le contact est bien plus humain avec ces clients. L’an dernier nous avons créé un petit orgue pour Bünde en Allemagne. Mais avant, nous n’avions plus été sollicités pour du neuf depuis dix ans. Par le passé, nous avions des demandes tous les ans et le choix d’y répondre. Aujourd’hui, il faut être à l’affût et candidater soi-même. Pour faire de la création, il faut exporter, sinon c’est terminé.
Comment avez-vous abordé le chantier de Moscou ?
Depuis cette commande, je ne réponds plus à rien d’autre. Il s’agit d’un orgue pour une salle de concert dans un pays qui n’a aucune tradition d’orgue. C’est une porte ouverte pour la reconnaissance de l’entreprise en Russie. Ce qui était décisif était qu’on pouvait commencer de suite. Nous avons proposé de livrer en deux étapes et d’intégrer l’instrument dans l’architecture de la salle. Nous avons pu sous-traiter l’aspect métallurgie à une entreprise voisine que nous connaissons. Dès le départ des négociations, j’ai pu rencontrer l’architecte qui est très ouvert à la discussion sur les idées esthétiques. C’est rare. Le défi me plaît. Nous ne sommes pas en terrain conquis, il faut se défendre. Les négociations sont spéciales. Les Russes ont un mode de communication très différent de nos habitudes. Certaines demandes m’ont surpris, comme celle de faire des bouches de tuyaux dorées à l’or fin. Ça ne va pas dans le sens de ma sensibilité mais nous avons accepté.