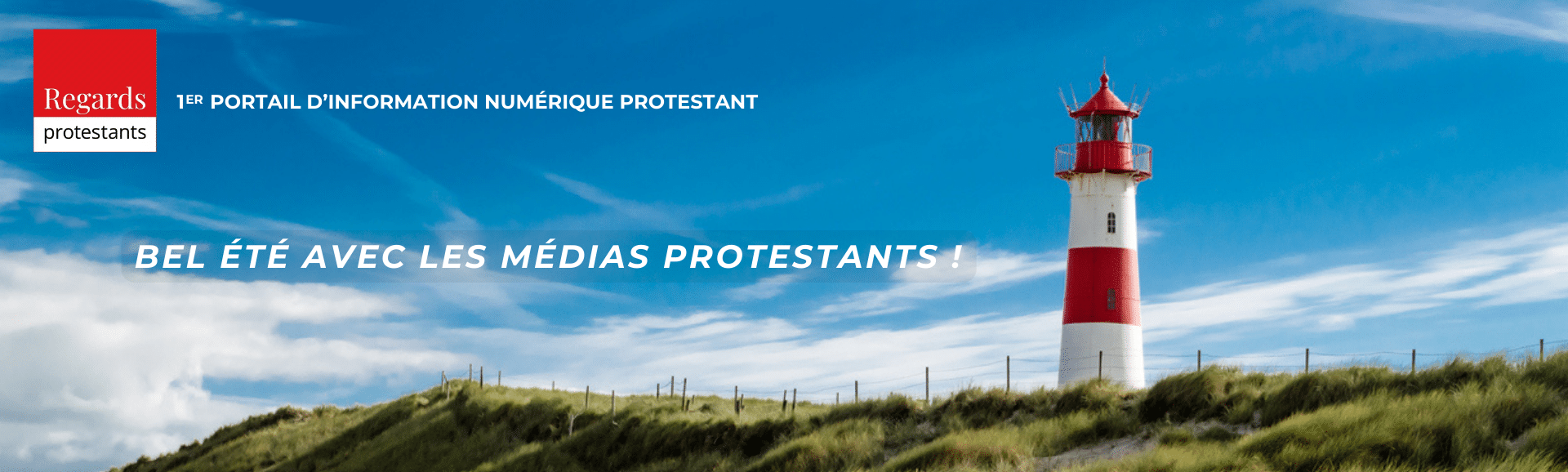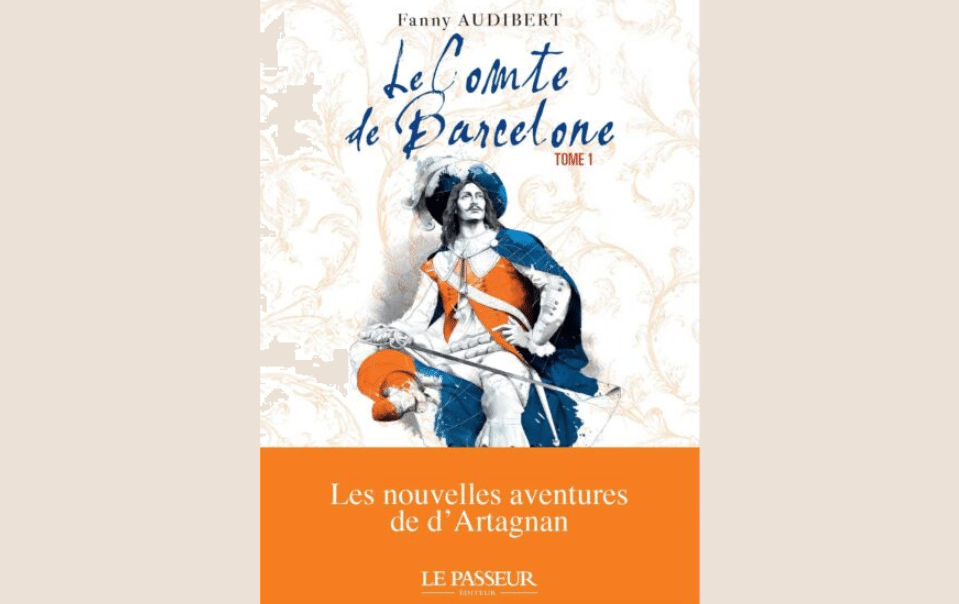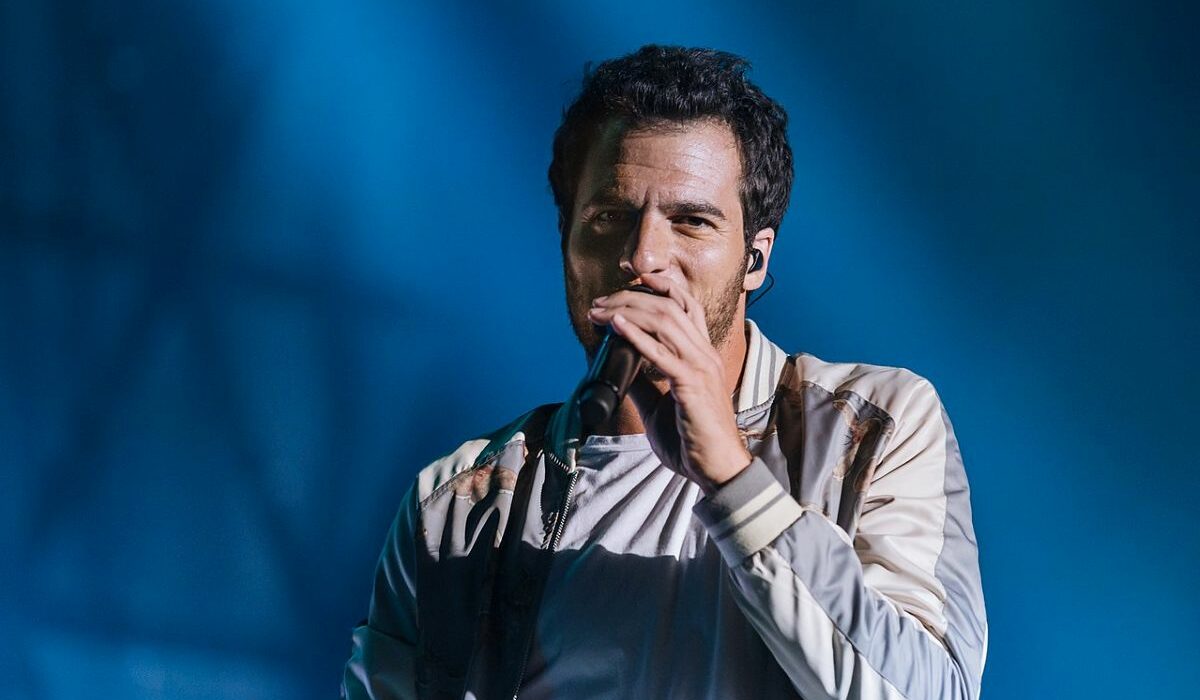En effet, beaucoup de décisions décisives se sont jouées, au plus fort de la crise, au jour près. Mais cette épidémie met en relief des questions de santé publique récurrentes, sur lesquelles les pays riches (pour ne parler que d’eux) buttent depuis de nombreuses années.
Un premier constat étonnant : une surmortalité, puis une sous-mortalité, par rapport aux années précédentes
L’INSEE fait, depuis plusieurs semaines, le pointage de la surmortalité en France, par rapport aux années 2018 et 2019. Premier constat : jusqu’au 28 avril, on arrive à des chiffres de surmortalité qui sont très proches du nombre de morts du COVID identifiés et publiés par le Ministère de la Santé. Je donne les détails : entre le 1er mars et le 28 avril, le Ministère a recensé 23.660 morts (à l’hôpital, en EHPAD ou en établissement médico-social). Pendant cette même période, la surmortalité par rapport à 2019 a été (pointage de l’INSEE) de 25.242 personnes et, par rapport à 2018 (année plus meurtrière) de « seulement » 17.210. On est donc, sans conteste, dans la fourchette et dans le bon ordre de grandeur. Le résultat peut surprendre, car on imagine de nombreuses personnes décédant chez elles sans diagnostic. Mais il faut en conclure que, probablement, cette situation n’a pas été si fréquente. On a donc une représentation à peu près correcte de l’ampleur des décès liés à l’épidémie. Cela coupe court, déjà, à pas mal du supputations.
La comparaison avec les chiffres de 2018 (qui pourrait laisser penser que la mortalité par le COVID semble surestimée) suggère une interprétation complémentaire. Si on parle de surmortalité, il faut prendre en compte qu’un certain nombre de personnes seraient décédées de toute manière, éventuellement d’une autre pathologie, à la même époque. Le COVID a joué le rôle, si on veut, d’affection opportuniste pour des personnes en fin de vie. La différence entre morts du COVID et surmortalité est donc la somme de deux phénomènes qui s’annulent en partie dans les comptes : d’un côté, un certain nombre de personnes décédées sans être diagnostiquées et, d’un autre côté, un certain nombre de personnes qui auraient figuré, de toute manière, dans le décompte des personnes décédées (avec une autre cause de mort).
Il faut penser à ces situations de fin de vie, si on veut rendre compte d’un fait bien plus troublant : depuis le 29 avril, l’année 2020 est en sous-mortalité par rapport à 2018 et 2019 (entre le 1er et le 11 mai, il y a eu 481 décès de moins qu’en 2018 et 1136 de moins qu’en 2019, soit cent de moins chaque jour). Ce qui se passe est que le COVID a précipité la fin de personnes qui sont décédées avec quelques semaines d’avance, de sorte qu’ensuite, la mortalité baisse. Déjà en 2018, la prolongation de l’épidémie de grippe avait provoqué, d’abord, une surmortalité, par rapport à 2019, puis une sous-mortalité, une fois l’épidémie passée. Un cas de plus long terme bien répertorié, est celui de la canicule de 2003, qui a entraîné, pendant l’année 2004, une sous-mortalité.
Ce que l’on retire de ces considérations est que l’épidémie, dans le contexte des fins de vie, n’est pas venue créer de toutes pièces un contexte sanitaire dramatique, elle est venue, au moins en partie, amplifier des problèmes de santé préexistants.
Une épidémie qui, paradoxalement, fait ressortir des problèmes de santé publique récurrents
Et cette remarque a une portée bien plus générale. Dans les pays développés on a oublié, c’est l’évidence, l’importance des maladies infectieuses. On s’est focalisé sur les maladies chroniques, dites non transmissibles, liées pour une part importante au mode de vie sédentaire (diabète, surpoids, hypertension artérielle), à la pollution atmosphérique (pathologies cardiaques ou respiratoires), ou à des pratiques à risques (alcoolisme ou tabagisme). Le paradoxe est que l’épidémie a fait ressortir ces maladies chroniques au lieu de les mettre au deuxième plan. Seuls les fumeurs ont, semble-t-il, été protégés, par un effet encore mal élucidé de la nicotine. Pour tous les autres, le COVID est venu aggraver leur maladie chronique.
Cela a été maintes fois répété : le Ministère de la Santé a indiqué que 80 % des personnes qui ont développé des formes graves de la maladie et qui se sont retrouvées en réanimation avaient une comorbidité chronique. Le pourcentage est encore un peu plus élevé pour les décès.
On peut donc dire que le virus est venu frapper des pays dont la santé publique était problématique. On peut imaginer ce qu’aurait été la gestion de l’épidémie avec cinq fois moins de personnes en réanimation et cinq fois moins de décès. On aurait été dans un autre monde. Au reste, les grandes épidémies ont toujours frappé des populations affaiblies, autrefois, par la famine ou par la guerre. C’est aujourd’hui la richesse et l’équipement technique de nos modes de vie qui nous rendent malades.
… et des problèmes sociaux récurrents
Les tensions sur la santé publique révèlent également des problèmes sociaux. Le diabète et le surpoids, par exemple, sont typiquement des problèmes de « pauvres dans les pays riches ». Cela souligne les inégalités dans l’accès à l’alimentation de qualité : la nourriture la moins chère est aussi celle qui a le moins bon ratio « nutriments utiles / apports caloriques ».
Des journalistes du Monde ont, par ailleurs, examiné, à titre de coup de loupe, les raisons qui ont conduit à une surmortalité assez différente entre les différents départements d’Ile-de-France. En Seine-et-Marne (département le moins dense de la région) la surmortalité entre le 1er mars et le 28 avril a été de 65 %. En Seine-Saint-Denis (département 93), elle a été de 129 %. Mais la densité n’est pas la seule source de la différence. On retrouve, sans surprise, l’incidence du diabète chez les personnes âgées, particulièrement élevée dans le 93.
D’autres facteurs, liés au travail, sont suggestifs. Le 93 ne se distingue pas tellement par son pourcentage de personnels soignants. En revanche on retrouve une population massive de vendeurs et de livreurs. On retrouve également beaucoup de personnes qui doivent sortir de leur département d’origine (et donc faire de longs déplacements) pour se rendre à leur travail.
Enfin c’est aussi dans le 93 que le nombre de m2 par personne, dans les logements, est le plus faible, ce qui, d’une part, rend le confinement plus difficile à vivre, et d’autre part, augmente les risques de contamination au sein du ménage.
La médecine elle-même progresse lentement
Au milieu de tout cela, on a adressé des sortes de demandes éclair à la médecine. Mais, là aussi, on s’est heurté à des réalités de plus long terme. Tout le monde a pu prendre conscience que la crise de l’hôpital, dont on parlait depuis des mois, était bien plus qu’un slogan. La logique gestionnaire, qui a prévalu depuis des années, a fini par mettre le système hospitalier en danger.
L’autre réalité de long terme est que les avancées médicales prennent du temps. Le mirage du remède miracle a fait long feu et j’imagine que les spécialistes des maladies virales n’en ont pas été trop surpris. Les malades du SIDA, par exemple, survivent aujourd’hui, mais ils ne guérissent pas : ils doivent prendre des médicaments à vie. Il est probable que certaines molécules améliorent l’état de certains malades du COVID, mais on est dans le domaine des effets limités, donc difficiles à prouver. Et on a vu que tous ceux qui ont crié victoire trop tôt se sont vus rappeler à l’ordre.
Ce qui vaut dans le domaine des maladies virales, vaut pour les maladies chroniques : ces maladies sont le fruit autant des progrès de la médecine que de ses limites. On est capable, aujourd’hui, d’accompagner sur le long terme des personnes qui, autrefois, seraient décédées dans des délais assez brefs. Mais on ne les guérit pas. On améliore leur santé, on ne la rétablit pas.
La médecine est devenue une affaire d’accompagnement et, à ce propos, l’accompagnement social, sous des formes diverses, joue un rôle non négligeable.
De grandes questions sur notre manière de nous accompagner les uns les autres
Cet enjeu de l’accompagnement nous renvoie, en effet, à de grandes questions :
La question de la vieillesse, de son accompagnement, de la dépendance progressive qui s’installe, de la fin de vie, est très largement devant nous. On sait qu’en temps normal elle coûte beaucoup d’argent. Les maladies chroniques sont d’ailleurs, aggravées par le vieillissement.
On a privilégié, et on privilégie encore, face à l’épidémie, la stratégie de l’isolement. Elle est sans doute pertinente à court terme. A moyen terme, on sait que les personnes âgées vont mal aussi parce qu’elles sont isolées. La longévité n’est, d’ailleurs, pas le seul objectif à prendre en compte. La qualité de vie, pendant le vieillissement, est au moins aussi importante. Or on sait que, depuis plusieurs années, l’espérance de vie augmente, mais que l’espérance de vie en bonne santé stagne. Et cela vaut également pour la santé mentale des personnes âgées, qui souffrent souvent de dépression.
Une autre manière de parler d’accompagnement est de souligner ce que tout un chacun a pu redécouvrir : la santé nous rend solidaires les uns des autres, de gré ou de force. Les plus pauvres payent, on l’a dit, un tribu plus lourd, que ce soit pour des raisons de maladie chronique ou d’exposition aux épidémies. Mais personne ne peut s’en laver les mains. Je ne parle pas, là, de raisons morales qui sont, par ailleurs, évidentes. Si une maladie contagieuse est active sur un bout de territoire, elle constitue une menace pour bien d’autres territoires. Et si on entend maintenir en action des services essentiels, on se rend compte, soudain, qu’ils reposent sur des personnels (livreurs ou vendeurs, par exemple) qui passent facilement inaperçus en temps normal.
C’est aussi en s’isolant, momentanément, les uns des autres que l’on s’est rendu compte à quel point les interactions sociales sont décisives. Nous sommes dans des sociétés fractionnées. Mais nous avons besoin, lourdement besoin, les uns des autres.
Et toutes ces questions resteront posées dans les années qui viennent, quel que soit le devenir de cette infection virale. La santé se construit sur le long terme et elle met un jeu plus que des individus : des groupes sociaux, des nations entières et des relations internationales.