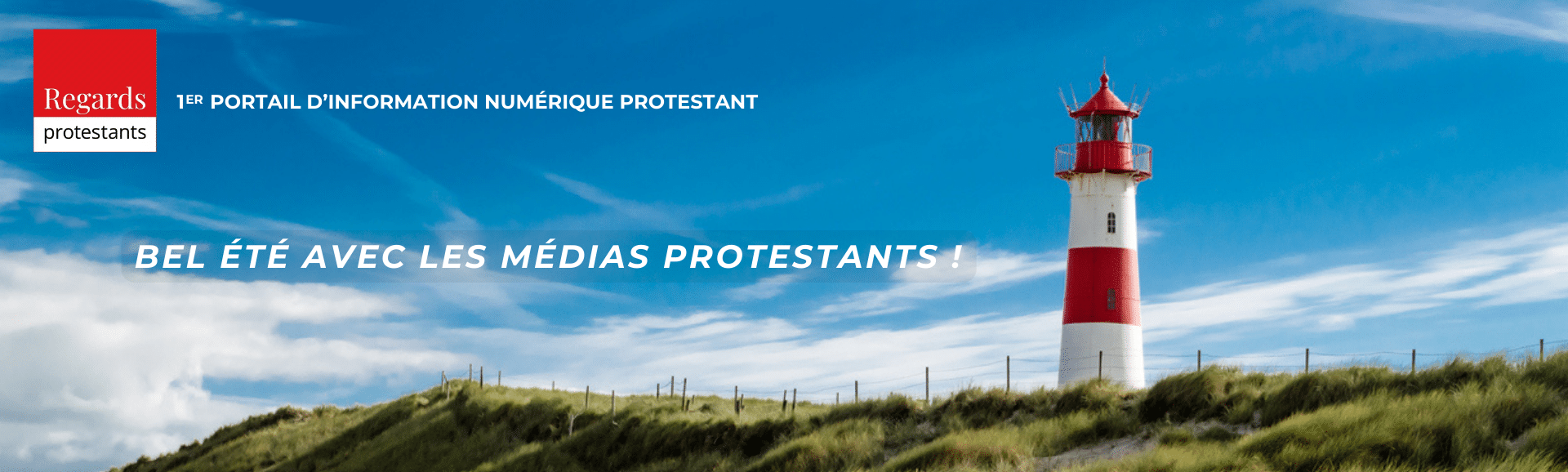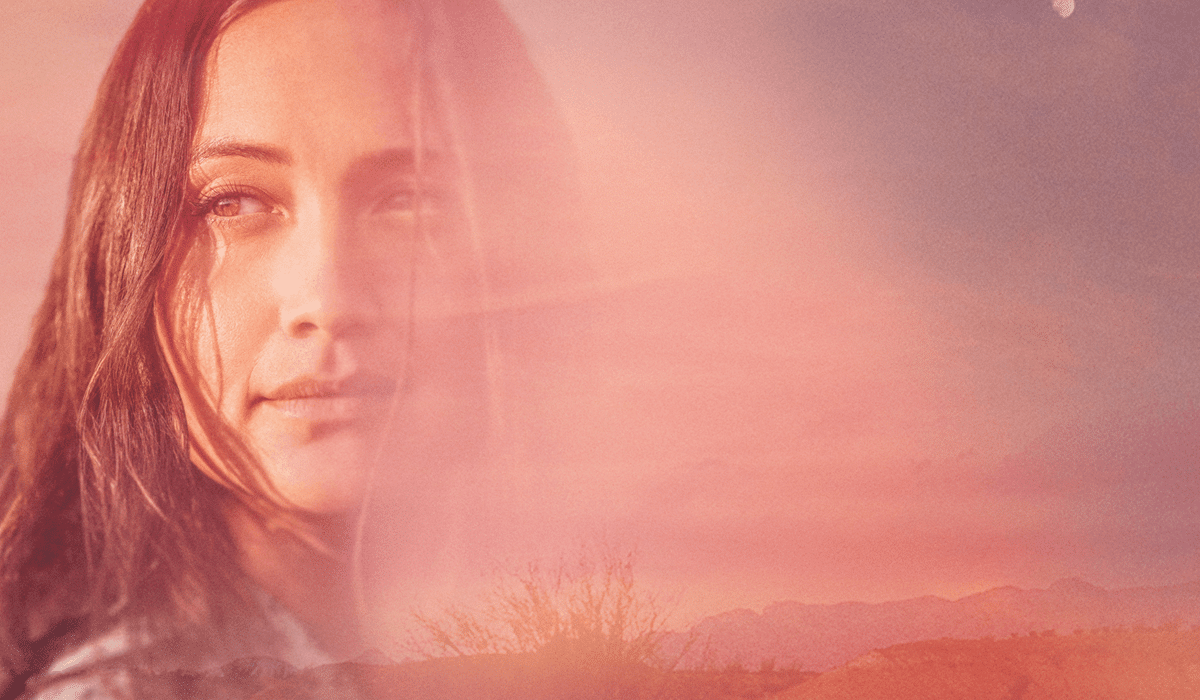En Espagne, il existe un mot pratiquement intraduisible, la sobremesa, qui est un moment, après le repas, où les convives restent à table et discutent tranquillement. C’est un moment de sociabilité particulier qui ne se vit pas de la même manière dans d’autres pays. En France la convivialité se construit plutôt pendant le repas lui-même. Ailleurs, le repas est, parfois, surtout un moment fonctionnel où l’on s’alimente, ce qui fait que l’on passe à autre chose le plus vite possible.
Les changements alimentaires, marqueurs d’évolutions sociales sur le long terme
Est-il possible, alors, de lire des évolutions sociales au travers de ce qui se passe dans notre assiette ? Assurément. De premières choses sont visibles, déjà, si l’on regarde les évolutions de longue durée. Pour la France, le tournant se situe un peu avant le début du XXe siècle. A cette époque, l’essentiel de l’apport calorique provenait des céréales et des féculents. Depuis, les produits animaux, les fruits et légumes, les graisses et les sucres rapides, ont compensé une baisse vertigineuse desdits céréales et féculents. Si l’on décompose les apports entre glucides, lipides et protides on voit qu’on a changé de monde depuis 1900.

On a donc une alimentation beaucoup plus grasse qu’autrefois. Ce qui n’est pas visible sur le graphique est que les glucides ne sont pas non plus les mêmes (beaucoup moins de sucres lents) et les protides non plus (beaucoup plus de protéines animales et beaucoup moins de protéines végétales).
D’un côté on peut se dire que notre alimentation s’est diversifiée. De l’autre on voit que tout ce qui pose problème, aujourd’hui, autant en termes de santé publique que d’empreinte environnementale, résulte d’évolutions plutôt récentes au regard de l’histoire. Dès lors, pour beaucoup de générations qui ont vécu cette transition alimentaire progressive comme un accès à la modernité, la perspective de retourner à une alimentation plus végétale sera forcément vécue comme un renoncement.
Une autre évolution : l’explosion des plats préparés, est beaucoup plus récente. Leur usage a été multiplié (en gros) par 5 entre 1960 et 2000. Cela a été de pair avec un changement dans les lieux d’approvisionnements et le recours croissant aux grandes surfaces. Une évolution très récente (postérieure aux années 2000) montre un retour vers des surfaces de vente un peu plus petites (les hypermarchés sont en recul au profit des supermarchés).
Qu’est-ce que ces évolutions nous disent de l’évolution de notre société ?
- Elles témoignent de transformations économiques, en premier lieu : certains produits de base sont moins chers, le niveau de vie moyen a augmenté, les fast foods ont démocratisé l’accès au restaurant et les plats préparés sont devenus plus variés et moins chers, etc.
- Elles témoignent, également, d’une diminution du temps de travail domestique pour les femmes. Entre 1974 et 2010 (chiffres de l’enquête Emploi du Temps de l’INSEE), le temps passé en cuisine + vaisselle + courses a diminué de 50 minutes par jour (donc près de 6 heures par semaine) pour les femmes. Pendant la même période il a augmenté de … 8 minutes par jour pour les hommes ! Donc, la pratique d’une alimentation plus vite préparée, plus vite achetée, en partie sous-traitée (via des barquettes ou des restaurants), correspond à une évolution majeure du rôle social des femmes. Et l’évolution est encore plus marquée pour les femmes des milieux populaires qui ont eu accès récemment à des moyens auparavant réservés aux femmes cadres.
En revanche, ce que l’on peut remarquer (toujours au travers des enquêtes Emploi du Temps), c’est que le temps consacré aux repas eux-mêmes n’a pratiquement pas varié. Plus de personnes mangent seules, c’est vrai. Mais c’est, apparemment, directement lié au fait que plus de personnes vivent seules.
L’enjeu écologique de l’assiette ; contradiction entre fin du monde et fin du mois
Les liens entre assiette et société marchent dans l’autre sens, également : si l’on entend changer quelque chose aux modes d’alimentation, cela a des retentissements sociaux et culturels majeurs.
Or on estime que l’ensemble de la filière agroalimentaire (production agricole, transport, transformation, distribution, restauration, cuisine) produit environ 30 % de l’effet de serre français. On sait, par exemple, que l’alimentation carnée actuelle n’est pas soutenable au niveau mondial. Son rendement global est faible (il vaut mieux manger directement des céréales que de les faire manger à des animaux que l’on mange ensuite). L’empreinte carbone des ruminants est désastreuse (ils crachent du méthane en ruminant). Et du point de vue de la santé publique, une consommation élevée de viande rouge n’est pas sans danger. Mais cuisiner les végétaux n’est pas si simple (si on veut obtenir des saveurs marquées) et cela prend plus de temps que de faire cuire un beefsteack. On sait aussi que les plats précuisinés ont une valeur nutritive plus faible et une empreinte carbone plus élevée que lorsque l’on cuisine soi-même. Utiliser des légumes congelés est également consommateur de ressources. Il semblerait que tout ce qui fait gagner du temps coûte cher en carbone ! Et même aller au restaurant n’est pas neutre, à moins d’utiliser les services d’un restaurateur particulièrement concerné par les questions écologiques. La plupart des restaurateurs essayent de gagner du temps eux-mêmes, utilisent des préparations toutes faites, des légumes de contre-saison, et tablent massivement sur le congélateur.
Du coup cela met toute une série de pratiques sous pression. Mais quelle est donc la marge de manœuvre de tout un chacun ? Là on retrouve des réalités sociales hélas assez robustes.
Si le temps de préparation est en jeu, on voit mal comment aller de l’avant sans mobiliser d’autres personnes du foyer que la maîtresse de maison (sinon ce serait purement et simplement une régression sociale pour les femmes). C’est envisageable sur le long terme. A court terme les rigidités semblent très fortes.
Du côté de l’économie, il est assez normal que les personnes qui ont le moins de ressources soient les moins enclines à acheter de la nourriture biologique ou de meilleure qualité. L’enquête de l’INSEE sur le budget des ménages de 2017 montre que les 20 % les plus pauvres dépensent 18 % de leur budget pour l’alimentation, tandis que les 20 % les plus riches n’y consacrent que 12 %. Les ménages les plus pauvres ont donc une marge de manœuvre bien plus faible. Ils n’ont pas tellement les moyens de substituer une dépense à une autre.
C’est donc un domaine où, comme on l’a dit au moment du mouvement des gilets jaunes, les exigences de fin du mois s’opposent aux réflexions sur les menaces de fin du monde que font peser sur nous les désordres écologiques.
Et cette divergence dans l’horizon de temps considéré va plus loin. Comme le notent les auteurs du rapport d’expertise dont nous avons extrait le graphique ci-dessus : les couches sociales défavorisées ont « un sentiment moindre d’auto efficacité et une faible estime de soi. Les sujets ne se sentent [dès lors] pas capables de réaliser des modifications […] de comportements trop éloignés de leurs habitudes. [Et, ils ont, par ailleurs] une difficulté à se projeter vers l’avenir […] en raison des difficultés immédiates de la vie » (pp. 231-232 du document). Le nombre d’événements désagréables qui leur « tombent dessus » et sur lesquels ils ont peu de prise les installe dans une forme de fatalité à l’égard de l’avenir lointain.
On voit comment le rapport à l’assiette met très rapidement en évidence des rapports au temps fortement clivés.
Les paradoxes de l’eschatologie ordinaire contemporaine
Or, il y a quelque chose d’inédit dans ce clivage des horizons de temps. En effet, à travers l’histoire, ce sont plutôt les couches sociales défavorisées qui ont manié des discours eschatologiques, tandis que les groupes plus favorisés se satisfaisaient de bénéfices à court terme. Les difficultés de fin de mois faisaient espérer l’horizon d’un autre futur. Un tel retournement est-il lié à la sécularisation ? Pas uniquement. L’eschatologie laïque avait, jusqu’à présent, obéi aux même règles : les espoirs révolutionnaires et l’attente d’un grand soir fleurissaient parmi les ouvriers. Le fait que les groupes favorisés raisonnent sur un horizon de temps plus long que les autres témoigne, me semble-t-il, d’une mutation historique majeure où les plus pauvres ont tout simplement perdu tout espoir, qu’il soit terrestre ou céleste.
Car pour le reste, je pense qu’il n’est pas hors de propos de parler d’eschatologie à propos de la « fin du monde » écologique. Elle est là pour orienter nos pratiques dans le présent, évidemment. Mais l’eschatologie néo-testamentaire n’était pas, non plus, une pure attente. Elle était plutôt une manière, elle aussi, d’orienter les pratiques présentes au regard d’une réalité à venir. Et, d’ailleurs, l’engagement des chrétiens par rapport aux menaces qui pèsent sur le devenir de l’humanité a aussi ce sens. Dieu, dans son amour, nous appelle à nous soucier des autres, de nos prochains actuels et futurs car c’est cet amour qui prévaudra à la fin des temps.