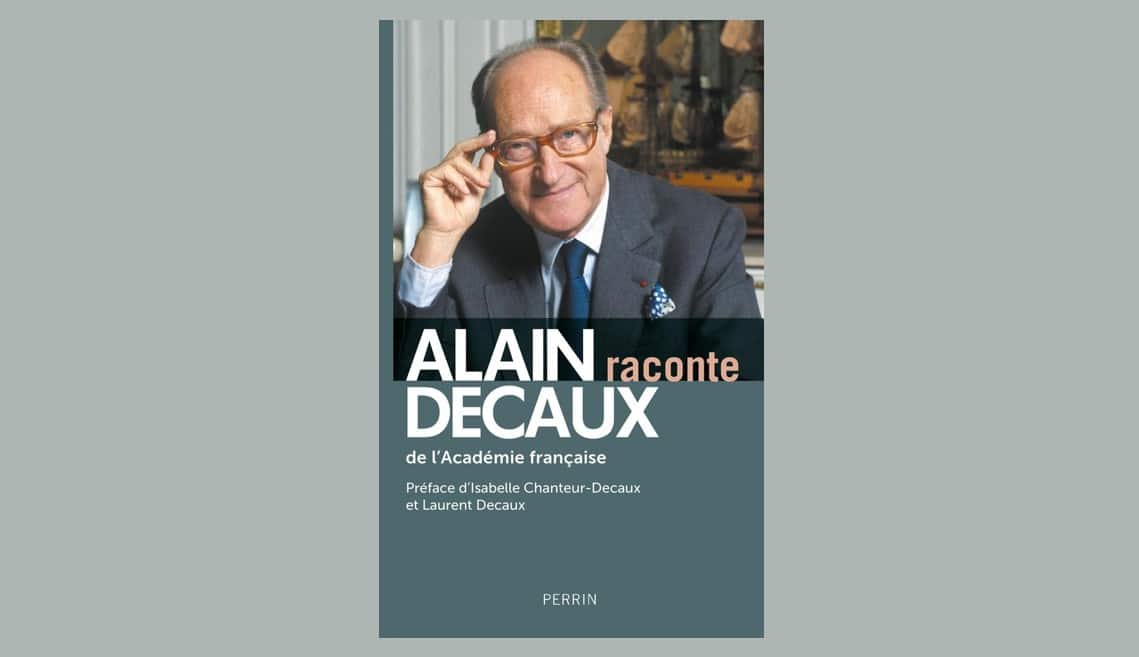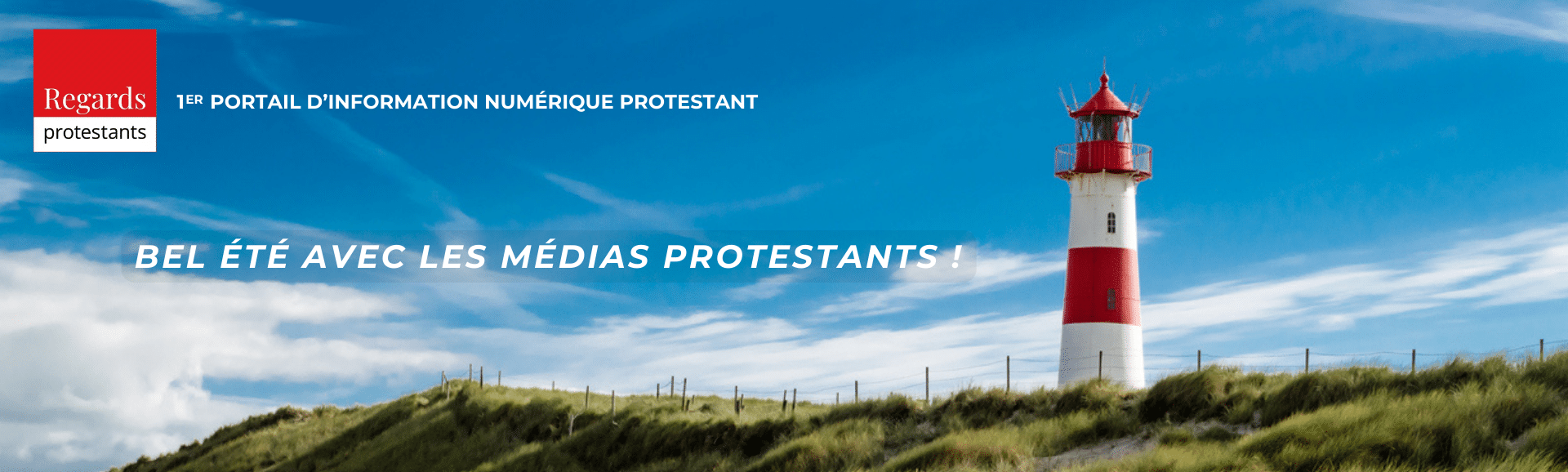Rien ne presse. Il prend son temps, fait mine d’arpenter ses souvenirs d’enfance et d’écouter la rumeur du monde, alors que ses opposants se lancent dans des négociations dignes de l’hôtel maquignon.
Méfiance tout de même. A force de susciter le désir, Emmanuel Macron pourrait provoquer la déception. Plus les jours vont passer, plus va s’installer l’idée que le président ne sait pas trop quelle orientation choisir ni quelle personnalité pour l’incarner.
Ce genre d’hésitation, consubstantielle à tout second mandat, ne doit pas nous surprendre. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans cinq ans. Cette évidence enclenche un compte à rebours qui va le faire mourir en politique à petit feu, faire naître des vocations, des rivalités, la compétition précoce des ambitions. Mais l’essentiel réside aujourd’hui dans l’articulation du souhaitable et du possible.
En lisant, « Philosophie critique de la République » de Charles Renouvier (Gallimard (404 p., 22,50 €), le chef de l’Etat trouverait-il une source d’inspiration ?
Cet ouvrage tient de la fontaine aux lions, du don du Nil ou du grimoire aux sagesses recouvrées. Rien de sentencieux, des propositions complexes mais palpitantes. « L’unique but de Renouvier est de construire une République juste, et il affirme que cette exigence de justice et de fraternité donne à l’Etat des devoirs vis-à-vis des plus pauvres, ceux qui ne possèdent pas les instruments du travail, explique Marie-Claude Biais, qui a réuni en un volume des articles épars d’un polytechnicien-philosophe ayant vécu de 1815 à 1903. Comme il tient à la liberté d’entreprendre, il prône de libres associations de travailleurs fécondées par de vastes institutions de crédit et d’assurance. Deux choses lui importent avant tout : ne pas faire une République des fonctionnaires, système oppressif et totalitaire, et préserver, face à toutes les tentations insurrectionnelles, la voie démocratique, celle du suffrage universel. » On vous imagine déjà ronchonner, soupçonner que l’auteur de ce blog, à force de puiser dans le passé, torde le présent dans le sens qui l’arrange. Minute ! Ecoutez Renouvier…
« Où sont les cités qui ont respecté rigoureusement le droit personnel ? Où sont les citoyens que l’on peut regarder comme de vrais et parfaits contractants du contrat social immanent et rationnellement défini ? Quelle majorité a jamais fait aux minorités la part de liberté et d’action qu’exigerait sa propre légitimité pour être incontestable ? Toute constitution serait donc injuste et toute législation ou peu s’en faut exposée à une fin de non-recevoir ! La lutte des majorités et des minorités, destinée à déterminer l’ordre légal et ses variations, devient cette lutte confuse des partis, mêlée de violence et de ruse, dont les conditions sont périodiquement renversées par des révolutions. » Propos de jadis ? On le reconnaît. Mais leur pertinence demeure. Elle pourrait nous éclairer plus souvent. Non pour admettre l’inadmissible, mais pour gagner en lucidité.
Ceux qui trouvent cette chronique bien sévère aimeront « La bienveillance des machines », étude passionnante conduite par le philosophe Pierre Cassou-Noguès (Le seuil, 329 p. 23€).
Sérieux mais porté par un humour épatant – l’ouvrage commence par un hommage à Tati – cet essai nous invite à comprendre comment le numérique nous transforme. « Poser la question de l’impact des nouvelles technologies sur la subjectivité humaine en termes d’intelligence ou de bêtise, d’enrichissement ou d’appauvrissement, est trompeur, écrit l’auteur. Il est certain que nous avons délégué à des machines toute une part de ce qui faisait nos capacités intellectuelles. Nous ne faisons plus de calcul mental, nous ne retenons plus les numéros de téléphone, ni nos rendez-vous. Les téléphones dans nos poches le font à notre place. » Mais cette évolution provoque bien plus qu’un simple déplacement : les machines deviennent les dépositaires de notre intimité, donc d’une part essentielle de notre existence. « Elles s’accaparent notre expérience même, nos états d’âme, qu’elles sont supposées pouvoir lire dans nos cerveaux, ou dans nos clics ou sur nos visages : ces émotions, ces pensées, que nous devions être seuls à connaître dans leur réalité. Nos états d’âme donc, aussi bien notre humeur que nos sensations et nos pensées, peuvent maintenant apparaître sur une machine. »
A la fin de l’envoi, touchons. Dans un coin de la bibliothèque, une ancienne Histoire de la France, excellente, originale par son plan thématique, attend que l’on ouvre de nouveau l’un de ses quatre volumes. Elle fut dirigée par André Burguière et Jacques Revel, publiée voici plus de trente ans. Le plaisir nous conduit vers le portrait (rédigé, s’il vous plaît, par Emmanuel Le Roy Ladurie) d’un homme politique alors plein d’avenir : « Le ministre-maire impressionne les Nordistes, et les Français en général, par son humour froid, nuancé d’intelligence et d’attentive affabilité. » S’ensuit la description des mille petites réussites par lesquelles cet élu local améliora le sort de ses administrés. Michel Delebarre– puisqu’il s’agit de lui– nous a quitté voici déjà quelques semaines ; en dépit d’une fin de parcours politique un brin catastrophique, il s’était toujours efforcé d’appliquer le socialisme sincère et pratique dont le chef de file avait été Pierre Mauroy.
Comme disait l’autre, « chacun se termine.» Il n’en reste pas moins que le cœur à l’instant nous pince et qu’il nous vient une idée. En lieu et place de quelque robot pensant, technocrate à sang froid, le président Manu ne pourrait-il nommer Premier ministre une femme ou un homme alliant à la raison des qualités de cœur ?