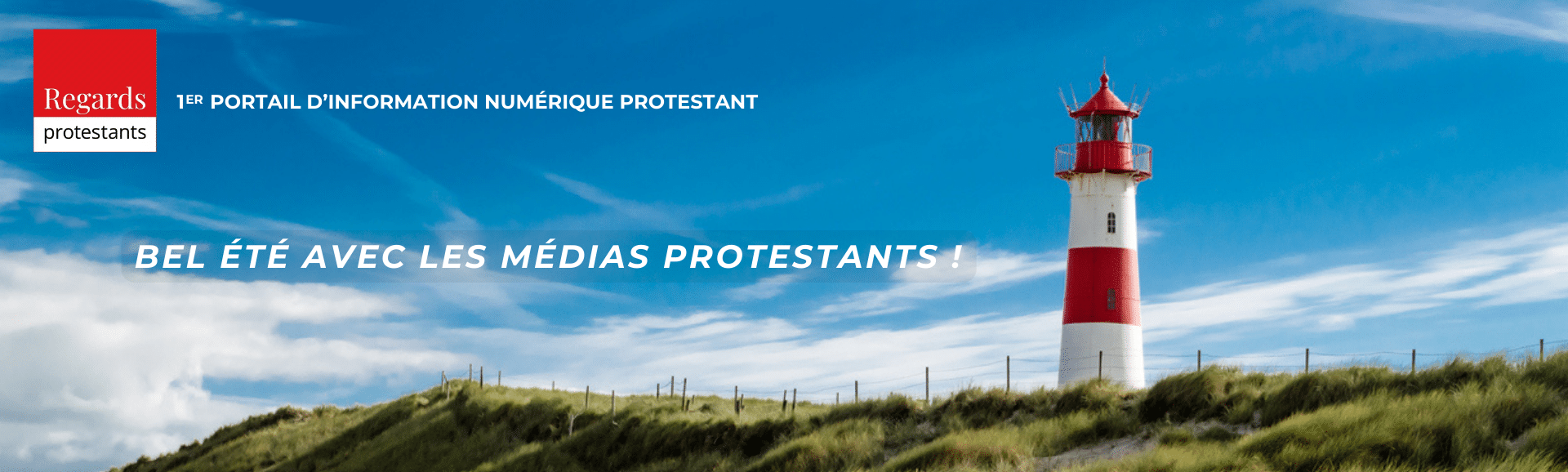On en a, finalement, peu parlé dans la presse, peut-être parce que les résultats des universités françaises sont moins catastrophiques que d’habitude ! De fait, depuis plusieurs années, des opérations de regroupement entre établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont été menées, en France, dans le but de faire meilleure figure à ce classement et, mécaniquement, ces opérations ont fini par porter leurs fruits. Dans la mesure où bon nombre d’items de ce référentiel sont des chiffres absolus, et non pas des pourcentages, plus une université est grande, mieux elle figurera. Cela ne signifie pas, pour autant, qu’elle produit de meilleurs travaux.
L’excellence, un mot valise
Ce classement (même quand on le méprise) a soutenu, à travers le monde, depuis sa création, une course à « l’excellence », mot que l’on emploie souvent sans s’interroger sur son sens.
L’étymologie est intéressante : excellere en latin, signifie, dépasser, être au-dessus. C’est donc un mot relatif et, si on l’emploie dans ce sens, le nombre de personnes excellentes est plus ou moins toujours le même. Ce n’est pas toujours dans ce sens qu’on l’emploie en français. Mais il est clair que les classements divers (entre lycées, entre grandes écoles, entre universités en France et à l’international), désignent toujours un numéro 1, et aussi peu d’institutions dans les dix premiers (dix, exactement !), quel que soit le niveau des établissements en question !
Le Trésor de la langue française propose, à côté de ce sens relatif, une acception plus qualitative ; excellent : « qui possède le maximum de qualités requises pour correspondre, presque parfaitement, à la représentation idéale de sa nature, de sa fonction« . Là cela pose une question plus intéressante : que cherche-t-on à faire le mieux possible dans l’enseignement supérieur et la recherche ? A cela, il y a une pluralité de réponses possibles et c’est, en fait, le propos de ce post.
Je ne vais, il faut le préciser, pas ironiser sur la recherche de l’excellence. Je serais mal placé pour le faire. J’ai dirigé, en effet, un LABEX (laboratoire d’excellence) suite à un appel d’offres mis en place, entre autres, pour contribuer à faire remonter la recherche française dans les classements internationaux. Mais, tout en coordonnant l’équipe qui montait le dossier de candidature, puis tout en dirigeant, ensuite, la structure, je n’ai cessé de me poser la question de savoir en quoi, exactement, on souhaitait exceller.
Se confronter aux autres : différentes manières d’être excellent
Il ne faut, d’abord, pas se cacher derrière son petit doigt : la recherche est un milieu foncièrement compétitif. J’ai dirigé une école doctorale, avant de diriger le LABEX, et, vu que les allocations doctorales sont en nombre limité, j’ai toujours essayé de produire un jugement collectif le plus éclairé possible, afin que les allocations aillent aux « meilleurs » candidats. Quant aux recrutements de maîtres de conférence, ils provoquent un afflux de candidatures : en général, au moins cent dossiers pour un poste! Quel que soit le critère retenu, il faut bien choisir.
On ne cesse d’être comparé aux autres chercheurs, pour l’accès aux revues, pour l’accès aux financements de recherche, dans les colloques ou les séminaires, etc. Cela ne veut pas dire que l’on est obligé de rentrer dans cette concurrence plutôt cruelle : on peut parfaitement mener sa vie de chercheur en se contentant d’une position obscure. Mais si on veut faire passer ses idées, même modestement, il faut être prêt à quelques combats.
Mais la question de l’excellence doit-elle se limiter aux résultats de ces diverses compétitions ?
Une chose qui est apparue, au début des années 2000, quand les premiers classements sont sortis, c’est que les chercheurs français étaient moins présents que d’autres dans les revues internationales. Je peux témoigner que c’était spécialement vrai en sciences sociales. Et il ne faut pas invoquer les « standards anglo-saxons ». La recherche effectuée par des anglophones est bien plus diverse qu’on ne le pense et, en sciences sociales, elle est parfois encore plus marquée à gauche qu’en France ! Cela voulait-il donc dire que les français faisaient de la mauvaise recherche ? Pas vraiment : dès que les jeunes chercheurs ont pris conscience du problème, ils ont publié comme les autres (et pas seulement les anglophones) dans des revues internationales. La seule chose est que la recherche française a dû s’intéresser de plus près à ce qui se publiait à l’étranger, et cela lui a plutôt profité. Et cela a également profité aux pays qui connaissaient mal la recherche française.
Sortir de son environnement habituel et s’intéresser à d’autres points de vue est pratiquement toujours source d’enrichissement. Mais cela ne passe pas forcément par la compétition. Dans le cadre du LABEX nous avions soutenu la constitution de groupes de recherche interlaboratoires sur des sujets émergents. Les (petits) financements étaient faciles à obtenir, du moment que les collectifs travaillaient en réseau à partir de points de vue différents. Le résultat a été une belle créativité, là où les logiques de compétition tendent, au contraire, à favoriser les chercheurs qui se spécialisent dans un objet restreint et creusent un sillon donné où ils deviennent des références.
En dehors du LABEX, sur le même site géographique, d’autres structures se sont crées pour favoriser les transfert entre recherche et innovation (y compris des innovations sociales) : c’est une autre manière de faire se rencontrer des points de vue différents. Aux Etats-Unis le passage de la recherche au marché est fluide et cela a donné naissance aux GAFA. Il existe peut-être une autre manière de faire. En Europe continentale, on est un peu partout à la recherche de cette autre manière. Les avancées sont laborieuses. Il n’empêche que, là aussi, cela a fait avancer aussi bien les chercheurs que leurs vis-à-vis. Je ne sais pas si les uns et les autres sont devenus excellents, mais ils sont assurément devenus meilleurs.
Au milieu de tout cela, question franco-française, le rapprochement du monde des grandes écoles et de celui des universités a donné lieu a beaucoup de crispations. Mais, une fois de plus, j’en tire un bilan plutôt positif (j’en parle au passé, car j’ai quitté le navire en 2017, en partant à la retraite).
Dans une société de plus en plus cloisonnée, une des missions de la recherche et de l’enseignement supérieur est de ne pas céder au cloisonnement eux-même et de se confronter, de manière créative, à d’autres manières de voir. Je pense que là, c’est un domaine où cela vaut la peine de parler de quête de l’excellence.
Il n’y a pas que les prix Nobel qui sont utiles : l’excellence a une portée bien plus vaste
Le talon d’Achille du classement dit de Shanghai est qu’il donne un poids exagéré aux prix Nobel. 10 % de la note tient compte du nombre d’anciens élèves qui ont eu le prix Nobel (ou la médaille Fields en mathématiques) et 20 % de la note, le nombre de prix Nobel parmi les chercheurs qui travaillent actuellement pour l’institution. Encore 20 % de la note tient compte du nombre de publications dans seulement deux revues : Nature et Science. En clair, on survalorise une toute petite partie des chercheurs, et les universités qui veulent être en tête de liste peuvent parfaitement poursuivre une stratégie élitiste : mettre le paquet sur quelques cracks et se désintéresser de tous les autres.
Cela rejoint peut-être une vision romantique de la science : une histoire héroïque dominée par quelques génies en petit nombre. Mais l’essentiel des avancées scientifiques, depuis 1950 au moins, a été le fait d’une poussière d’individus et de collectifs et c’est la qualité du milieu, dans son ensemble, qui importe, plus que l’existence de telle ou telle tête d’affiche. Il importe donc davantage de créer des écosystèmes innovants, que de monter des écuries de course.
Et puis l’enseignement supérieur et la recherche ont partie liée : nous sommes dans des sociétés complexes et il est, dès lors, indispensable de former des personnes qui seront en mesure de faire face aux enjeux de ces sociétés. Il y a ce qu’on appelle la formation par la recherche (et même ceux qui font des masters professionnels doivent apprendre à se poser des questions, même modestes, qui correspondent à une méthodologie de recherche). Il faut bien mesurer que l’essentiel du transfert entre recherche et hors-recherche passe par les formations de master. On doit donc devenir excellents dans cette capacité de transfert à un maximum de personnes.
Et puis il y a les formations de licence. J’ai plusieurs fois dit, dans ce blog, que le talon d’Achille des sociétés actuelles est la perte massive d’emplois d’ouvriers et d’employés qualifiés. Si on veut éviter que les enfants de ces personnes se retrouvent sur le carreau, il faut continuer à améliorer les formations de licence. Au jour d’aujourd’hui, en France, on ne sélectionne pas à l’entrée à l’université, mais on tolère des taux d’échecs vertigineux dans les premières années de formation. Or il y aurait moyen de devenir, pas forcément excellents, mais collectivement meilleurs dans ce domaine et cela éviterait pas mal de tensions sociales.
La recherche, une activité comme les autres
Oui, l’exploration scientifique n’est pas une activité tellement différente des autres. Elle remplit certaines missions dans la société et pas seulement des missions platement utilitaristes : elle construit également une certaine approche des choses, un goût pour le questionnement, une familiarité avec des interrogations fondamentales pour tout un chacun. Et, comme toutes les activités, elle est soumise à évaluation. Il est assez facile de se convaincre que l’on est excellent soi-même, mais le regard extérieur est indispensable. Et il faut donc bien inventer des outils d’évaluation, aussi imparfaits soient-ils.
Mais on revient vers la question : que convient-il d’évaluer ? Si je prends une comparaison, je pense que tout le monde sera d’accord avec le fait qu’il y a une différence entre l’état physique général de la population d’un pays et le nombre de médailles que ce pays gagne aux jeux olympiques. Le classement de Shanghai ressemble, finalement, aux jeux olympiques. Il reste donc la grande question : comment dans une société de plus en plus complexe peut-on faire partager un maximum d’enjeux, et comment faire profiter un maximum de personnes de la dynamique d’innovation ?
En conclusion on se souviendra des considérations des évangiles sur le couple gagner / perdre. Par exemple : « que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’ils se perd lui-même ? ». On croit parfois gagner quelque chose, mais au prix de lourdes pertes. On peut gagner un concours d’excellence et perdre de vue l’essentiel : ce qui fait le sens du métier de chercheur et d’enseignant. Oui, cela arrive.