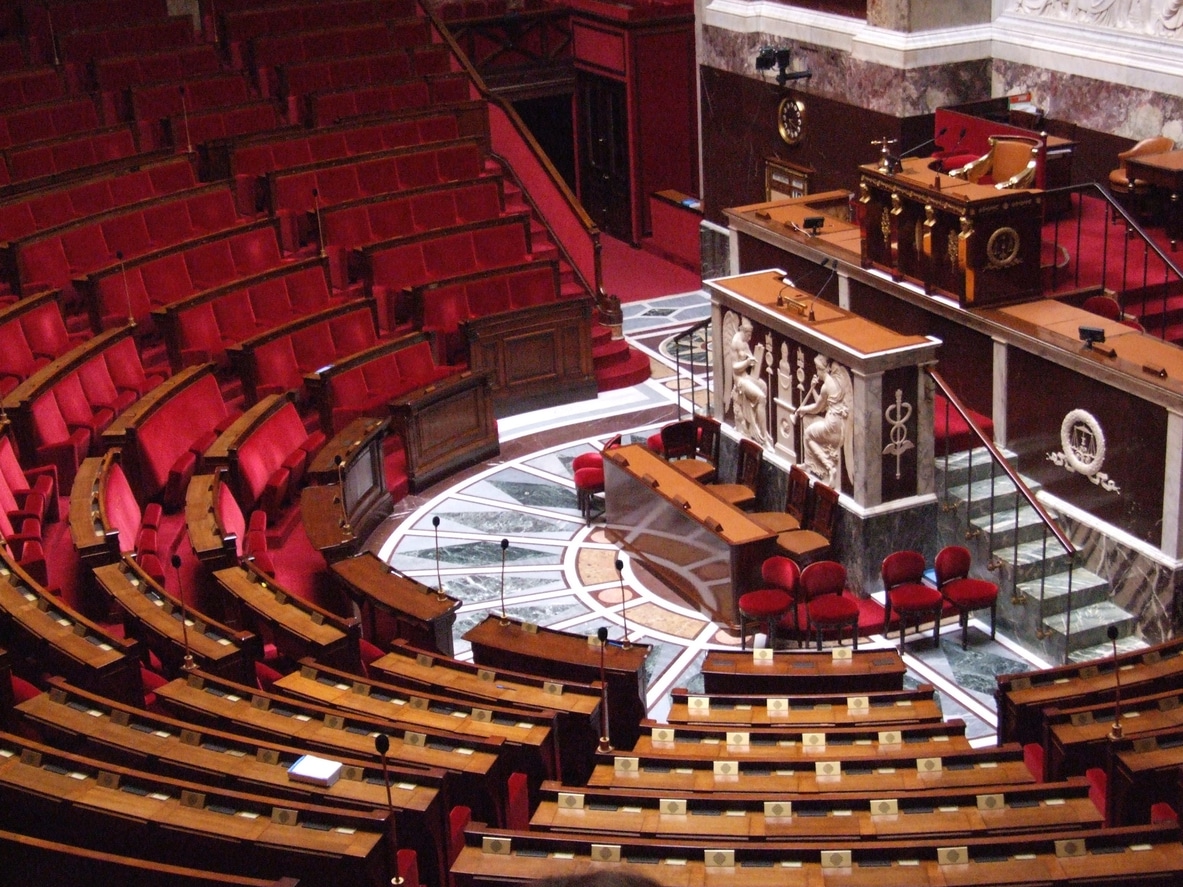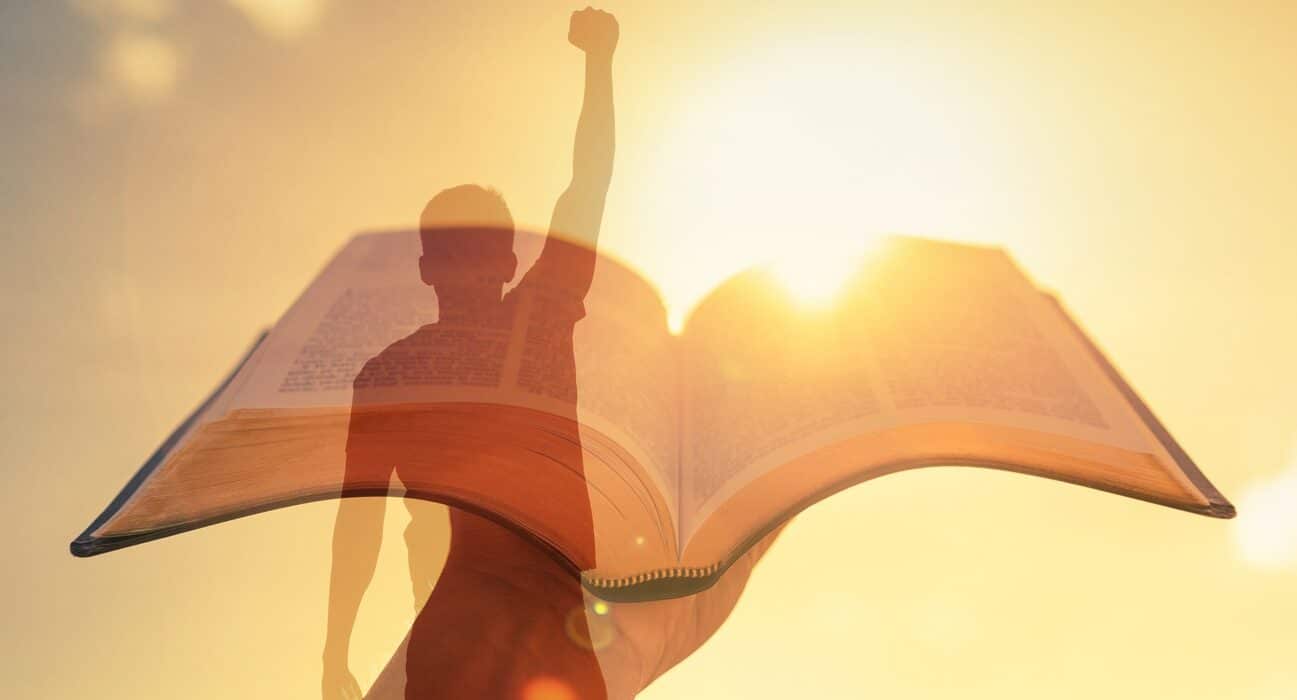Si «la guerre devient acte fondateur, l’acte premier de la tragédie», la diplomatie n’en semble désormais plus que «le reflet», et le flou entre guerre et paix, «entre guerre et politique, entre guerre et diplomatie» crée une zone grise peu propice au discernement ou à l’optimisme.
«La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens» (1).
«Nous sommes dans une guerre avec une logique du 19e siècle, où la guerre est la continuité de la diplomatie, et la diplomatie la continuité de la guerre», analyse Gil Mihaely, directeur de la publication de la revue Conflit (2) après l’intervention des États-Unis en Iran. Sans l’avouer, la formule fait étrangement écho à celle de Clausewitz, pour qui «la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens». Par «logique du 19e siècle», l’expert signifie que cette guerre semble obéir à une logique ancienne où la guerre et la diplomatie étaient étroitement liées. Bref on se bat, on débat, on se bat de nouveau pour aborder les négociations ultérieures avec le meilleur rapport de forces possible. En somme: la guerre pour négocier dans les meilleures conditions et la diplomatie pour l’arrêter ou la prolonger. En évitant à tout prix la guerre totale. Mais Mihaeli, s’il s’inspire de Clausewitz, examine en miroir la proposition et, sans toutefois approfondir sa pensée, nous laisse ainsi penser que les dynamiques contemporaines des conflits légitiment cette inversion.
Guerre et diplomatie : une dialectique complexe
C’est donc bien de la dialectique entre guerre et diplomatie dont il s’agit. Dans le contexte géopolitique actuel, dans ce contexte de guerre(s) qui est – c’est terrible à dire – le nôtre au quotidien (3), cette dialectique est très souvent convoquée, parfois sans nuances, en établissant implicitement une symétrie entre guerre et diplomatie alors que de nombreux et nouveaux facteurs semblent sinon contredire la théorie du stratège militaire prussien, du moins la rendre sérieusement révisable. Dans notre monde instable, parmi ces nombreux facteurs qui redéfinissent l’équilibre entre guerre et diplomatie, il faut noter l’évolution de ces conflits – on pense à la guerre dite hybride – et la remise en question, voire la violation, du droit international. Et si guerre et diplomatie demeurent interdépendantes, de nouveaux types de conflits complexifient leurs relations (4). Nous voudrions ici, modestement, c’est-à-dire sans appareil théorique excessif (5), proposer une réflexion sur cette interdépendance, même si parfois la diplomatie nous semble bien impuissante – sinon obsolète ! – devant la force. Hobbes l’emporte assurément sur Kant.
La guerre en prolongement de la diplomatie
En gagnant du temps pour réaliser son ambition impérialiste, la Russie a instrumentalisé des années de négociations diplomatiques (Accords de Minsk, accords «au format Normandie») pour conforter son action militaire contre l’Ukraine. Ce qui apparaît comme la conséquence d’un échec de la diplomatie, la guerre en Ukraine, débutée en 2014 (Crimée), intensifiée en 2022, en est en réalité le fruit.
Instrumentalisée, son échec apparent était le seul moyen d’imposer la guerre et de légitimer une incursion territoriale par la force. Le cas de la Chine est beaucoup plus problématique, où le discours diplomatique à propos de ce qu’elle appelle sa «souveraineté historique» accompagne des revendications territoriales sous forme d’implantation et de militarisation d’îles artificielles en mer de Chine méridionale (6). La diplomatie coïncide alors avec une guerre qui n’en est pas encore une (7), sans combats directs mais avec l’éventuel recours à des moyens coercitifs.
La diplomatie en prolongement de la guerre
Dans nos imaginaires, la diplomatie est synonyme de paix, pour éviter ou conclure un conflit. Or l’inversion de la Formule (c’est ainsi que Raymond Aron désigne la célèbre phrase du stratège prussien) prend tout son sens lorsque la diplomatie devient la continuation de la guerre par d’autres moyens. Certes, elle vise à restaurer la paix, mais elle contribue surtout à légitimer les résultats du conflit en verrouillant les gains territoriaux obtenus par la force. Ainsi la diplomatie post-conflit se pense comme le prolongement stratégique de la guerre à laquelle elle met fin tout en y contribuant. Nous pensons naïvement que la diplomatie s’inscrit contre la guerre. Alors qu’elle la prolonge en confortant les acquis du vainqueur. Par exemple les accords de Dayton (1995) dans l’ex-Yougoslavie n’ont pas mis fin à la logique ethnique du conflit, mais ont figé une répartition territoriale selon les lignes de front militaires. Dans le Haut-Karabakh (2020), le cessez-le-feu dû à la médiation russe fut favorable à l’Azerbaïdjan qui a conservé les territoires reconquis par les armes. Et que souhaite Poutine, lorsque la diplomatie entrera en scène, sinon annexer définitivement les territoires conquis en Ukraine ? Il faut en être conscient (ou le craindre, même si la victoire de l’Ukraine est indispensable): c’est par la diplomatie que toute tentative de remise en question des nouveaux équilibres risque d’être neutralisée.
La diplomatie des narratifs ou la diplomatie en guerre
Cette diplomatie est en soi une guerre. Pendant les hostilités, la bataille de la légitimité se livre sur le terrain de la diplomatie, ou chaque acteur veut imposer son interprétation du conflit. La Russie multiplie les prises de paroles et les résolutions à l’ONU. Il faut en effet justifier une «opération spéciale» dont le but serait de «dénazifier» l’Ukraine (le bataillon AZOV faisant partie des arguments) en dépit des condamnations internationales. Narratif peu crédible, version illégitime, déni de la réalité, déconstruction de l’Histoire, mais qui semble obtenir l’adhésion de certains pays, y compris en Europe, même s’ils n’y croient pas vraiment. Nous sommes acquis évidemment au narratif d’Israël qui doit cependant convaincre encore et encore que son action militaire à Gaza est la réponse légitime au terrorisme et que son combat est profondément existentiel. Relisons les deux chartes du Hamas (la seconde n’atténuant pas la première) ou la constitution de l’Iran pour savoir que le seul objectif de ce pays et de ses proxys est la disparition totale d’Israël. Mais Israël doit mobiliser ses réseaux diplomatiques et médiatiques pour lutter contre ses détracteurs antisionistes et antisémites qui font une autre lecture du conflit (8). Crédibles ou non, légitimes ou non, on constate que ces narratifs taisent ou minimisent les critiques concernant les violations des droits humains ! La diplomatie en guerre mène certes un combat symbolique, mais elle doit gagner sur la scène internationale les opinions publiques, au risque que celles-ci, partisanes, n’importent les conflits ailleurs que sur le champ de bataille (9). La diplomatie n’est pas l’antithèse de la guerre. C’est peut-être en ce sens qu’une réactualisation de la Formule serait nécessaire. La paix des diplomates devrait naître du compromis. Elle naît presque toujours d’une victoire militaire dont le narratif se développe en termes politiques.
La diplomatie dans la brutalité du monde
Le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées françaises, (protestant), constate que […]