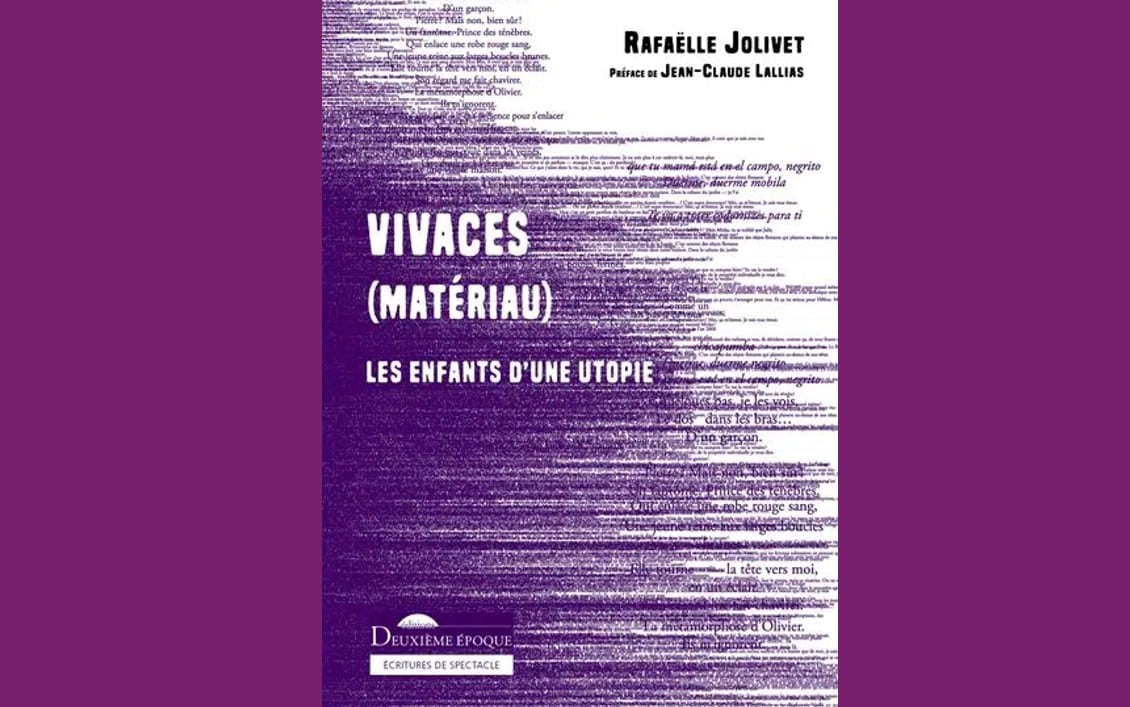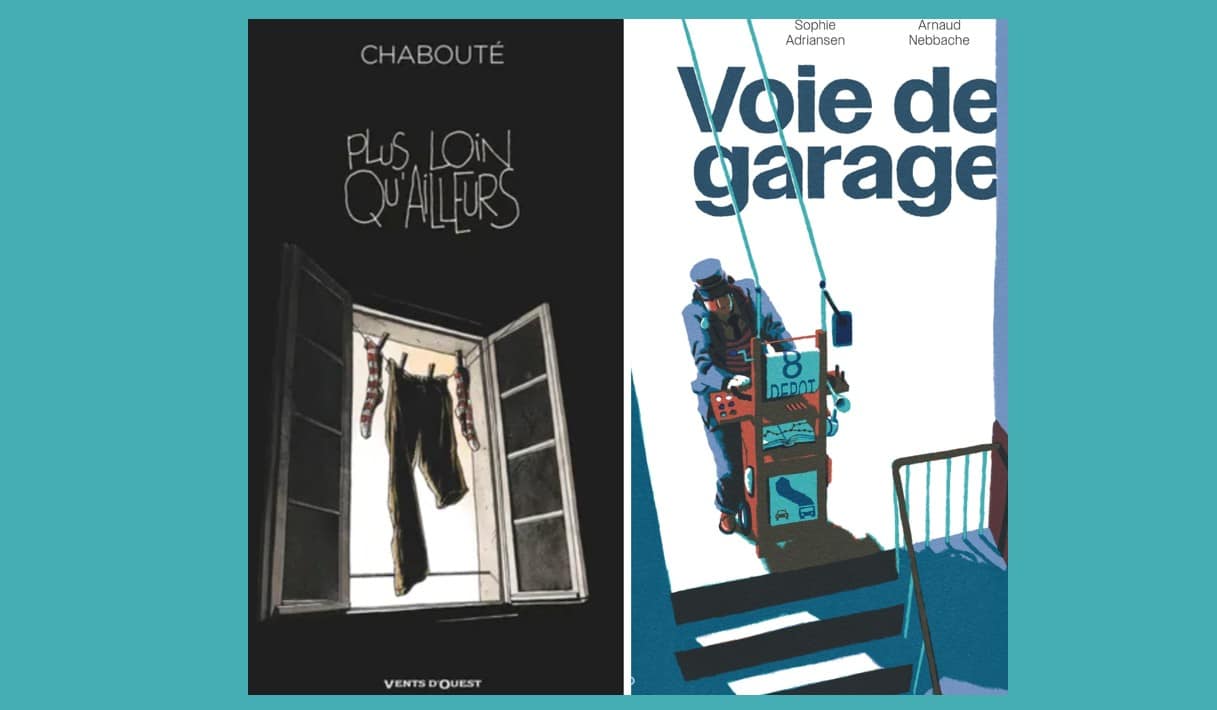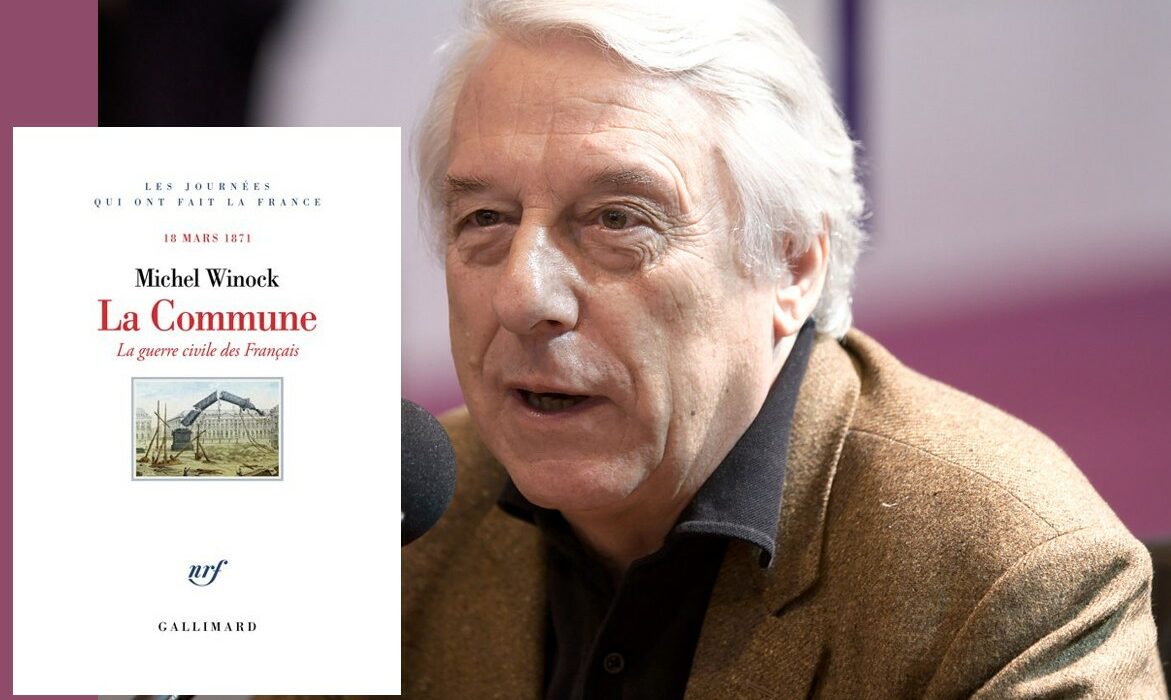Crise de confiance. C’est bien le mal profond qui affecte l’inextricable situation politique que nous vivons. Depuis plus d’un an, les députés élus le 7 juillet 2024, après la dissolution de l’Assemblée nationale, n’arrivent pas à voter la confiance aux gouvernements qui se succèdent. L’équation est pourtant des plus simples : des trois familles politiques qui composent l’Hémicycle, aucune ne dispose de la majorité absolue. Dans les démocraties classiques, dans ce cas, plusieurs groupes minoritaires discutent, mettent en avant à la fois leurs exigences et les mesures auxquelles ils peuvent renoncer pour envisager une alliance. Les discussions peuvent durer longtemps, mais l’alliance est scellée, au moins pour un temps donné, et une coalition gouvernementale peut se former. En France aujourd’hui, rien de tel. L’idée même de compromis révulse à tel point qu’elle est synonyme de vile compromission, que les électeurs de toute façon rejetteraient.
Mais les électeurs, justement, ne cessent eux-mêmes de clamer leur rejet du jeu politique. La confiance dans les députés est au plus bas et la participation s’étiole. Les élus de tout bord que nous interrogeons ci-contre (leur seul point commun est d’être protestants) en font eux-mêmes le constat, et pointent chacun le scepticisme qu’ils perçoivent chez les électeurs comme la difficulté du dialogue en politique.
Compromis mal-aimé
Quelles sont alors les racines de ce « mal français » qui affecte notre démocratie ? En protestantisme, la confiance en Dieu est première, ce qui permet de relativiser le rapport au politique, même si celui-ci est évidemment important puisqu’il permet […]