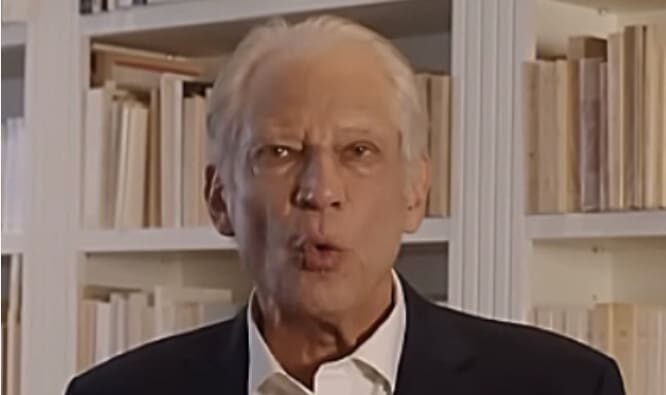Beaucoup de psychothérapeutes utilisent la classification des besoins établie par le psychologue américain Abraham Maslow (1908-1970). Cet outil simple et pratique trouve une application intéressante pour repérer les besoins qui entretiennent les motivations, telles qu’elles peuvent s’exprimer dans la sphère professionnelle.
Dans sa classification, Maslow est parti des besoins de base, pour aller vers des besoins supérieurs, à plus forte valeur ajoutée pour les humains que nous sommes. Il a imaginé une progression dans cette hiérarchie en définissant que, pour qu’un besoin soit ressenti, il faut que ceux qui le précèdent soient déjà pleinement comblés. Ainsi faut-il satisfaire nos besoins physiologiques pour accéder au besoin de sécurité, qui nous permet de ressentir le besoin d’appartenance et d’amour, lequel nous permet éventuellement d’accéder au besoin de reconnaissance, préalable nécessaire pour éprouver le besoin ultime, la réalisation de soi.
Cette hiérarchisation de nos besoins est souvent représentée sous la forme d’une pyramide, qui aide à visualiser l’importance de ces différents besoins.

Ces besoins ont leur équivalent dans le travail, et peuvent expliquer pour « quoi » nous travaillons réellement. Quel est notre moteur – ou notre motivation inconsciente ?
- Les besoins physiologiques couvrent habituellement les actions nécessaires à notre survie : manger, boire, éliminer, se reproduire…
On peut comprendre que travailler comble à l’évidence la plupart de ces besoins, puisque l’on travaille d’abord pour « gagner sa vie ». À noter que les salariés à faibles revenus, précaires ou travaillant à temps partiel ont des difficultés à « joindre les deux bouts » et sont déjà bloqués à cet étage de la pyramide. Ils sont déjà des travailleurs « à part » : impossible pour eux de se sentir en sécurité.
La remise en cause des besoins physiologiques peut se retrouver chez d’autres salariés, dont le niveau de rémunération cette fois n’est pas en cause. Ainsi, certaines personnes sont perturbées si au cours de leur journée, elles ne mangent pas à heure fixe, ou de manière équilibrée (un sandwich ou une salade, avalés sur un coin de bureau, s’avère rapidement perturbant). Il en est de même si leur journée de travail empiète sur leur temps de repos, menaçant leur potentiel de récupération et, très concrètement, leur concentration. Ils ont besoin de sommeil, de loisirs en quantité suffisante pour récupérer et se sentir bien, et supportent difficilement une longue période de surcharge.
Quid, à ce stade, de la nécessité de se reproduire ? Rappelons que ce besoin instinctif est guidé par notre désir inconscient – millénaire – de perpétuer notre espèce. A-t-il sa place au travail ? Il faut bien répondre parfois par l’affirmative, car beaucoup de nos congénères travaillent aussi pour rencontrer un partenaire ou un conjoint potentiel. Est-il besoin de rappeler que 30 % des couples français se sont rencontrés sur leur lieu de travail ?
- Le besoin de sécurité arrive ensuite. Il alimente une aspiration à la protection : avoir un toit, être au chaud, en bonne santé et avec des revenus suffisants… sont autant de conditions pour que toute personne ressente de la sécurité sur une certaine durée. Ce besoin protège de la peur du lendemain.
Le travail satisfait globalement ce besoin. Ce serait d’ailleurs sa raisons d’être. En échange de la rémunération associée à mon contrat de travail, je m’assure des conditions de vie décentes. Et ce, sur une durée d’autant plus longue que mon contrat est lui-même sécurisant – comme le très rassurant CDI. Cette sécurité m’aide à envisager l’avenir avec sérénité : acheter un appartement, faire des économies, préparer ma retraite, assurer l’avenir de mes enfants… Lorsque l’entreprise se restructure et si la menace d’une perte d’emploi plane, ce sont tous ces éléments bien établis de la vie qui peuvent être douloureusement remis en question.
- Le besoin d’appartenance (ou d’amour) nous pousse ensuite à rechercher l’intégration à un groupe : couple, famille, cercle d’amis, groupe de collègues, club sportif… Être admis nous donne la sensation d’exister. Nous ne sommes plus seuls, nous existons les uns pour les autres, ce qui favorise, de plus, une forme de solidarité. Le groupe est garant de la survie : si l’un de ses membres s’avère plus faible, le groupe peut le soutenir.
De ce fait, l’entreprise est l’une des entités sociales les plus importantes, jugée jusqu’ici comme protectrice. Appartenir à un « grand groupe » est valorisant et assure un avenir équilibré et durable. Cet idéal est celui de la génération des enfants du baby-boom, dont certains ont pu faire carrière dans la même société « jusqu’à leur retraite ». Être intégré dans un service s’avère sécurisant ; faire partie d’une équipe de collaborateurs influents est flatteur. Le groupe génère des codes admis et partagés par ses membres, assortis d’interactions bien comprises. En conséquence, le démantèlement d’un site de production, ou d’une entreprise historique ou locale, pousse souvent ses salariés à se considérer comme un seul corps pour faire face à l’adversité. Mais dès que l’éclatement renvoie chacun à son individualité, l’angoisse se fait encore plus grande, et les possibilités de s’en sortir semblent s’amenuiser. La dépersonnalisation sociale s’ajoute à l’angoisse du chômage.
- Le besoin de reconnaissance quant à lui nous incite à susciter l’estime des autres, pour ressentir l’estime de soi. Cette considération est une quête d’identité. Au travail, la reconnaissance passe par la fonction, associée à une rémunération ou ses corollaires (primes, actions, participations…). La reconnaissance doit donc normalement s’exprimer consécutivement aux résultats que nous obtenons, en fonction de la mission qui nous a été confiée. Elle serait donc objective, car mesurable. Ce point est d’autant plus délicat pour les professions confrontées à des objectifs inatteignables ou flous ou difficilement mesurables, voire carrément invisibles. D’autres attributs plus subjectifs entrent en ligne de compte pour apprécier si nous sommes reconnus dans notre travail : bureau individuel, voiture de fonction, proximité avec la direction, moyens pour travailler (techniques et humains), place dans l’organigramme…
La reconnaissance a aussi besoin d’être explicitement formulée : encouragements, félicitations, mise en avant devant les collègues, promotion, augmentation… Beaucoup de salariés sont en quête de ces valorisations pour pouvoir eux-mêmes apprécier favorablement ce qu’ils font. Un salarié mal considéré peut se sentir littéralement dégradé, à la manière du capitaine Dreyfus – non pas en arrachant ses insignes, mais en le dépossédant des attributs de sa fonction : secrétaire, voiture de fonction, titre, bureau, ordinateur portable, avantages, accès à certaines réunions… D’ailleurs la « placardisation » – phénomène qui consiste à isoler un salarié sans lui confier aucune tâche, alors même que sa fonction et son salaire sont maintenus – est l’une des dégradations les plus mal vécues. Cette action délibérée vise à faire partir l’inopportun, en jouant sur la lassitude née de l’ennui, voire de la honte. Aucun salarié ne vivra comme une aubaine le fait d’être payé à ne rien faire. Il intégrera douloureusement cet état de fait, comme une profonde et implacable humiliation.
- Enfin, le besoin de réalisation de soi nous invite à nous dépasser pour accomplir quelque chose et nous épanouir. Tout salarié vise sans doute secrètement ce but ultime : accéder à de hautes fonctions, marquer son travail de sa patte, laisser une trace dans son entreprise ou son métier, sortir du lot, être envié, être considéré non pas pour son poste mais pour ce qu’il est… On dit du travail qu’il offre un « ascenseur social » – un moyen de s’élever dans la société –, notamment pour les personnes nées dans des milieux dits défavorisés, ou privées de la possibilité de faire des études. C’est une source de fierté.
Au-delà du statut social, ce besoin supérieur rejoint parfois une quête de sens : travailler en exprimant ses valeurs personnelles, défendre ses idées – si ce n’est un idéal –, participer à l’amélioration de la vie des autres, être associé à une grande ou noble cause… Tous les métiers ne permettent pas cette satisfaction sur le sens, mais l’ambition permet dans n’importe quelle profession de s’élever, de progresser, de faire carrière, sans doute pour avoir la sensation de dominer le groupe. Dès lors, le besoin de réalisation rejoint-il celui de commander, de diriger les autres ?
Chacun d’entre nous se retrouve dans ces différents besoins, qui sont autant d’objectifs qui nourrissent les attentes vis-à-vis du travail – et dans le même temps les potentielles frustrations. Il est facile de voir qu’en un siècle, les attentes ont considérablement progressé. Tout salarié s’estime aujourd’hui potentiellement capable de combler tous ses besoins, ce qui n’était sans doute pas l’espoir d’un ouvrier peu qualifié de jadis. Ces attentes sont-elles pour autant réalistes – ou constituent-elles une utopie ?
Et vous, pour « quoi » travaillez-vous ?