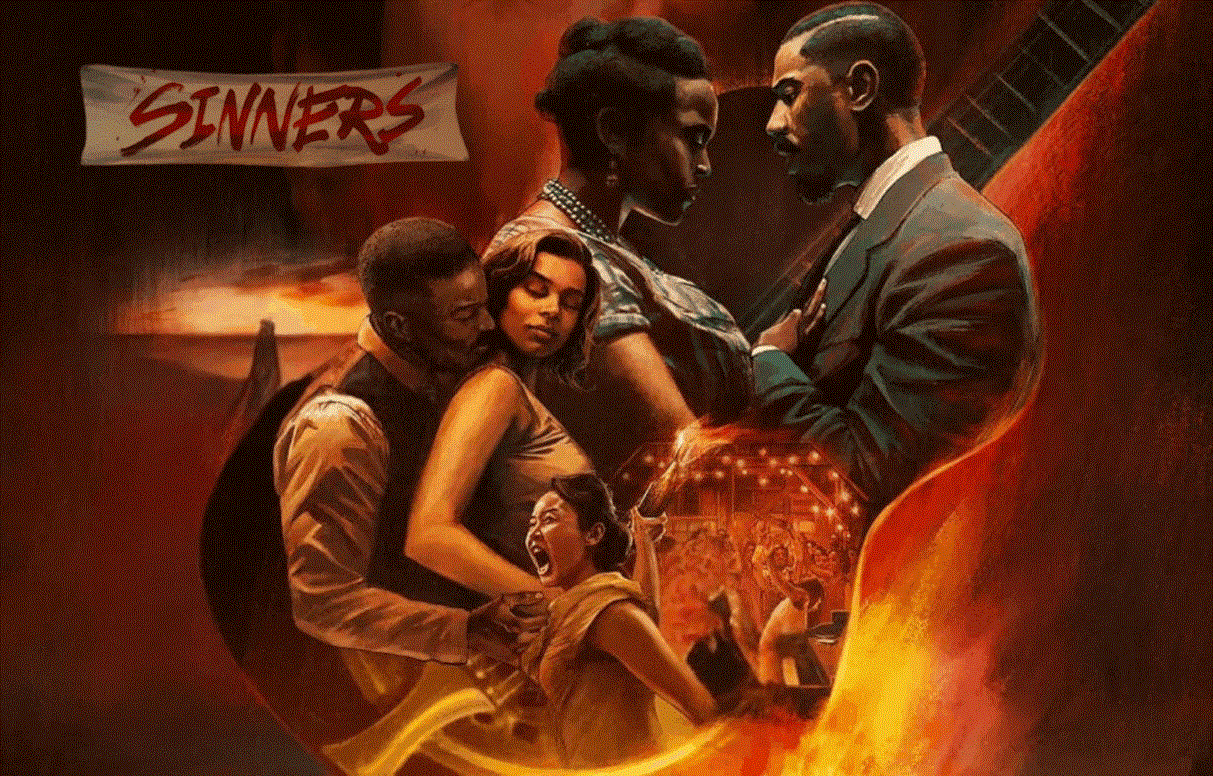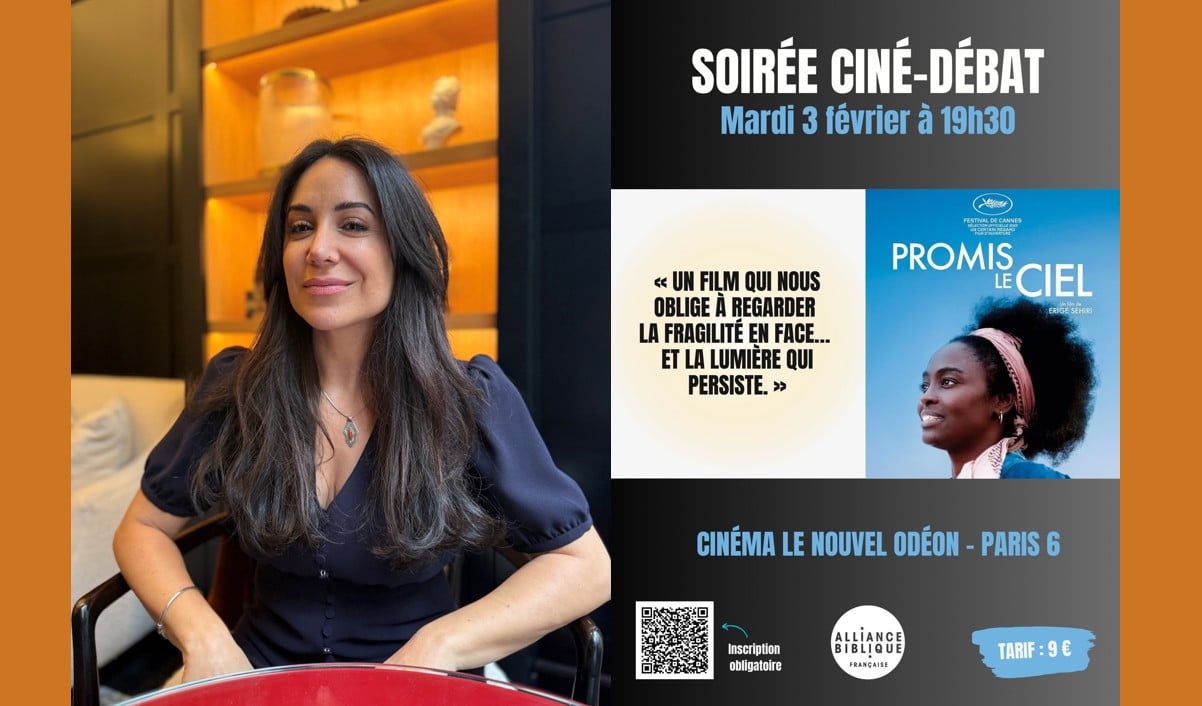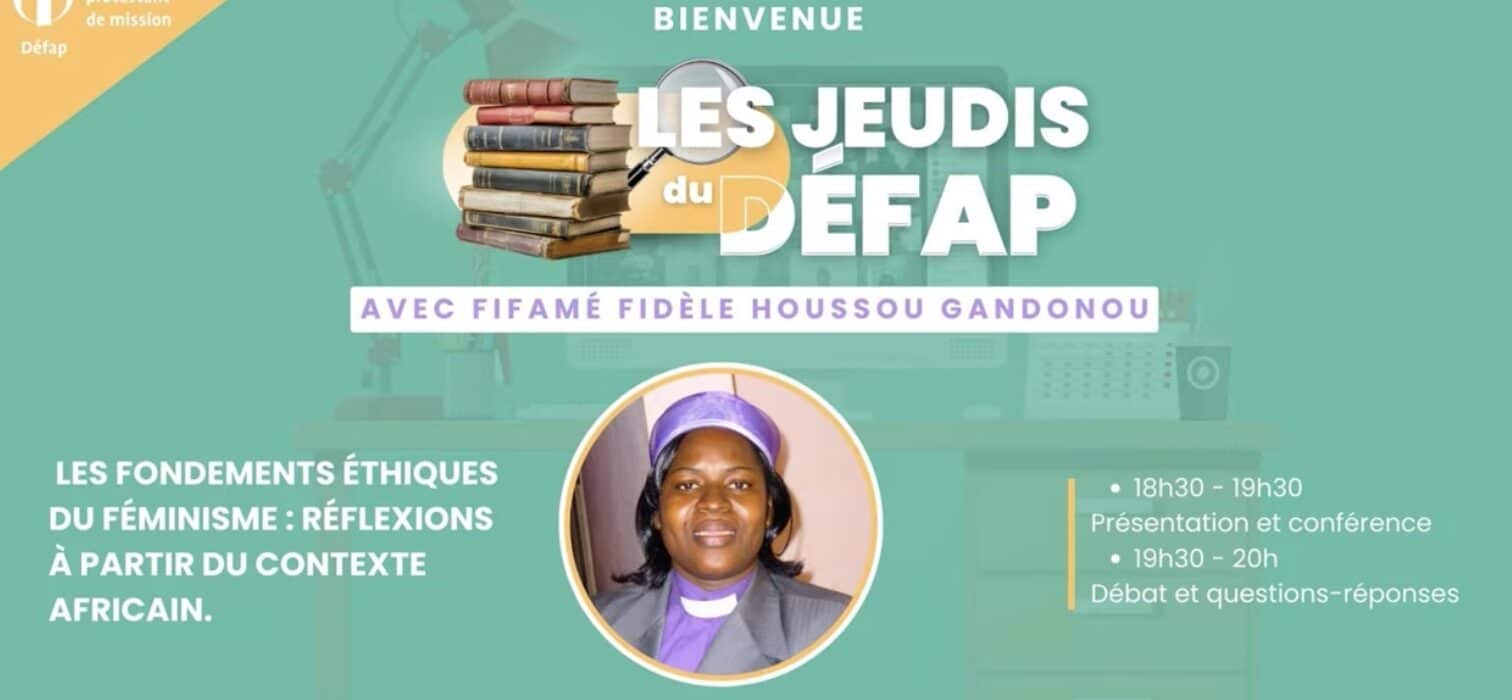Sur un coup de tête, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude, il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Elise qui elle aussi vient de tout quitter, ils se voient confier un troupeau de 800 moutons et s’engagent dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle
Une quête de sens au cœur des montagnes
Mathyas, jeune publicitaire québécois, quitte tout : sa vie urbaine, son métier lucratif, son confort. On le retrouve dès les premières images dans un petit hôtel du sud de la France, au moment précis où il enregistre sa démission. Sa décision est prise. Inspiré du roman autofictif D’où viens-tu, berger ? de Mathyas Lefebure, le film choisit de commencer là où d’autres se seraient arrêtés : après la crise, dans l’élan du recommencement.
Avec ce point de départ audacieux, Sophie Deraspe évite les lourdeurs psychologiques et nous plonge immédiatement dans le concret : les livres de pastoralisme que dévore Mathyas, les gestes qu’il apprend sur le terrain, les doutes et la fatigue, les rencontres avec ceux qui vivent réellement de la terre.

Un réalisme sans folklore
Le film est découpé en trois étapes claires – trois « maîtres » de la vie rurale, trois saisons de l’âme : un stage chez un éleveur rude et brutal, un autre auprès d’une bergère bienveillante, puis la mise à l’épreuve dans les hauteurs, lors de la transhumance. À chaque phase, la mise en scène épouse le rythme de la nature et celui du cœur humain.
La direction photo de Vincent Gonneville sublime les paysages sans jamais les esthétiser à outrance. Chaque plan a du sens. La montagne n’est pas un décor, mais une partenaire, parfois complice, parfois menaçante. Elle enseigne, façonne, éprouve.

De la solitude à la solidarité
L’arrivée d’Élise, une jeune fonctionnaire française fascinée par la démarche de Mathyas, vient bouleverser l’équilibre. Le film, initialement centré sur un parcours individuel, devient peu à peu un récit à deux voix. Le changement de titre – de Berger à Bergers – souligne cette évolution vers une aventure partagée. Solène Rigot et Félix-Antoine Duval forment un duo d’une grande justesse. Sans emphase, sans pathos, ils incarnent deux êtres qui se cherchent, s’inspirent, s’apprennent, et construisent ensemble une autre manière d’habiter le monde.

Une résonance biblique discrète mais puissante
Pour un regard chrétien, le film résonne en profondeur. Comment ne pas penser à Abraham quittant son pays, à Moïse guidant les troupeaux dans le désert, ou (à l’inverse de Mathyas) à David, berger choisi par Dieu pour devenir roi ? Dans la Bible, le désert et la montagne sont des lieux de dépouillement, mais aussi d’appel et de transformation. Ici, Bergers devient une parabole moderne : celle de femmes et d’hommes qui, face au vacarme du monde, cherchent une autre voie – plus simple, plus humble, mais non moins exigeante. L’image du berger, au cœur de l’Écriture, est aussi celle du soin, de la vigilance, de la patience. Elle renvoie bien sûr au Christ lui-même, le bon berger (Jean 10). Elle fait résonnance avec le Psaume 23… même si (sans dévoiler une part du récit) la protection proposée par le berger n’est pas si idéale. Le film, sans travailler concrètement cette approche, en offre possiblement une interprétation contemporaine, incarnée, profondément humaine.

Une œuvre qui questionne sans imposer
Avec Bergers, Sophie Deraspe livre un film rare et touchant. Elle signe une œuvre de beauté, d’écoute, de lenteur assumée, qui invite à reconsidérer nos priorités et notre rapport au vivant. Dans un monde qui valorise la productivité et la vitesse, ce film rappelle la valeur du pas lent, du silence, et de la fidélité à une vocation intérieure. Et pour celles et ceux qui croient, il ouvre un espace de méditation sur l’appel, le service, et la simplicité du Royaume.