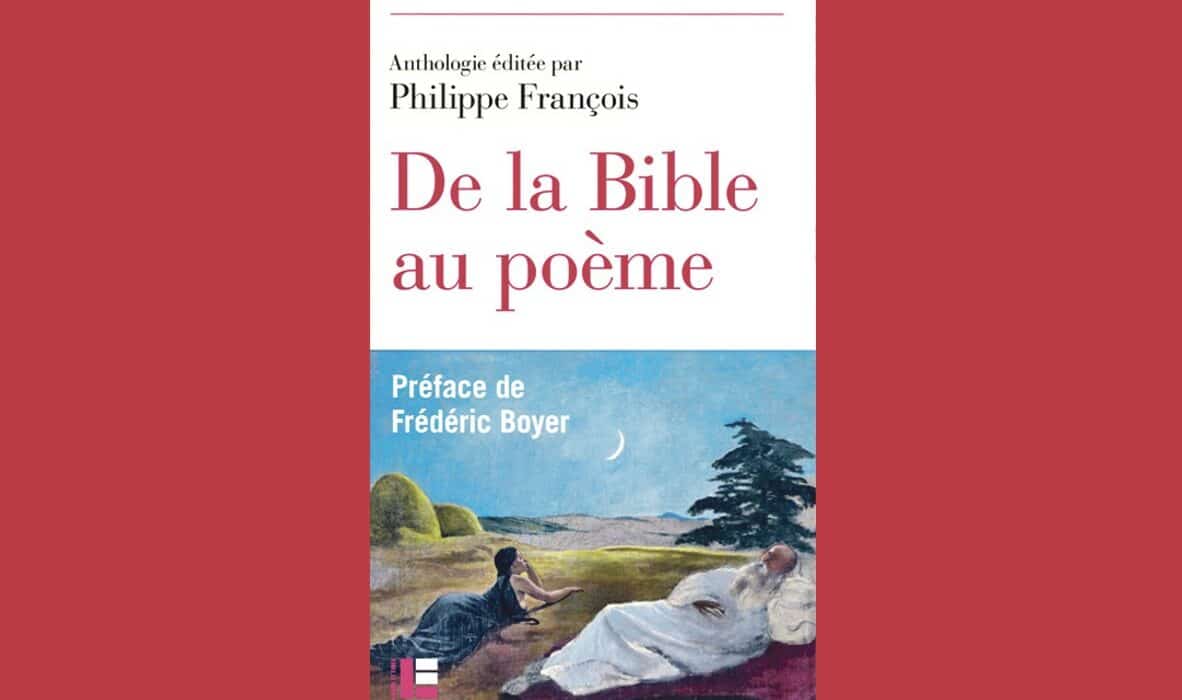La série impressionne par son élégance, sa mise en scène et l’intensité émotionnelle qui se dégage de chaque scène.
Basée sur un roman de Walter Tevis datant de 1983, la série – dont les sept épisodes sont intitulés en fonction de phases ou de coups d’une partie d’échecs – suit l’histoire de Beth Harmon, dans les années 50 et 60, jeune femme passionnée d’échecs qui tente de se faire une place dans le monde ultra-masculin de ce jeu de stratégie. Mieux, elle veut être la meilleure joueuse du monde, rien que ça. Pendant sept épisodes, nous allons suivre son ascension depuis l’âge de ses 8 ans jusqu’à ses 22 ans. Quinze années de lutte incroyable et parfois désespérée pour réaliser son rêve.
La série de Scott Frank, scénariste de plusieurs blockbusters comme Minority Report ou Logan et réalisateur notamment de deux excellentes séries, Shameless et surtout Godless (également scénariste et producteur), est à la fois un récit initiatique, une série d’époque et une étude psychologique entre génie et psychose.
Saviez-vous qu’une partie d’échecs peut durer si longtemps qu’elle peut être ajournée ? Le joueur dont c’est le tour enregistre son prochain coup dans une enveloppe scellée de sorte que lorsque les deux adversaires se retrouvent, ils peuvent procéder comme si le jeu n’avait pas été interrompu. Mais ce n’est là qu’un infime détail des échecs révélé au téléspectateur profane dans Le jeu de la dame sur Netflix. Mais rassurez-vous, si vous n’y connaissez rien, ce n’est pas grave du tout car la trame du film n’est pas dans l’apprentissage du jeu mais bien dans le parcours singulier de Beth Harmon.
Sans plus attendre, il faut le dire : Anaya Taylor-Joy (The Witch, Peaky Blinders, Split, Glass, Radioactive…) jouant le rôle de Beth de 13 à 22 ans dans une métamorphose apparemment sans effort, brille autant que son personnage est exceptionnelle. La comédienne est totalement magnétique. Mais comme souvent quand une série ou un film est aussi bien réussi, c’est l’ensemble de la distribution qui est à applaudir. Comme un jeu de pièces d’échecs délicieusement sculpté, chaque personnage vient enrichir le parcours personnel et professionnel de Beth et la qualité d’ensemble du show. Bill Camp (Jason Bourne, Twelve Years of Slave) se distingue en tant qu’homme à tout-faire de l’orphelinat, M. Shaibel, qui initiera Beth à l’échiquier. Et puis on trouve d’anciens enfants stars comme Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones), dans le rôle de Benny, ou Harry Melling (Harry Potter) dans le rôle plus sensible de Harry Beltik. J’ajouterai Moses Ingram, qui interprète Jolene l’amie fidèle de jeunesse et évidemment Marielle Heller, la mère adoptive de Beth, une femme au foyer des années 60 dont les impulsions créatives sont étouffées par ses obligations de mère au foyer abandonnée par son mari, représentant le genre de futur que Beth souhaite ardemment éviter. Il faut aussi ajouter Annabeth Kelly et Isla Johnston, qui jouent des versions plus jeunes de Beth, notamment Johnston, qui porte le premier épisode, où Beth, neuf ans, découvre son affinité pour les échecs et son penchant pour les tranquillisants que lui dispense l’orphelinat où elle est vit après le suicide de sa mère.
D’un point de vue des thématiques abordées, même si l’aspect visuel est peut-être le choc premier, il y a une vraie profondeur et une grande diversité au cœur même du scénario. C’est la question de l’abandon qui revient de nombreuses fois et sous diverses formes, avec les conséquences psychologiques qui en découlent… la notion de transmission, d’amitié, de différence, de lutte contre certains marqueurs sociétaux. Ainsi, bien que Beth elle-même devienne, en quelques sortes, un modèle pour les autres femmes, elle est totalement frustrée par la dimension de genre. Pour son époque, elle est considérée comme exceptionnelle parce qu’elle est une fille qui bat les hommes aux échecs ; pourtant, elle préfère être exceptionnelle, point final. Mais en même temps, Le jeu de la dame n’est pas l’histoire d’une femme qui surmonte les obstacles pour montrer au monde son « girl power » ; c’est l’histoire d’une femme qui surmonte les obstacles pour se découvrir et se comprendre elle-même. Et puis, ajoutez à cela son addiction croissante aux anxiolytiques, et à l’alcool (initiée ici par sa mère adoptive elle même dépendante), pour développer là encore d’autres sujets autour de la dépendance, avec la qualité de ne pas tomber dans la facilité ou un manichéisme simpliste.
Et puis, quand même, il y a l’échiquier au centre de cette série. Et quel travail remarquable là encore ! Tout comme il démystifie la structure d’une partie d’échecs, Le jeu de la dame prend également grand soin de dramatiser, de manière incroyablement engageante, le jeu lui-même. Le téléspectateur ne pourra pas nécessairement suivre tous les mouvements, mais le déroulement et le récit de chaque partie sont parfaitement clairs et impressionnants. L’imagination avec laquelle Frank présente les scènes, en utilisant toutes sortes de techniques (y compris une excellente utilisation de l’écran partagé) pour s’assurer que chaque partie est nettement différente de la précédente, est extrêmement bien vue, évitant de se lasser sur la partie jeu de la série. Elle offre même la possibilité d’en faire des moments clés de l’histoire. La cinématographie est aussi franchement superbe, en particulier le motif visuel récurrent de Beth qui montre un échiquier dans l’ombre au plafond de sa chambre, les pièces fantomatiques clignotant dans et hors de la réalité alors qu’elle s’entraîne à anticiper les mouvements.
Le jeu de la dame est une série rare, une vraie pépite captivante et pour moi un énorme coup de cœur, qui peut rendre avec précision une forme particulière de génie sans aliéner les spectateurs. Beth lutte contre sa dépendance et contre les systèmes dans lesquels elle a été placée comme une sorte de pion impuissant. Son histoire nous rappelle aussi, que même si l’on devient la reine, il ne sert à rien de se tenir seul sur un échiquier vide ; on n’est rien sans le reste du décor !