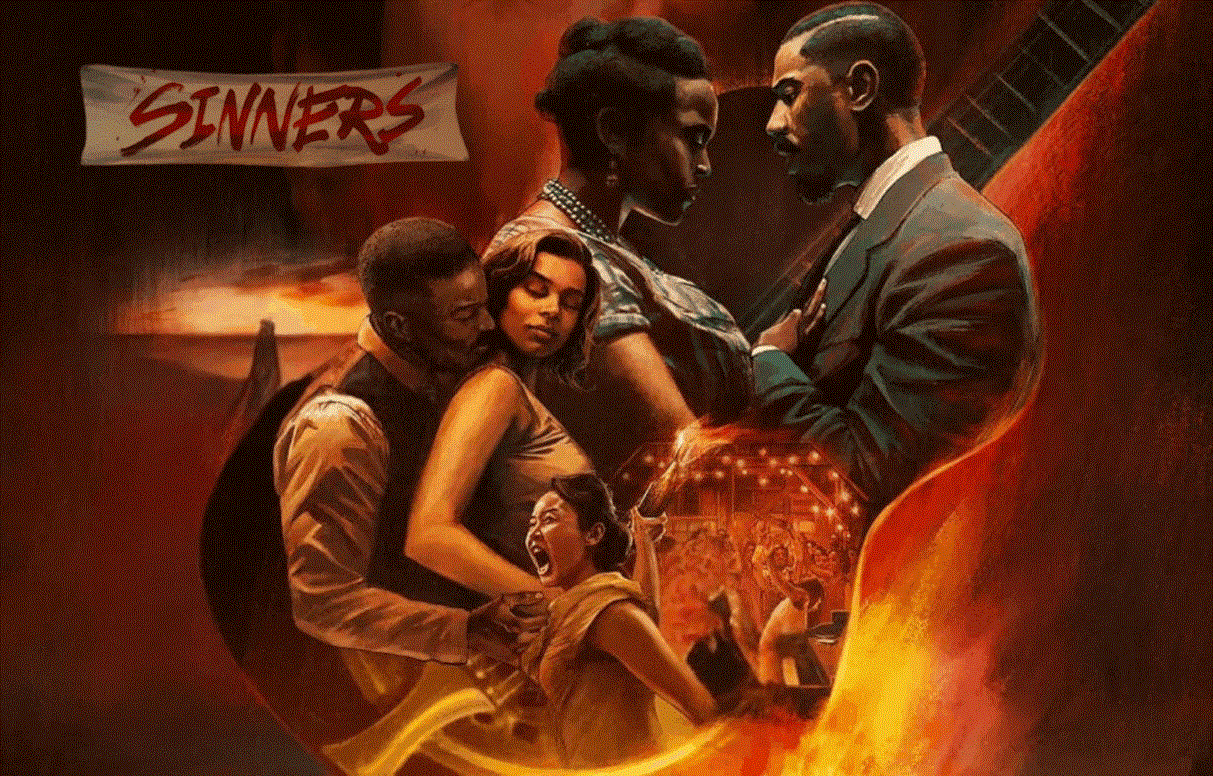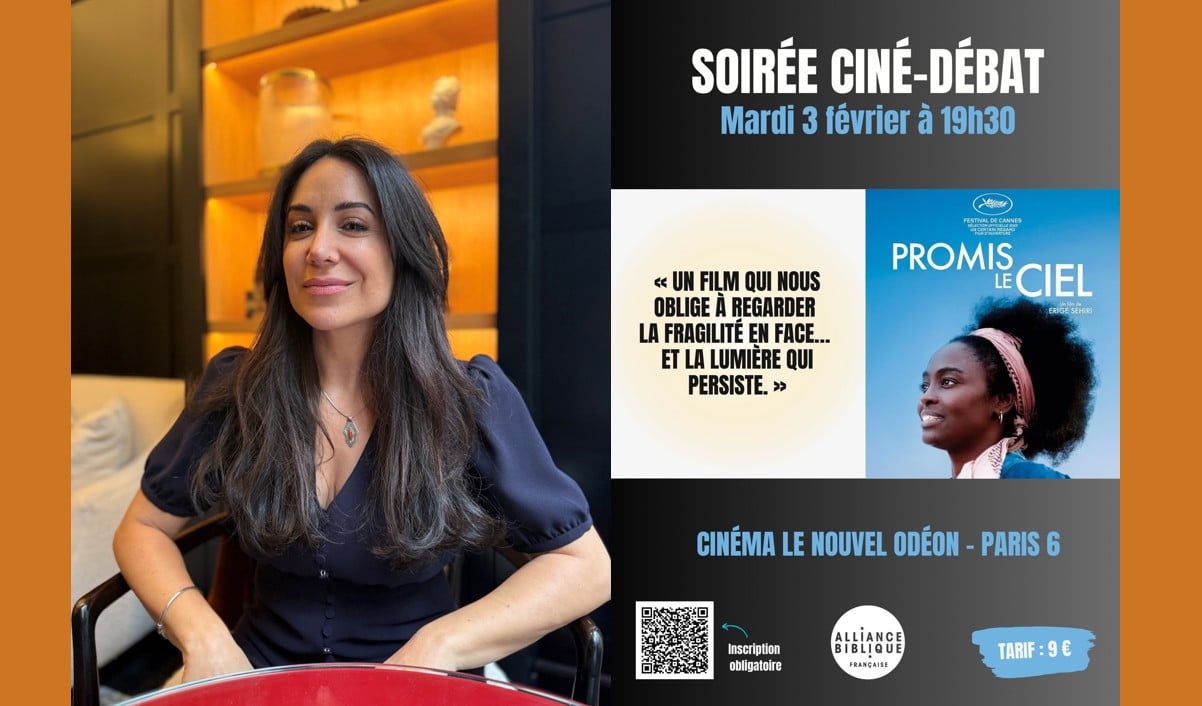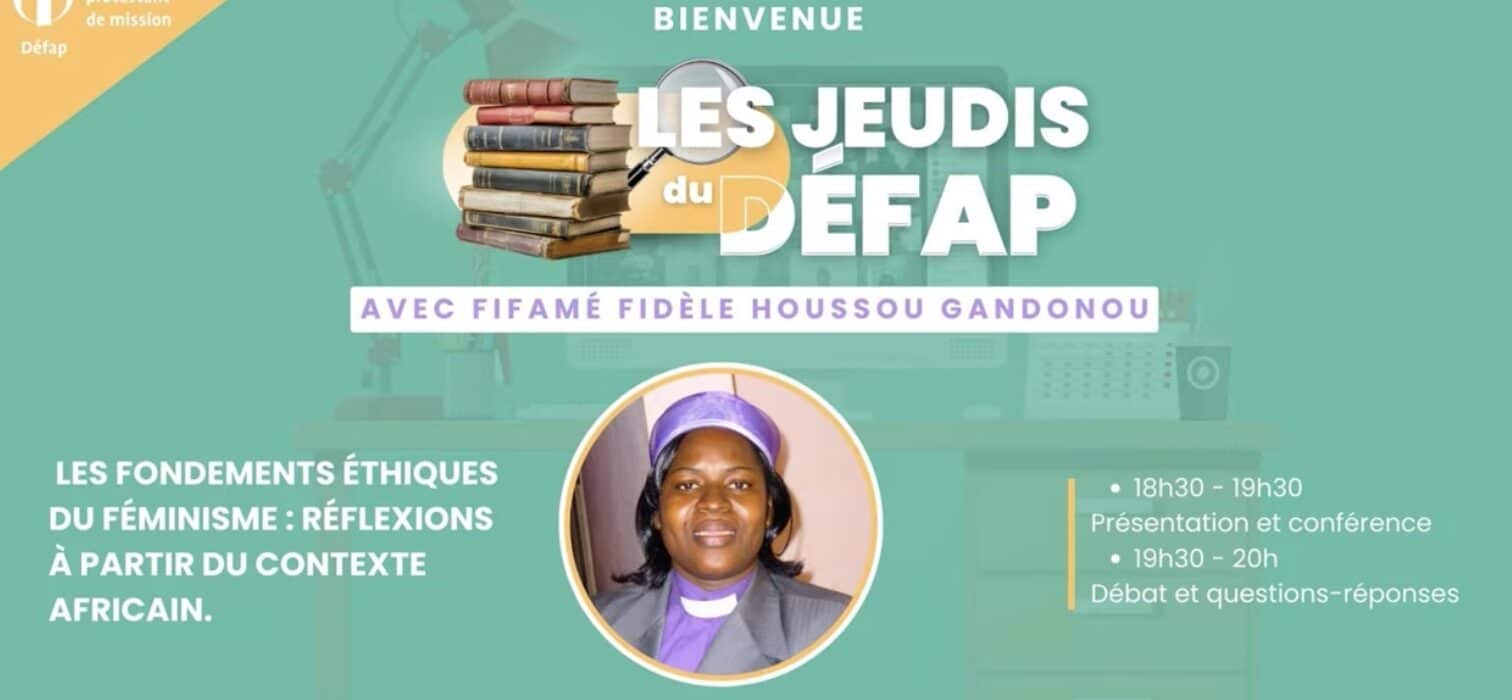Lire Lolita à Téhéran, réalisé par Eran Riklis, est l’adaptation cinématographique des mémoires éponymes d’Azar Nafisi, universitaire iranienne. D’une richesse infinie, tragique mais aussi parfois drôle et souvent héroïque, Lire Lolita à Téhéran nous fait partager le quotidien de ces femmes iraniennes au cœur de la République islamique.
Azar Nafisi (Golshifteh Farahani), professeure à l’université de Téhéran, réunit secrètement sept de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Pour elles, lire Lolita à Téhéran, c’est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature.
Des œuvres littéraires jugées « décadentes »
Après la révolution islamique de 1979, le régime des mollahs impose une censure stricte sur les œuvres culturelles jugées « décadentes », incluant la littérature occidentale. Dans cette atmosphère étouffante, Azaz Nafisi, privée de son poste à l’université, crée un cercle clandestin de lecture chez elle. Elle réunit sept de ses anciennes étudiantes pour explorer des romans interdits, tels que Lolita de Vladimir Nabokov, Orgueil et Préjugés de Jane Austen ou Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Cet espace intime, où la parole et la réflexion restent libres, devient un sanctuaire pour ces femmes, une échappatoire face à la répression grandissante.

Le film de Riklis parvient à capturer cette dualité, ce contraste entre l’oppression extérieure et la liberté intérieure offerte par la littérature. Dans un Iran où les femmes sont réduites à des rôles strictement définis, la lecture, en particulier celle d’œuvres occidentales, devient un acte subversif. Les livres, méticuleusement choisis par Nafisi, permettent à ses étudiantes de redécouvrir leur individualité et leur désir de liberté. Lolita, en particulier, soulève des questions sur le pouvoir, la domination et le consentement, résonnant particulièrement avec leur situation de femmes dans une société patriarcale.
La performance de Golshifteh Farahani
Le jeu de l’emblématique comédienne iranienne Golshifteh Farahani, qui incarne Azar Nafisi, est particulièrement bouleversant. Voix emblématique de l’émancipation des femmes en Iran, le rôle d’Azar lui va naturellement à merveille. En s’appuyant certainement intérieurement sur sa propre expérience, l’actrice parvient à faire ressentir la douleur de voir son pays sombrer dans l’obscurantisme tout en offrant une force calme, presque stoïque, face à la répression. Ses yeux transmettent une profondeur intérieure, celle de quelqu’un qui, malgré les privations extérieures, conserve intacte une liberté d’esprit. Les étudiantes, chacune avec son propre parcours et ses propres blessures, sont incarnées avec justesse, offrant un portrait de la diversité des expériences féminines sous un régime dictatorial.
Redonner vie à des mots interdits
Mais le cœur du film réside dans l’acte même de lire, de redonner vie à des mots interdits. La mise en scène de Riklis privilégie une sobriété qui rend les scènes de lecture clandestine d’autant plus puissantes. Le réalisateur évite l’excès dramatique, laissant les textes eux-mêmes et les réactions des personnages leur donner toute leur intensité. Ces lectures, faites-en secret, dans une pièce close, deviennent une forme de prière laïque, une élévation des âmes au-dessus des interdits terrestres.
Chaque lecture est un acte de résistance, mais aussi un moment de communion, où ces femmes se lient entre elles à travers les idées et les rêves que leur offrent les auteurs qu’elles étudient.
Un film qui fait écho à la foi chrétienne
D’un point de vue spirituel, cette quête de liberté intérieure face à l’oppression trouve bien sûr des échos dans les valeurs de la foi chrétienne. La Bible elle-même est un texte où la parole, bien souvent bannie ou combattue par les puissants, s’érige en symbole de libération.
L’apôtre Paul, dans ses lettres aux Éphésiens ou aux Galates, rappelle l’importance de la liberté en Christ : une liberté qui ne dépend pas des chaînes visibles ou des lois humaines, mais d’une émancipation intérieure, un refus de se laisser captiver par le mal ou l’injustice. Dans le contexte du film, ces femmes qui s’accrochent à la littérature, en dépit des interdits extérieurs, incarnent une lutte spirituelle proche de celle du croyant : celle de rester fidèle à sa foi, à ses valeurs et à sa dignité, même lorsque le monde semble vouloir les nier. La lecture devient alors plus qu’un simple acte intellectuel : elle devient un témoignage, une foi en la capacité de l’esprit humain à transcender les oppressions matérielles.

Le film illustre également le danger des idéologies totalitaires qui prétendent détenir la vérité absolue et imposent un modèle unique de pensée et de comportement. Lire Lolita à Téhéran montre que toute censure, toute tentative d’étouffer la diversité des idées, est une atteinte à la dignité humaine et à sa relation directe avec la vérité. Les femmes du cercle de Nafisi ne cherchent pas seulement à lire des romans : elles cherchent à se reconnecter à leur humanité, à leur capacité à réfléchir, à aimer, à rêver, à résister face aux épreuves diverses que chacune rencontre. Dans ce sens, le film devient une parabole moderne de la lutte pour l’autonomie spirituelle.
La résistance par la culture
Sur le plan cinématographique, Eran Riklis parvient à maintenir une tension subtile tout au long du film, jouant sur les non-dits, sur les regards furtifs et les silences lourds de sens. Les scènes de rue, où les femmes doivent se cacher sous leur tchador et baisser les yeux, contrastent avec la liberté qu’elles éprouvent dans la clandestinité de leur lecture. Cette opposition entre les espaces clos et les espaces publics devient une métaphore puissante de la double vie que doivent mener ces femmes : un visage conforme aux attentes du régime, et une âme en lutte pour son émancipation. Lire Lolita à Téhéran est une belle réflexion profonde sur la liberté intérieure et la résistance par la culture.
En nous plongeant dans l’histoire de ces femmes courageuses, le film nous interroge sur notre propre rapport à la liberté, à la foi et à la vérité.
Comment continuons-nous à résister face aux idéologies oppressives, qu’elles soient politiques, religieuses ou culturelles ? Et surtout, comment nourrissons-nous notre âme, quand tout autour semble vouloir l’éteindre ?