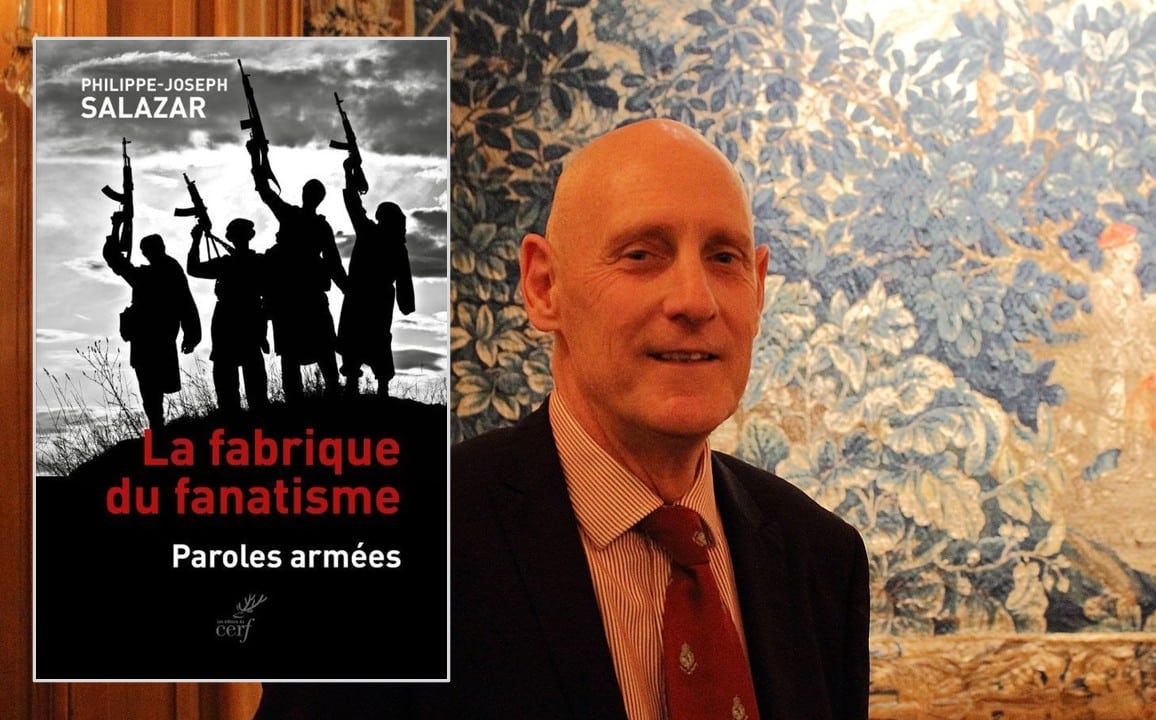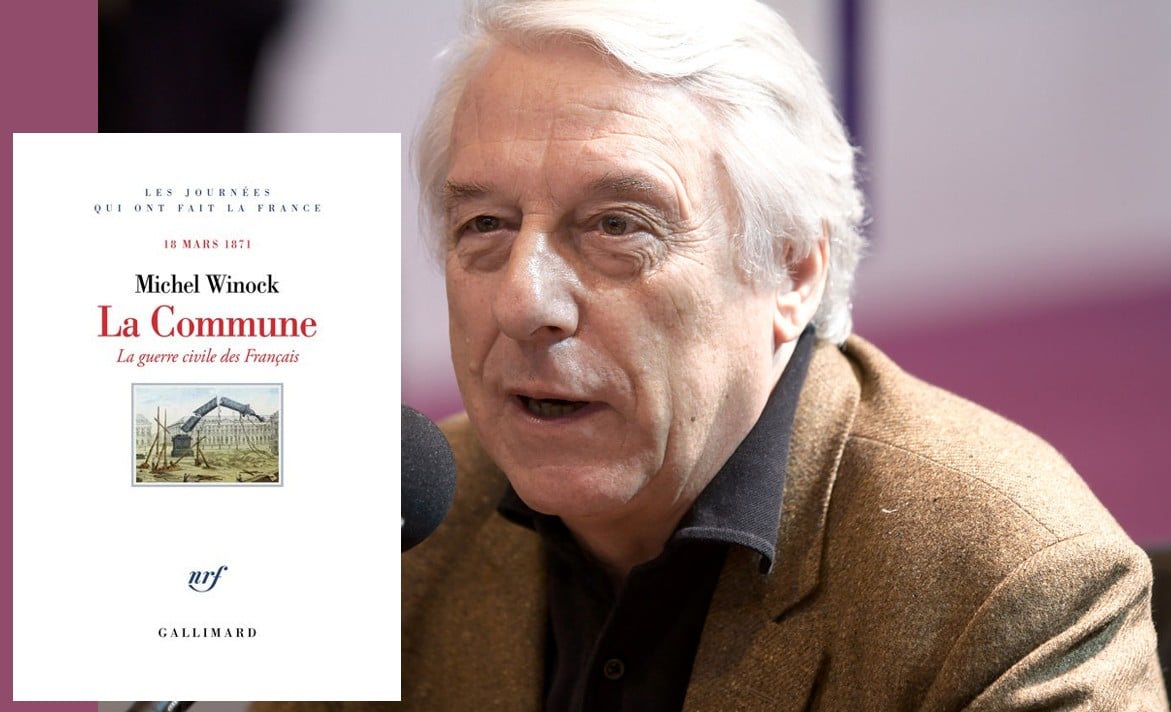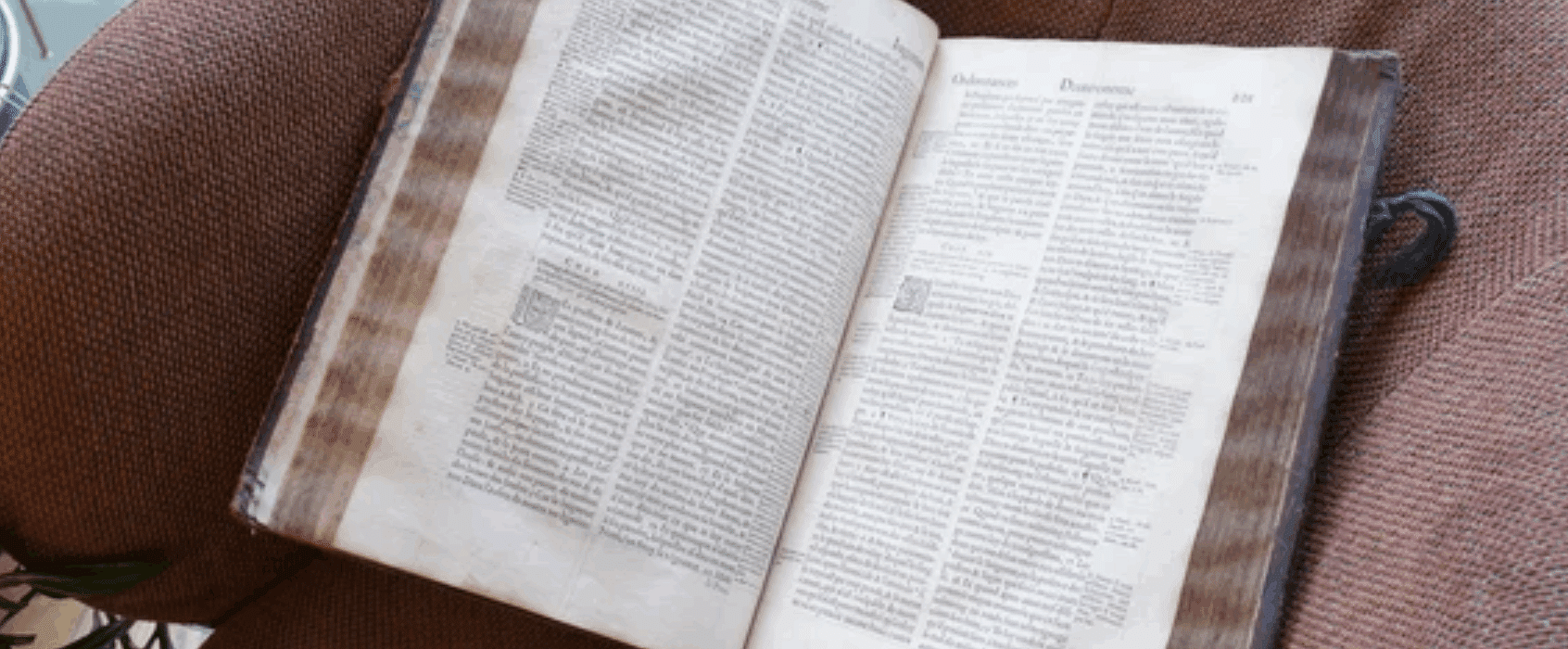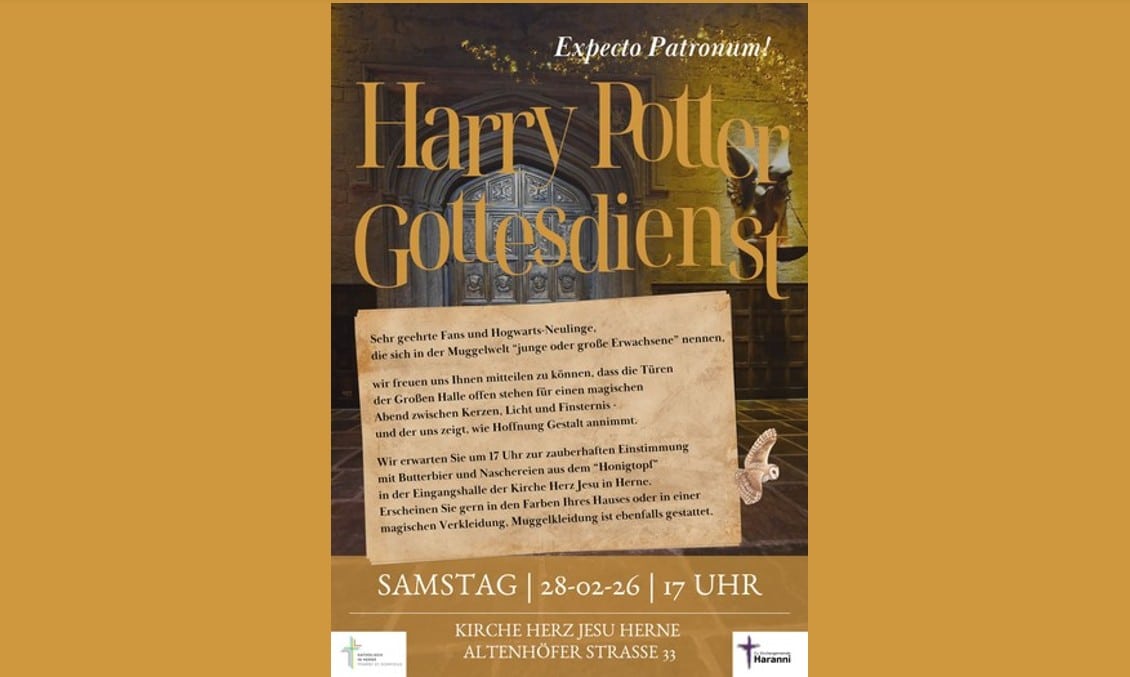La vista d’Edgar Morin ne date pas d’hier. En baptisant « Yéyés » les chanteuses et chanteurs promus par les maisons de disques et les toutes fraîches radios périphériques au début des années soixante, notre actuel centenaire avait souligné tout à la fois l’énergie dont ils étaient porteurs et le vide sidéral des textes qu’ils donnaient à entendre. C’est précisément sur ces deux points que Françoise Hardy, qui vient de mourir à l’âge de quatre-vingts ans, se distinguait.
Bougeant peu, souriant d’un air mélancolique, elle faisait comprendre qu’elle avait bien d’autres choses à raconter que des banalités. Certes, elle était devenue célèbre grâce à une ballade on ne peut plus niaise, « Tous les garçons et les filles » – encore faudrait-il entamer le débat pour savoir à partir de combien de quarante cinq tours vendus la scie musicale devient une référence. Mais elle avait su très vite évoluer, portée par un tempérament tourmenté qui s’accommodait bien de l’abandon de la foi dans le progrès des années soixante-dix.
Le retrait et la timidité, mais une véritable présence
Françoise Hardy affichait une présence paradoxale. Jouant constamment du retrait, de l’absence, de la timidité – n’oublions pas qu’après un passage fantomatique, elle a toujours refusé de se produire sur scène – la chanteuse affirmait dans le même temps une personnalité véritable, puisqu’en trente secondes on la reconnaissait.
Guidée par un sens très sûr de sa carrière, avec beaucoup d’intelligence, l’artiste a su solliciter des musiciens, des paroliers talentueux sans jamais devenir leur prisonnière, incarner la modernité sans jamais passer pour superficielle.
On citera bien entendu Serge Gainsbourg – qui fut pour elle sans doute un peu plus qu’un compagnon de route : une source d’inspiration tactique au pays des chausse-trapes, un bon capteur des mouvements de mode ; Michel Berger qui produisit son album « Message Personnel », et même Serge Moustaki, avec lequel un duo charmant fut enregistré.
Un habillage musical de haute couture
Mais on ne manquera pas de rappeler que Françoise Hardy écrivit ses propres textes – elle en conçut pour Julien Clerc : « Mon ange » et « Fais-moi une place ». Enfin, parce que la chanson demeure collective, on soulignera le rôle essentiel des orchestrateurs-arrangeurs qui surent concevoir pour elle un habillage musical que l’on qualifiera – Jean Paulhan ne disait-il pas qu’on ne fait pas de bonne littérature sans cliché ? – de haute couture : Jean-Claude Vannier, Michel Bernholc, Gabriel Yared.
Nous pourrions dire encore que Françoise Hardy pratiquait la transgression comme un art martial. Ne cachant pas que ses opinions politiques la portait à droite, alors que nombre de ses consœurs et confrères passaient ou passent d’un camp à l’autre, au gré du vent, ou cachent leur ancrage de peur d’être stigmatisés, elle s’était offert le luxe d’animer des émissions de radio portant sur l’astrologie sans passer pour une farfelue, ce qui relève de la prouesse.
Une trace dans la mémoire collective
Comme toujours quand une chanteuse ou un chanteur vient à disparaître, l’émotion qui saisit nos concitoyens révèle un changement de génération. Dans quelques jours ou quelques semaines, Françoise Hardy trouvera sa place dans la mémoire collective. Dans quelques années, vingt tout au plus, son nom sera beaucoup moins cité. Les trentenaires d’aujourd’hui pleureront dans quarante ans la disparition des artistes qu’ils adorent en ce moment, sans même se souvenir de cette artiste qui chantait « Première rencontre ». N’est-ce pas encore par cette absence de vanité, cette conscience de la fragilité de son art que Françoise Hardy se distinguait ? La lucidité n’est pas offerte à n’importe qui.