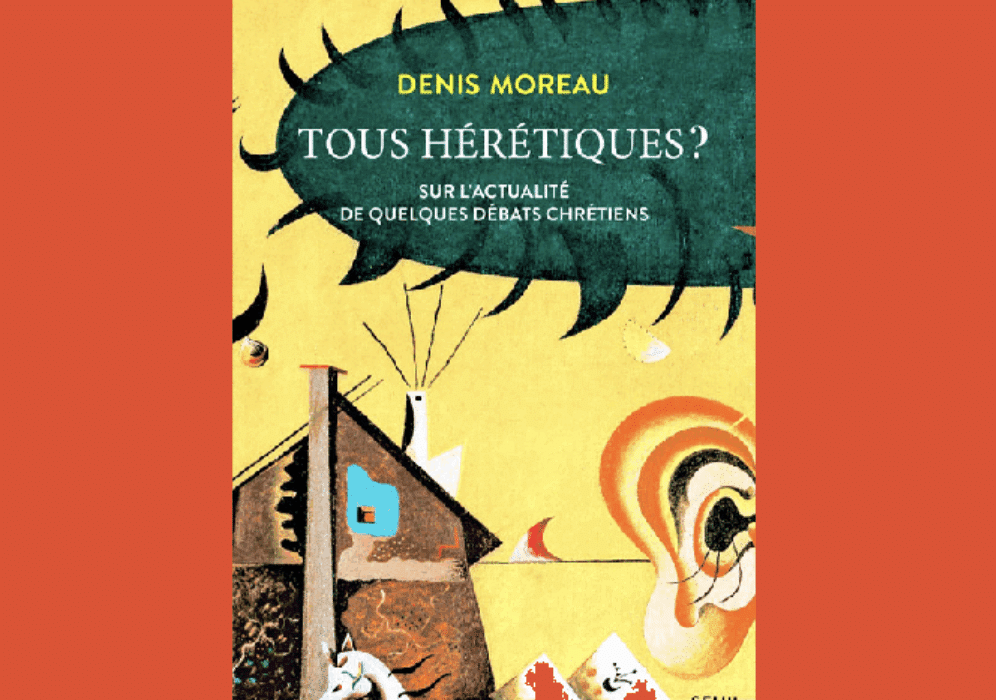Passionné de cinéma, Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle ; Dead Shack) passe son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi (Michelle Williams ; Manchester by the Sea – Venom – Fosse/Verdon), dotée d’un tempérament artistique, son père Burt (Paul Dano ; The Batman – Okja – 12 Years A Slave), scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps.
Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.
Déjà doublement récompensé de deux Golden Globes (meilleur réalisateur et meilleur film dramatique) The Fabelmans est en lice pour pas moins de sept oscars, visant possiblement subliminalement une certaine perfection. Sur scène, recevant ses Golden Globes, le réalisateur a expliqué n’avoir « jamais eu le courage d’affronter cette histoire frontalement ».
Si Steven Spielberg reconnait néanmoins que son histoire personnelle transparaît par fragments dans certains de ses films comme E.T. ou Rencontre du troisième type, il a finalement attendu ses 75 ans pour raconter plus précisément son enfance à l’écran.
C’est d’ailleurs, l’un des phénomènes cinématographiques de ces dernières années : Le fait de voir un bon nombre de cinéastes de renom se remémorer leur enfance ou leur jeunesse à travers des rêveries semi-autobiographiques. Nostalgie oblige !… Des auto-biopics déguisés, en quelques sortes. Je pense au magnifique noir et blanc de Roma d’Alfonso Cuarón, l’exploration conflictuelle du fabuleux Belfast de Kenneth Branagh, le sens anecdotique de l’égarement dans Licorize Pizza de Paul Thomas Anderson, la mémoire des faits historiques sous forme de film d’animation dans Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon enfance de Richard Linklater (à voir sur Netflix) ou bien encore l’exploration des germes du racisme américain dans Armageddon Time de James Gray, pour n’en citer que quelques-uns. Mais peu ont dessiné un autoportrait aussi dévoilant que Steven Spielberg avec The Fabelmans, où le cinéaste explore non seulement les circonstances de sa jeunesse, ses failles et ses pulsions, mais aussi le sens de l’urgence créative.

Le casting est évidemment des meilleurs, des enfants aux comédiens les plus confirmés. Gabriel LaBelle est remarquable, avec une forme de « ringarderie séduisante » alors qu’il incarne Steven dans son adolescence et le début de l’âge adulte. Ses trois petites sœurs de scénario également, et en particulier Julia Butters (Reggie). Paul Dano offre une gamme d’émotions juste tout au long du film et le comédien-humoriste Seth Rogen est excellent dans le rôle de Benny, le « meilleur » ami du père.
Mais, dans le portrait affectueux et implacable de cet écosystème familial, c’est la mère, une Michelle Williams terriblement inspirée, qui l’emporte. Une femme au foyer dont l’enthousiasme étourdi et bipolaire, emprisonné dans la cage dorée du rêve américain, perçoit la pratique artistique comme un art d’évasion, nécessaire pour survivre aux déceptions du réel.
Spielberg a eu, avec elle, sans doute la meilleure et la plus utile des professeurs avec, à ses côtés, dans un genre très complémentaire finalement, un génie de paternel particulièrement aimant et admiratif.
Mais si l’histoire est belle, parfois drôle, et très touchante… le plus beau, le plus fort, dans ce magnifique film-confession, où la fidélité aux événements réels importe moins que la version qu’on en donne, c’est la façon dont Spielberg explique sa vision du monde par l’acte de créer des images.
En rejouant, à petite échelle, l’accident de train de Sous le plus grand chapiteau du monde, il découvre que le cinéma « d’attractions » est le meilleur antidote pour apaiser les peurs et les traumatismes. En dirigeant les acteurs d’un film de guerre amateur, il découvre que la manipulation des émotions peut permettre d’atteindre le cœur de la vérité. En montant un film familial, dans ce qui est peut-être la plus belle séquence de The Fabelmans, il comprend que, dans les abîmes qui s’ouvrent entre les images, ce que les yeux refusent de voir peut être révélé. En projetant un film de fin d’année au lycée, il réalise que le cinéma peut nourrir une forme perverse de vengeance et transformer le réel. Aucune image n’est innocente, nous fait comprendre Spielberg, et c’est précisément cela qui fait du cinéma un reflet de la condition humaine. Il rappelle d’ailleurs au passage que le cinéma peut aussi manipuler et altérer le monde qui nous entoure afin de créer sa propre vérité. Mais tout cela, c’est aussi, j’ose l’ajouter ici, ce qui me séduit tant personnellement à chaque fois que je me retrouve assis dans une salle obscure face au grand écran qui s’illumine et projette une histoire. C’est ce qui me fait dire, encore et encore, que le cinéma est l’expression même de la parabole contemporaine.
Sans véritablement spoiler quoi que ce soit, impossible pour moi de ne pas mentionner deux scènes tout à fait magiques et symboliques de ce que Spielberg essaye de nous donner de comprendre. D’abord celle avec un vieil oncle qui fait peur… passé du cirque au cinéma, qui donne une première leçon au jeune Fabelmans. Une leçon qui fait mal mais révèle la pulsion créatrice qui se tapit dans le fond des entrailles de l’artiste et qui a besoin, coûte que coûte, de sortir. Son explication de la différence entre oser placer sa tête dans la gueule d’un lion et le fait de savoir l’empêcher de la fermer est digne d’un dialogue d’Audiard… Et puis, naturellement, cette scène finale, une rencontre fortuite avec le légendaire réalisateur hollywoodien John Ford (interprété par David Lynch), où se livre le secret sur l’emplacement de la caméra face à l’horizon. Nous assistons à une transmission de sagesse (aux forceps), mais c’est aussi un moment qui nous approche la manière dont le cinéma du jeune juif-américain de Cincinnati finira par renverser le classicisme du vétéran, qui consistait à garder juste les plans intéressants. Spielberg lui réinterprètera l’horizon de manière beaucoup plus subjective, sans jamais mettre au centre l’essence objective de ses films, pas même d’ailleurs dans ce dernier.
Quoi qu’il arrive, l’héritage de Spielberg perdurera et le mot FIN ne sera pas de mise dans ce genre d’histoire… mais The Fabelmans nous donne un petit aperçu du passé qui a façonné l’un des plus grands réalisateurs de la planète et nous livre, dans le même temps, une sublime leçon de cinéma. En route pour les Oscars !
Ah si j’allais oublier… la musique… de John Williams. What else ?!