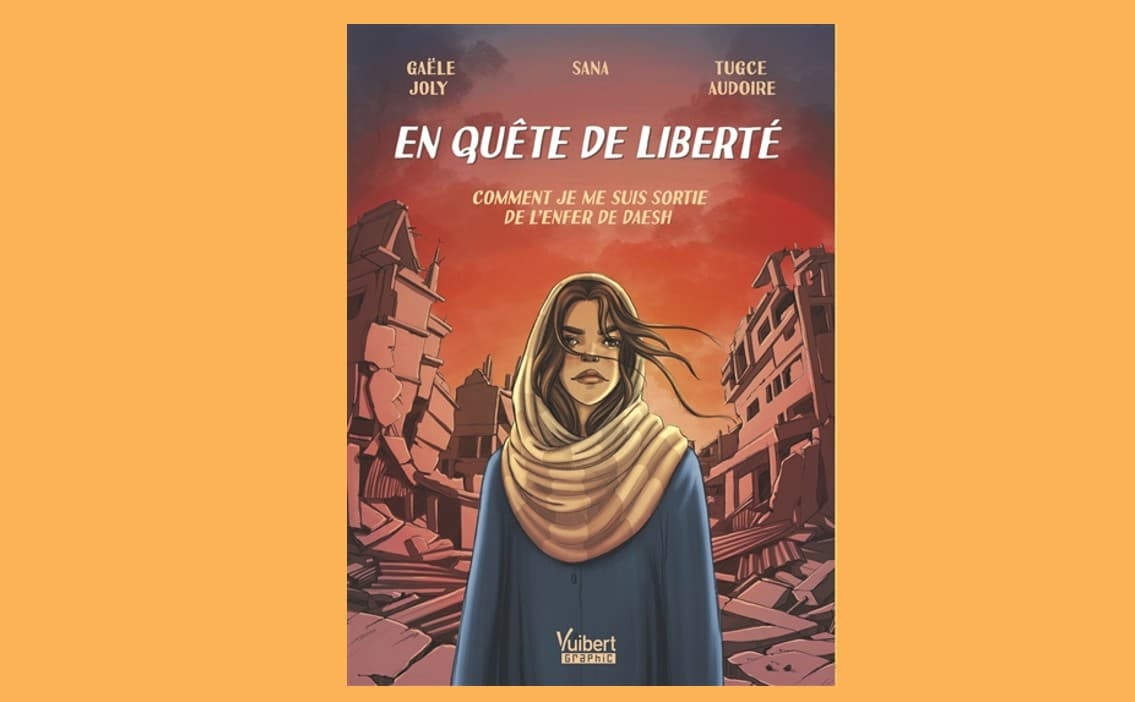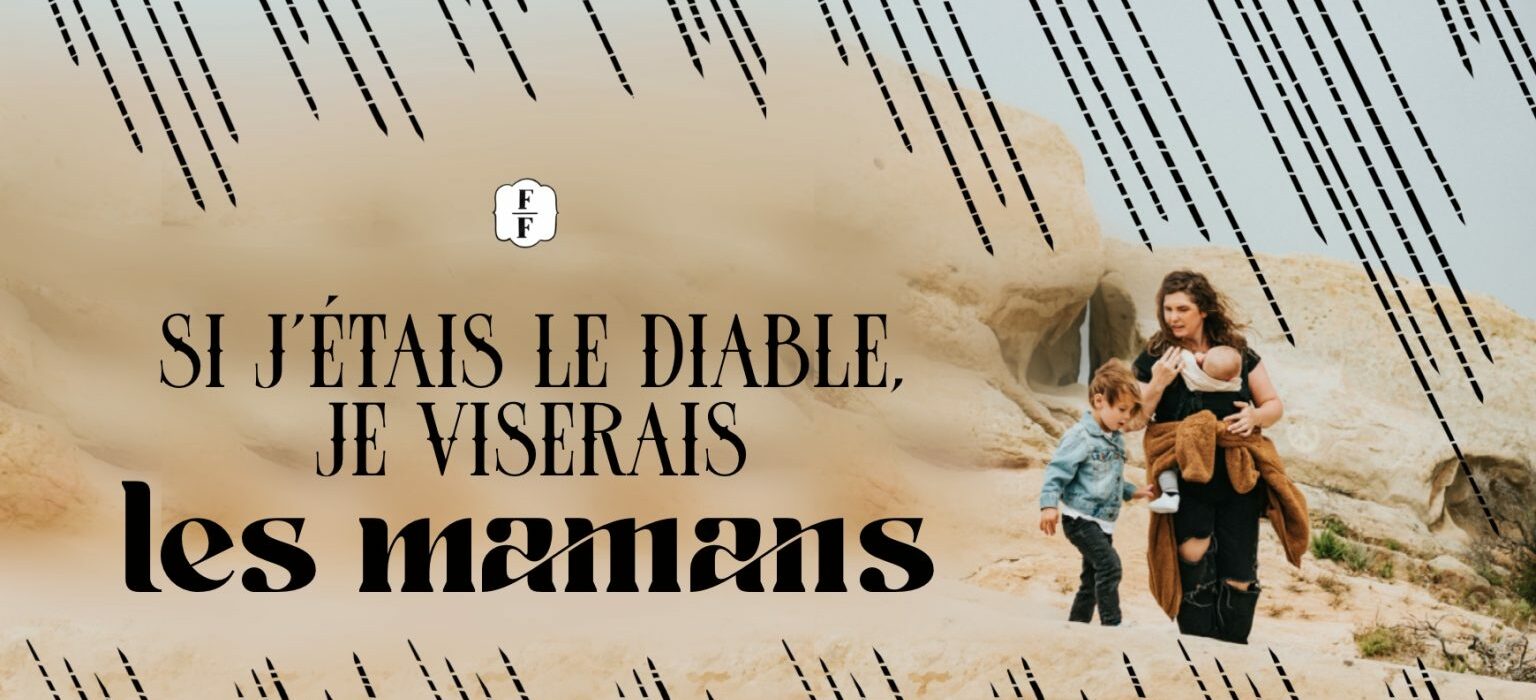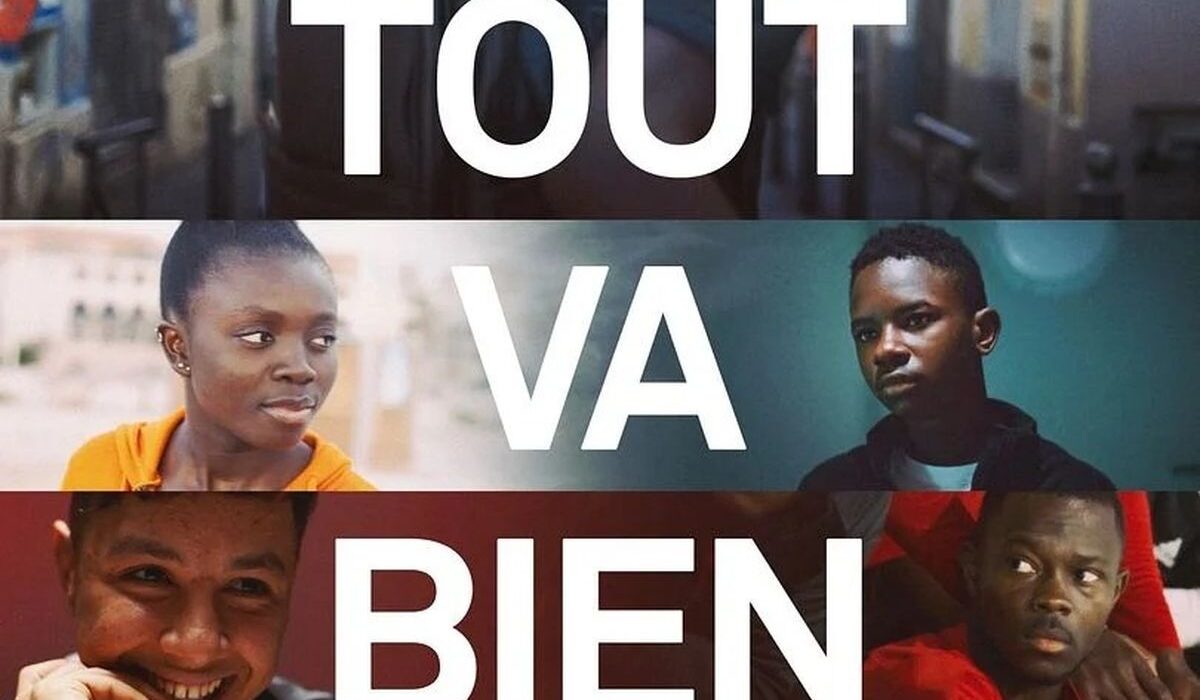Les réactions aux obsèques du pape François comme les pronostics sur son successeur font apparaître un paysage pour le moins hétérogène du peuple catholique de France. Et nous entretenons avec cette Église un lien dialectique et freudien. Nous nous sommes constitués, depuis le XIXe siècle avec le Concordat et depuis le XXe siècle avec la laïcité, avec et contre les catholiques. Mais au XXIe siècle ils n’ont plus rien à voir avec ce que le décorum nous laisse croire. La sociologue Danièle Hervieu-Léger souligne dans un article paru dans Lumen Vitæ que « les catholiques pratiquants, depuis le milieu des années 1950, n’ont pas cessé de s’amenuiser, jusqu’à ne plus représenter aujourd’hui que 1,2 % de la population française, dont moins de la moitié désormais déclare [sic] encore une appartenance, au moins nominale, à l’Église romaine. »
D’une Église dominante et dominatrice, nous sommes passés à une institution bousculée, éclatée, souvent illisible et sur la défensive. L’Église catholique ne s’est pas simplement réduite, miniaturisée ; elle a profondément muté. Pour avoir pendant quinze ans, au sein de la radio œcuménique de Marseille, côtoyé sa hiérarchie – un certain Jean-Marc Aveline – comme ses simples croyants, j’ai découvert des catholiques étonnamment libres, post-œcuméniques, fidèles, mais distants avec leurs autorités, loin de l’image verticale que les cent mitrés réunis à Lourdes ou l’assemblée des évêques romains peuvent donner, avec leurs prétentions à vouloir gouverner l’amour et la foi, l’éthique et le sexe, la mort et la société.
Christian Apothéloz, journaliste, pour « L’œil de Réforme »