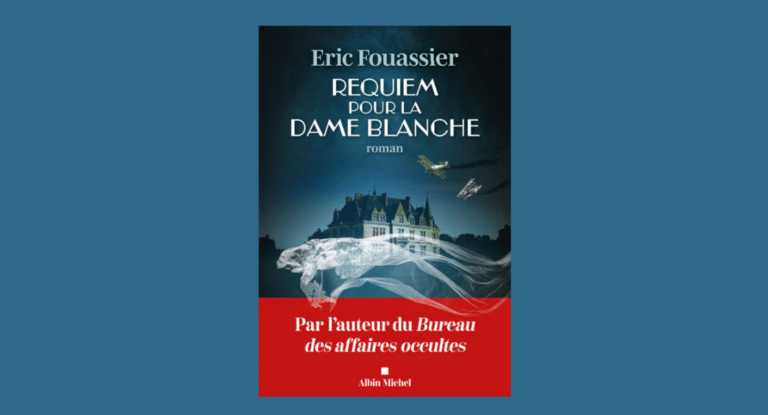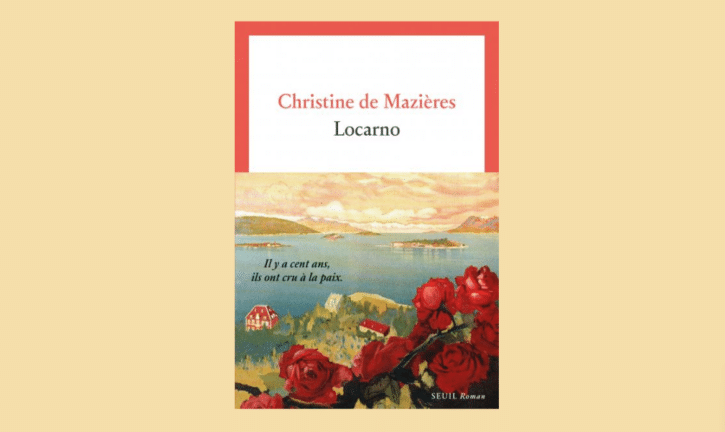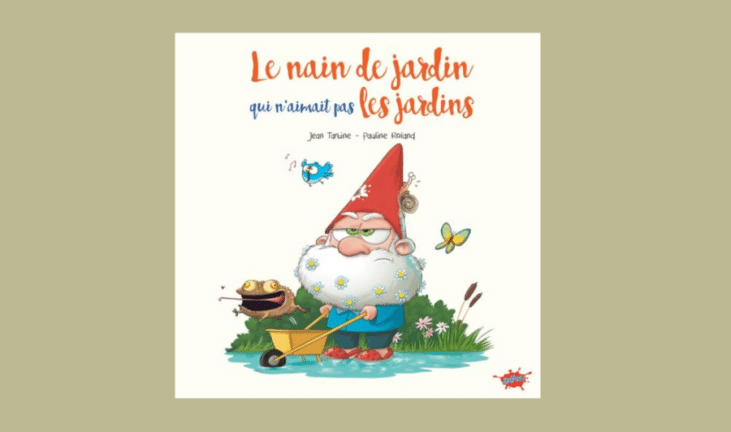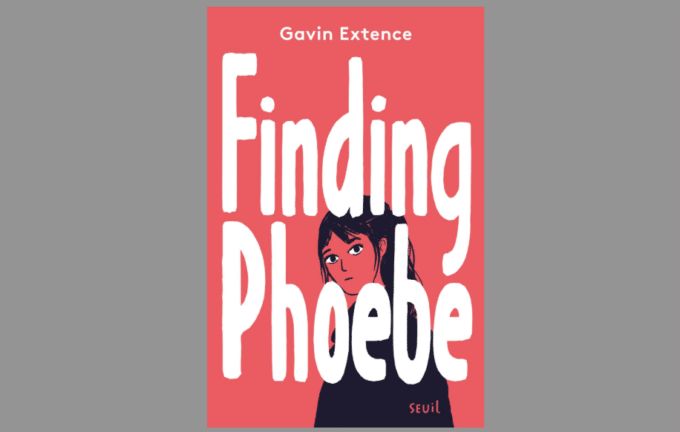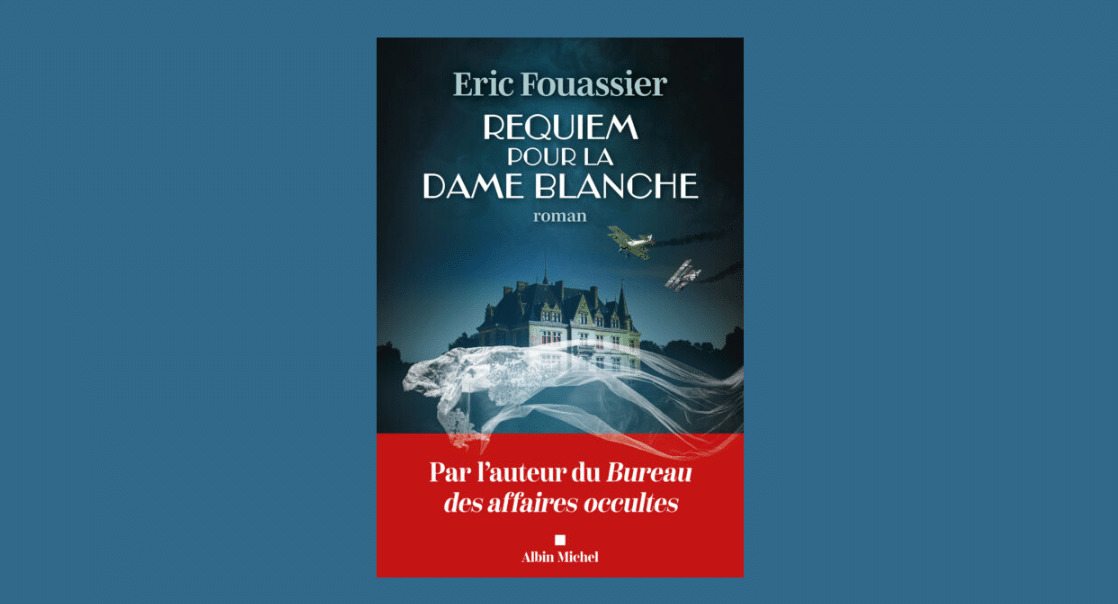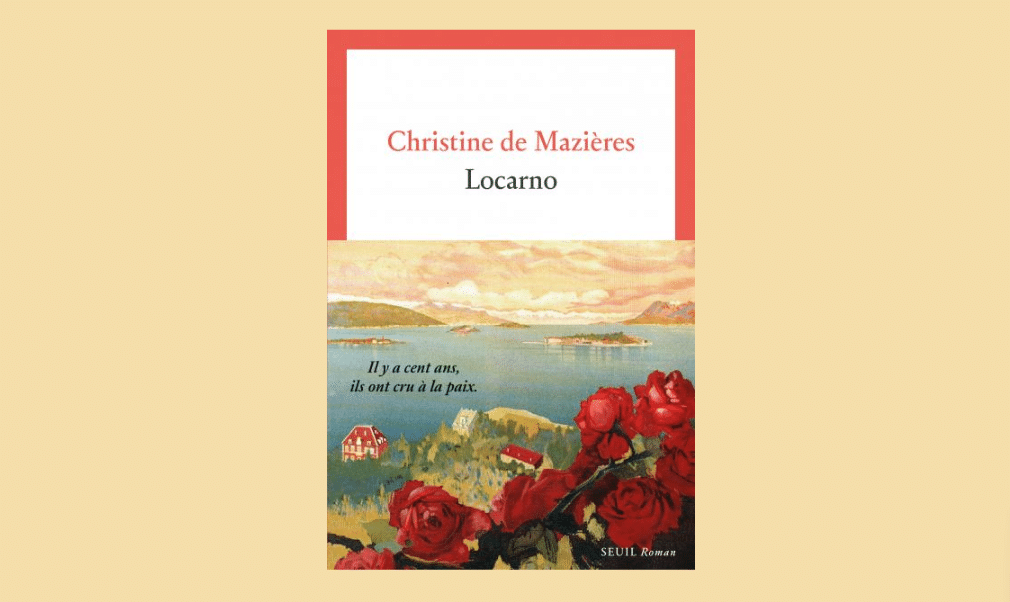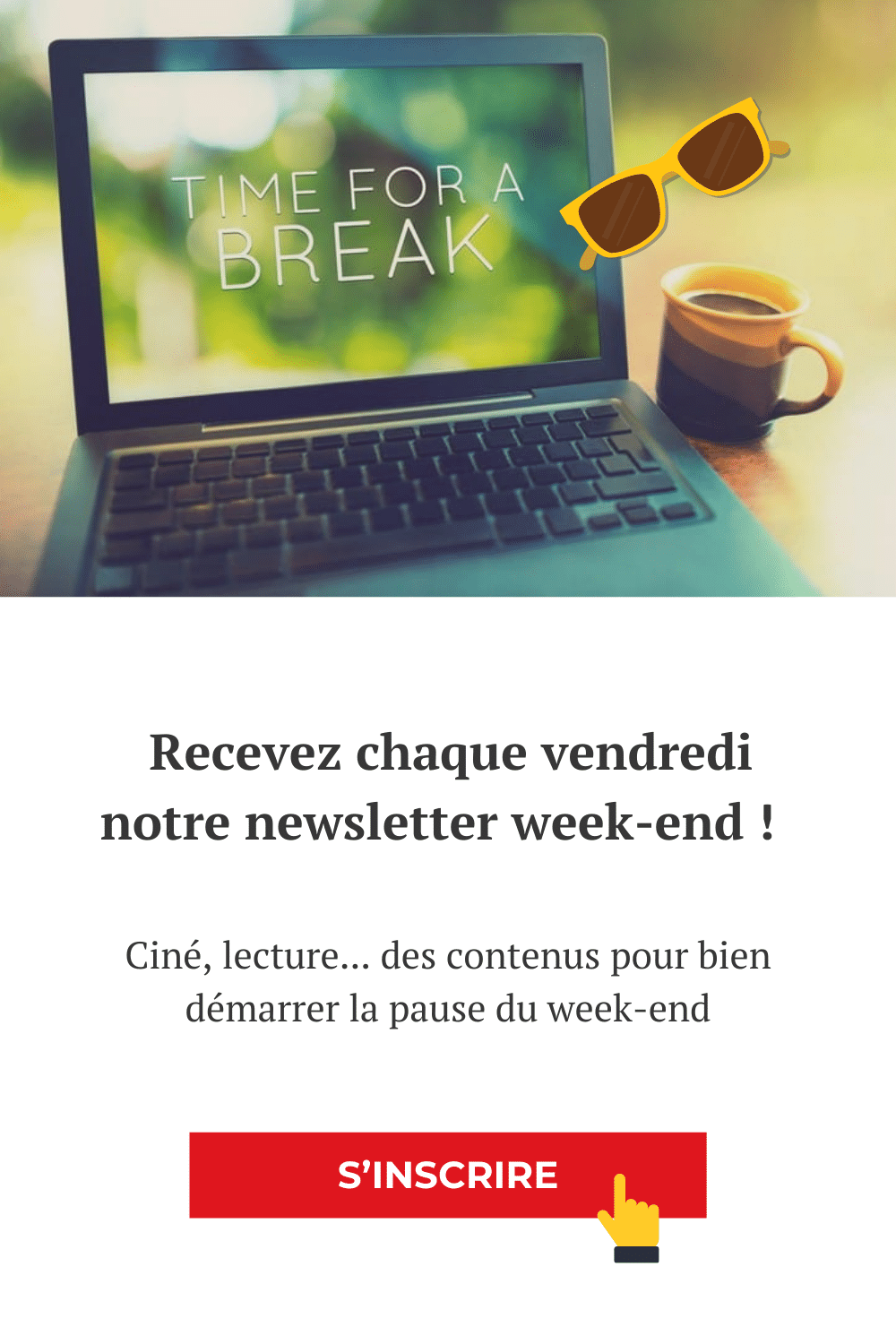Après le revirement brutal de la politique environnementale américaine, on aurait pu s’attendre, de la part des autres nations développées, à une réaffirmation claire de leur engagement écologique. Au contraire, partout en Europe, l’écologie a été rétrogradée sur l’agenda politique, loin derrière les urgences du moment. Et ceci alors que partout, l’environnement ne cesse de se dégrader.
Comment expliquer cette réaction ? Est-ce l’expression d’une résignation devant le constat que sans le soutien des États-Unis, la bataille écologique ne peut être gagnée ? Ou est-ce le résultat d’un calcul politique qui consiste à saisir la politique de Trump comme prétexte pour renvoyer sine die les réformes écologiques impopulaires auprès des électeurs et difficiles à financer ? Quelle que soit l’explication, le résultat prévisible en sera un laisser-aller écologique qui, finalement, renforcera les effets délétères de la politique trumpiste.
« Je crois que Dieu peut et veut faire naître le Bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d’hommes qui font progresser le Bien », écrit Bonhoeffer dans Résistance et Soumission. Le mal extrême, nous y sommes maintenant ! Le Bien que nous devons faire progresser, c’est la sauvegarde de la création. L’EPUdF s’y emploie en suivant le concept de l’écologie intégrale. C’est une mauvaise orientation, car lier la protection de l’environnement à la justice sociale la prive de son efficacité. Dans un monde effondré, nous n’aurons à la fin ni sauvegarde de la création ni justice sociale.
L’Église devrait mettre à profit l’actuelle rupture écologique pour repenser les fondements d’une Église qui se veut verte mais qui se conforme actuellement trop souvent – parfois sous couvert d’anticonformisme – au monde actuel.
Martin Rott, juriste, pour « L’œil de Réforme »